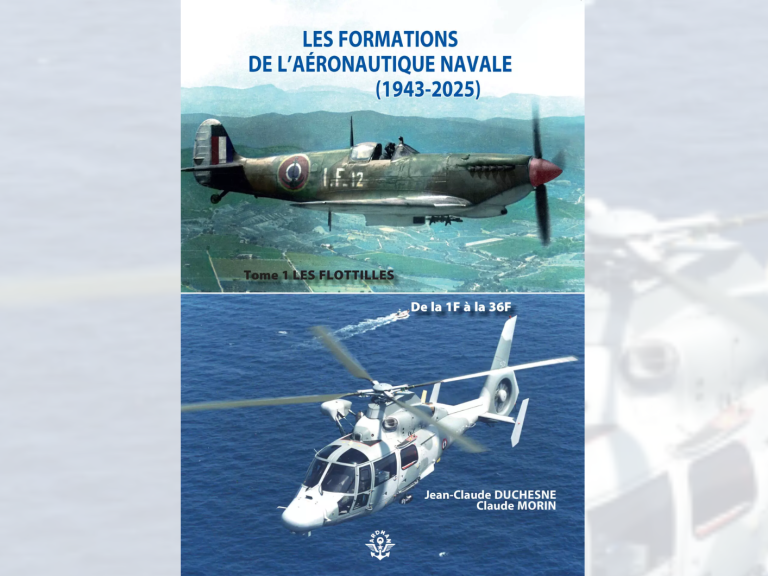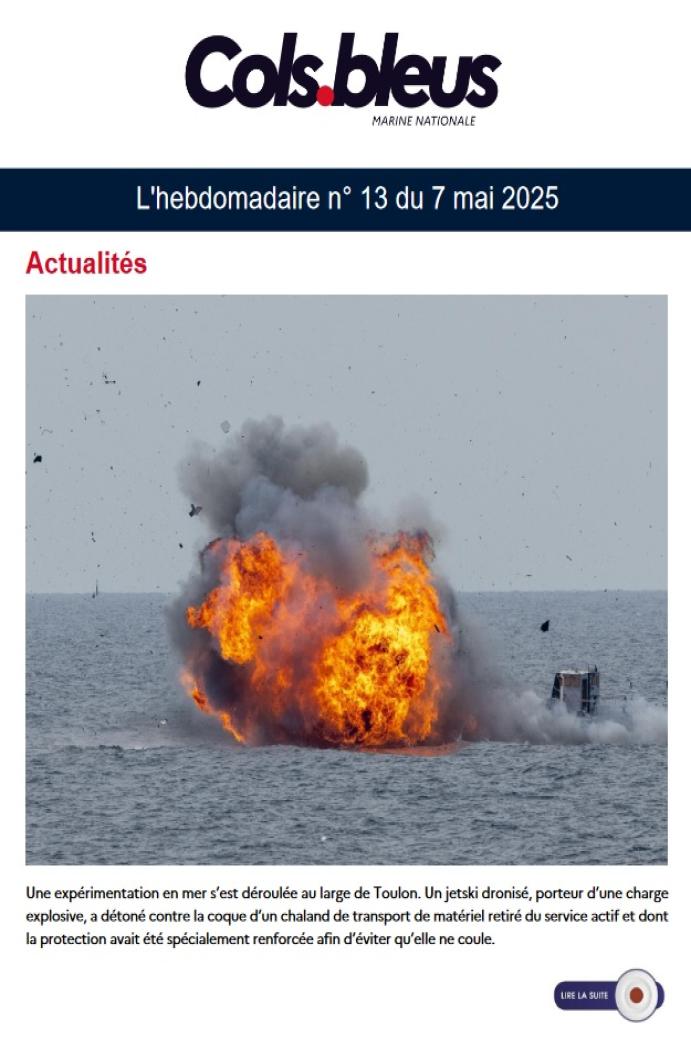Opération de contre-minage au large de Brest
Publié le 05/05/2025
Le groupe de plongeurs démineurs (GPD) de l’Atlantique embarqué à bord du bâtiment base de plongeurs démineurs (BBPD) Styx a mené une opération de contre-minage de trois munitions historiques dans l’avant-goulet de la rade de Brest. Équipés du recycleur de plongée CRABE MkII, ils ont neutralisé les trois munitions avec succès.

Sécuriser les biens et les personnes
Cette mission avait pour but la sécurisation des biens et des personnes contre le risque que peut encore représenter de tels engins explosifs.
En une semaine, les plongeurs démineurs ont neutralisé trois mines sous-marines de type MARK, d’origine britannique et datant de la Seconde Guerre mondiale. Chaque munition, repérée entre l’anse de Bertheaume et l’anse de Camaret par le chasseur de mines tripartites (CMT) Céphée, a nécessité plusieurs heures d'intervention, incluant l'élingage et le déplacement de la munition avant le contre-minage. Ces mines, bien qu’anciennes, représentaient un danger potentiel pour la navigation et les activités maritimes.
Une collaboration étroite entre les plongeurs démineurs et le Styx
Le BBPD Styx, navire de soutien spécialisé dans le support et le déploiement des plongeurs démineurs, a servi tout au long de la mission de base opérationnelle pour le détachement du GPD. Conçu pour offrir un appui logistique et de commandement, le Styx fournit tout le nécessaire pour permettre aux plongeurs d’agir dans des conditions optimales, à la fois pour leur sécurité et pour la précision de leurs interventions. La présence d’un caisson hyperbare à bord permet de mener les opérations de plongée en toute sécurité.

Un périmètre de sécurité d’un rayon de 3 000 mètres
Afin d’assurer le bon déroulement des opérations, plusieurs mesures ont été prises dont l’interdiction temporaire d’activités maritimes dans un rayon de 3 000 mètres autour des zones de déminage. De plus, les communes de Plouzané, Locmaria-Plouzané, Camaret-sur-Mer et Roscanvel ont pris des mesures pour interdire l’accès à certaines portions du littoral afin de minimiser les risques pour les habitants et les visiteurs. Enfin, des patrouilles maritimes et terrestres ont été renforcées pour garantir le respect de ces interdictions et assurer la sécurité de tous.
Les plongeurs démineurs ont suivi un protocole rigoureux pour chaque intervention. Après avoir relocalisé les mines, ils ont procédé à leur élingage, c'est-à-dire à leur fixation à des élingues pour les déplacer vers des zones définies en amont. Une fois les mines déplacées, les plongeurs ont alors pu procéder à leur neutralisation. Chaque étape de l’opération a été minutieusement planifiée et exécutée pour éviter tout risque d’explosion accidentelle.
Cette opération de contre-minage dans l’avant-goulet de la rade de Brest est un exemple concret de la capacité de la Marine nationale à répondre aux défis de sécurité maritime. Elle met en lumière l’expertise des plongeurs démineurs et la symbiose existante avec le BBPD Styx.

Teriieroo a Teriierooiterai, figure tahitienne de la France Libre
Publié le 07/05/2025
En baptisant Teriieroo a Teriierooiterai l’un de ses patrouilleurs outre-mer, la Marine nationale a voulu rendre hommage aux Tahitiens qui s’étaient ralliés au général de Gaulle dès juin 1940. Ce compagnon de la Libération est l’un des nombreux Tahitiens à s’être engagés dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale.

« Nous arrivâmes ainsi à cette journée de confusion totale, sinon de panique, que fut le dimanche 23 juin 1940. […] Il était question d’une demande d’armistice, ce qui consternait les uns, et d’une décision de toutes les colonies de poursuivre la lutte, dont d’autres faisaient état. […] Provenant de source américaine, on parlait aussi de l’appel du général de Gaulle, le 18 juin », écrit Jean Chastenet de Gery, alors gouverneur de Tahiti en 1940, dans ses mémoires intitulés Les derniers jours de la Troisième République à Tahiti, 1938-1940.
Quelques jours plus tôt, depuis Londres, le général de Gaulle s’est adressé sur les ondes aux Français. Il refuse la capitulation de la France et appelle à continuer la guerre. Son appel est cependant resté inaudible pour les Tahitiens comme pour toute une partie des habitants des territoires situés dans le Pacifique.
Combattre à des milliers de kilomètres
À Tahiti, l’annonce de l’armistice électrise les foules. L’ombre de la Grande Guerre plane au fenua, de nombreux chefs coutumiers étant d’anciens poilus. Sur un millier d’engagés, 300 ont été tués. Les Tahitiens se sont battus pour la France en 1914-1918 : ils se battront à nouveau aujourd’hui. La fibre patriotique de Tahiti fait naître un climat de désobéissance civile. Lors d’un vote populaire, le général obtient 5 164 voix contre 18 pour le maréchal Pétain. Pourtant, « le général de Gaulle, on ne le connaît pas. Les Tahitiens choisissent d’abord de continuer la lutte aux côtés des Anglais », modère Jean- Christophe Shigetomi, auteur de Tamari’i Volontaires : les Tahitiens dans la Seconde Guerre mondiale, spécialiste des faits d’armes des Polynésiens depuis la fin du xixe siècle.
En effet, la situation géopolitique des Établissements français d’Océanie ne leur offre pas beaucoup d’issues. Bordée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande à l’ouest, Hawaii au nord, l’archipel évolue dans un environnement anglo-saxon. Tahiti doit entretenir de bons rapports avec ses voisins pourvoyeurs de vivres : farine, sucre, huile, viande et savon sont importés de Nouvelle-Zélande et d’Australie.
Les intérêts à choisir le camp des Alliés sont aussi marqués par la forte influence anglo-saxonne sur l’archipel. La population est majoritairement protestante et les arbres généalogiques, fortement métissés : de nombreux Tahitiens ont des ancêtres anglophones. « D’un point de vue stratégique, les Alliés n’auraient pas pu voir ce bout de Pacifique tomber aux mains ennemies. La Nouvelle-Calédonie et Tahiti étaient prévues comme bases de repli stratégiques par les forces américaines », explique Jean-Christophe Shigetomi.
Le problème, c’est qu’à Tahiti, le gouverneur a les pleins pouvoirs et qu’il prône plutôt l’allégeance au gouvernement de Vichy. Aucune des figures gravitant autour du gouverneur ne semble capable d’adopter une position tranchée en faveur des Tahitiens. Face au parti pris des gens de pouvoir pour Vichy, les Tahitiens doivent chercher une figure de confiance, un metua, autour de qui se rallier en ces temps difficiles. L’un de ces chefs se nomme Teriieroo a Teriierooiterai.

Teriieroo a Teriierooiterai
Une voix chaude, forte et claire s’élève vers le ciel de Tahiti : « Aujourd’hui, toute la terre tahitienne s’anime, les esprits de la vallée et les esprits de la mer sont à nos côtés pour la lutte et les dieux farouches qui hantent les sommets de l’Aorai et de l’Orohena sont descendus vers nous pour nous soutenir dans la grande bataille. Jusqu’à la victoire, nous ne penserons plus qu’à la guerre. »
Instituteur de formation et chef du district de Papenoo, Teriieroo a Teriierooiterai (1875- 1952) est aussi un brillant orateur, qui parle pour et au nom des Tahitiens. Nommé au sein de la Chambre de l’agriculture en 1912, siégeant à l’Assemblée des délégations économiques et financières, il a contribué à améliorer de nombreux secteurs, dont l’agriculture de plantation et la construction.
Un chef coutumier compagnon de la Libération
Ses discours fédérateurs en font l’une des figures auxquelles se rallient les Tahitiens. Régulièrement reçu par le gouverneur avec d’autres notables tahitiens, il rejoint le groupe de Mamao qui oeuvre pour la France libre face aux pétainistes du comité français d’Océanie. Grâce à son influence sur les milieux indigènes de Tahiti, de nombreux Tahitiens s’enrôlent pour aller combattre en Europe dans les Forces françaises libres.
Pour ses services rendus à la France, il est fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle, le 28 mai 1943, aux côtés d’autres figures tahitiennes marquantes.
Le Jacques Stosskopf coiffe son premier quartier-maître
Publié le 13/05/2025
Le premier quartier-maître du bâtiment ravitailleur de forces (BRF) Jacques Stosskopf a reçu son bâchi réglementaire, orné d’un ruban éponyme, remis par le commandant, le capitaine de frégate Sébastien Fajon.

Attribut traditionnel des mousses, matelots et quartiers-maîtres de la Marine nationale, le bonnet – qu’on appelle plus habituellement coiffe ou bâchi – se repère de loin grâce à son pompon rouge, qui en fait l’un des emblèmes les plus connus de la Marine française. Bien plus qu’un simple élément vestimentaire, le bâchi, qui porte le nom de l’unité, est un petit morceau de l’âme du bâtiment. Ce symbole annonce l’arrivée prochaine du BRF Jacques Stosskopf au sein des forces navales.
L’équipage a en effet effectué ses dernières semaines d’essais à Saint-Nazaire. Au terme d’une construction et d’un armement, qui a commencé en septembre 2023 dans le respect du planning initial, le premier équipage du BRF Jacques Stosskopf continue sa montée en puissance à un rythme soutenu.
Ses premiers essais mer validés au mois d‘avril, qui se poursuivront lors d’une deuxième sortie, sonneront pour le BRF Jacques Stosskopf le départ définitif des Chantiers de l’Atlantique fin juin 2025.
Un passage à Brest lui permettra d’organiser son premier stage d’entraînement, des essais de ravitaillement à la mer et un passage sur boucles, mais également de parfaire la configuration de ses systèmes de télécommunication militaires. Puis le navire rejoindra son port base, Toulon. Un programme dense, axé sur l’entraînement opérationnel de l’équipage et les essais du système de combat, l’y attend.
L’équipage du Tonnerre formé aux urgences médicales par le bataillon de marins-pompiers de Marseille
Publié le 21/05/2025
Arrêt cardiaque, allergie grave, détresse respiratoire, traumatisme articulaire ou crânien : ces cas concrets ont été simulés par les marins à bord du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre dans un contexte de bâtiment à quai, sous l’observation active du personnel de santé du bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM).

Experts en médecine d’urgence et riches d’un quotidien rythmé par les interventions de secours d’urgence à personne à Marseille, ils ont débriefé les équipes toulonnaises pour les aider à parfaire leurs compétences techniques, mais aussi leurs capacités à travailler en équipe et communiquer de manière fluide, à sécuriser l’environnement d’intervention ou encore, pour les chefs d’équipe, à améliorer leur leadership.
Reproduisant le plus fidèlement possible des situations cliniques dans l’environnement réel de travail des soignants des équipages cette simulation in situ était une première.

Les équipements de l’infirmerie du Tonnerre ont permis à la formation de se dérouler dans de très bonnes conditions, notamment grâce à un matériel audio-vidéo de retransmission, au déploiement d’un mannequin haute-fidélité et au travail du personnel avec les sacs d’urgence et matériels électriques habituels.
En plus de permettre aux marins et médecins de la force d’action navale d’améliorer leurs modes d’intervention, les mises en situation et les échanges ont aidé l’équipe de simulation du BMPM à mieux comprendre les enjeux techniques de ce genre de simulations à bord d’un navire de guerre. De quoi ouvrir des perspectives pour l’avenir : la réflexion est ouverte pour l’organisation de nouveaux exercices sur des bâtiments plus modestes, moins équipés, ou encore dans des locaux plus contraignants.

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive : la Marine accueille l’exercice Golden Isles
Publié le 22/05/2025
Les 28 et 29 avril 2025, une nouvelle édition de l’Initiative Méditerranée, baptisée Golden Isles, s’est tenue à Toulon. Organisé par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, le ministère des Armées et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le séminaire est une déclinaison régionale de l’initiative de sécurité de lutte contre la prolifération (Proliferation Security Initiative, PSI).

En octobre 2003, un cargo battant pavillon allemand, le BBC China est intercepté dans le cadre de la PSI. Les renseignements américains et britanniques révèlent que le navire transporte des composants de centrifugeuses destinés à l'enrichissement de l'uranium, en provenance de Malaisie et à destination de la Libye. Le navire, intercepté par les autorités allemandes, est redirigé vers un port italien pour inspection. Cette opération marque l'une des premières réussites publiques de la PSI.
Lancée en 2003, l’initiative vise à créer des canaux diplomatiques et militaires afin de renforcer la coopération opérationnelle entre les États participants pour entraver les flux d’armes chimiques, biologiques et nucléaires proliférants par la mer, dans les airs et sur terre. La PSI n’est pas une organisation officielle, les 116 pays qu’elle regroupe ne sont pas des États-membres mais des soutiens qui sont encouragés à appliquer les lois de non-prolifération, à participer aux activités de formations et aux opérations d’interception. En 2013, l’Allemagne et la France, ont créé l’Initiative Méditerranée pour entretenir un dialogue régional entre les différents États actifs dans le bassin méditerranéen et pour promouvoir une appropriation des principes de la PSI par l’ensemble des pays riverains.
La dernière édition avait été organisée à Paris en juin 2022. Depuis, l’Italie a rejoint l’Initiative Méditerranée, en 2023. Cette année, Toulon a accueilli quatorze États pour l’exercice Golden Isles. Lors de ces deux journées coordonnées par le commandement en chef pour la Méditerranée, les participants ont pu découvrir à travers l’examen d’études de cas pratiques, l’illustration concrète de la mise en œuvre d’opérations d’interception de matériels susceptibles de contribuer à des programmes d’armes de destruction massive.
Au large de Toulon, un exercice grandeur nature (LIVEX) a été animé par la France, simulant l’interception d’un navire suspecté de transporter une cargaison proliférante sur le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre. L’intervention a été menée par la Marine nationale, le 2e régiment de dragons de l’armée de Terre, formé pour faire face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC), ainsi qu’une équipe des douanes de Marseille. L’ensemble des participants a souligné la nécessité de disposer d’un niveau élevé de coopération entre États, confirmant l’intuition de la PSI.
Capitaine de frégate Laurent Legenvre, commandant de la flottille 21F : « L’aventure, la cohésion, l’incertitude, l’esprit corsaire et offensif sont dans notre ADN »
Publié le 14/05/2025
Depuis dix ans à la patrouille maritime, le capitaine de frégate (CF) Laurent Legenvre, commandant de la flottille 21F, liste les défis qui attendent la PATMAR : maintien du savoir-faire, défi capacitaire en lien avec les industriels et défi humain.

Cols bleus : Le rajeunissement des équipages et le maintien des compétences est un enjeu majeur pour les armées : comment relevez-vous ces défis au niveau de votre flottille ?
CF Laurent Legenvre : La patrouille maritime (PATMAR) connaît un rajeunissement des opérateurs. En 2015, les marins de la 21F totalisaient en moyenne 11 ans de carrière. Aujourd’hui, cette moyenne est descendue à 7 ans. Les nouvelles générations ont des facilités pour appréhender les nouveaux systèmes qui équipent aujourd’hui les ATL2 standard 6. La commande de la caméra embarquée sur ATL2, la Wescam, ressemble à une grosse manette de console de jeux. Ce rajeunissement nécessite un encadrement accru par les OMS, que ce soit dans les quarts techniques mais également dans la formation des équipages.
C. B. : Vous évoluez dans la PATMAR depuis plus de dix ans, comment les impératifs stratégiques ont-ils changé la façon de travailler des équipages ?
CF L. L. : Lorsque je suis arrivé en flottille, la PATMAR était pré-positionnée de manière permanente en Afrique, à Dakar et à Djibouti. Les missions aéroterrestres concentraient une grande partie de l’activité des équipages avec les opérations Serval puis Barkhane et Chammal. Aujourd’hui, la volatilité géostratégique se ressent dans notre activité : nous n’avons plus de détachement permanent, et les équipages comme les équipes techniques sont sur le qui-vive pour répondre aux sollicitations opérationnelles où qu’elles soient. Notre activité s’étire des eaux de l’Atlantique Nord aux archipels du Pacifique. Nous décollons d’alerte régulièrement pour apporter aux Etats-Majors qui en ont besoin, une appréciation autonome de situation.
C. B. : Quels sont les grands défis qui attendent la PATMAR ?
CF L. L. : Le premier est de maintenir notre savoir-faire dans le domaine de la lutte anti-sous-marine (ASM). La cohérence française dans ce domaine de lutte avec le quatuor frégate multi-missions, hélicoptère NH90 Caïman, sous-marin nucléaire d’attaque Suffren et Atlantique 2 STD6 nous porte au premier rang des nations ASM. Cette fierté doit nous pousser à poursuivre nos efforts, nous réinventer pour déjouer les tactiques adverses et entrainer nos équipages de sous-marins.
Le deuxième défi est évidemment capacitaire avec l’évolution de l’ATL2 STD6 qui continue d’améliorer ses capacités avec les industriels. Dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la connectivité, nous avançons pour rendre l’ATL2 STD6 encore plus performant et interopérable. À plus long terme, préparer l’arrivée du PATMAR FUTUR qui enthousiasme déjà nos marins du ciel.
Le dernier défi, qui est le plus important, est humain et concerne nos marins du ciel. Nous devons continuer de recruter et de former nos jeunes marins, et les employer au mieux pour qu’ils trouvent en flottille ce qu’ils sont venus chercher dans la Marine.
C. B. : Que diriez-vous à des jeunes ayant envie de rejoindre la PATMAR?
CF L. L. : Vous ne pourrez pas trouver de plus beau métier ! L’aventure, la cohésion, l’incertitude, l’esprit corsaire et offensif sont dans notre ADN. Si vous souhaitez faire partie d’une belle et grande famille, que vous souhaitez découvrir le monde et que vous n’avez pas peur de pister un sous-marin, à 350 km/h et 30 mètres au-dessus de l’eau, votre place est en PATMAR !
Les femmes dans le renseignement
Publié le 10/05/2025
Le monde du renseignement s’enrichit d’une revue lancée par le laboratoire « Sécurité, Défense, Renseignement » du Conservatoire national des Arts et Métiers. Au sommaire de ce premier numéro, le rôle des femmes et des biographies d’espionnes célèbres (la révolutionnaire Etta Palm, Louise de Bettignies, puis Lydia Oswald et Jeanne Georgel).
Le monde du renseignement s’enrichit d’une revue lancée par le laboratoire « Sécurité, Défense, Renseignement » du Conservatoire national des Arts et Métiers. Au sommaire de ce premier numéro, le rôle des femmes et des biographies d’espionnes célèbres (la révolutionnaire Etta Palm, Louise de Bettignies, puis Lydia Oswald et Jeanne Georgel). Le souhait derrière cette publication est de participer aux débats nationaux et internationaux en se rattachant au modèle britannique universitaire interdisciplinaire. Destiné aux spécialistes et à un public curieux qui prise l’histoire en général (lire absolument l’interview de Chloé Aeberhardt, l’auteur des Espionnes racontent) ce premier opus fait mouche et risque bien de créer des vocations !