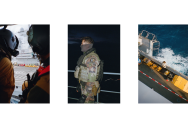Les acteurs à l’école des commandos Marine
Publié le 22/04/2025








Saison 2 de Cœurs noirs : les acteurs à l’école des commandos Marine
Publié le 22/04/2025
En prévision du tournage, le producteur, le réalisateur, le conseiller technique militaire et les comédiens ont été accueillis par la force des fusiliers marins et commandos marine.

Alors que la saison 2 tant attendue de Cœurs noirs sort, travelling arrière vers avril 2024. Durant une semaine du 1er au 6 avril 2024, cinq acteurs et le réalisateur de la série sont venus s’entraîner sur la base des fusiliers marins et commandos de Lorient. Objectif : mimer au mieux les techniques et les gestes des commandos marine et renforcer la cohésion du groupe qui s’agrandit de nouveaux membres pour cette deuxième saison.
Base d’aéronautique navale de Hyères : un siècle d’histoire et d’adaptation
Publié le 13/04/2025
Le 1er juin 2025, la base d’aéronautique navale (BAN) de Hyères célébrera ses 100 ans avec un meeting aérien réunissant les anciens et actuels marins du ciel. Un anniversaire ouvert au grand public.

Le 20 octobre 1920, un Hanriot HD.2 décolle du Palyvestre dans le sud- est de la France. Aux commandes, le lieutenant de vaisseau Paul Teste s’apprête à relever un défi inédit : poser un avion sur un navire en pleine mer. Ajustant sa trajectoire, il aperçoit la silhouette massive du porte-avions Béarn, réduit sa vitesse et amorce sa descente. Quelques secondes plus tard, ses roues touchent le bâtiment dans un appontage parfait. L’aviation embarquée française vient de naître.
Cinq ans après, cette ancienne plaine marécageuse d’où Paul Teste avait décollé devient la base d'aéronautique navale de Hyères. Cette année, elle célèbre son centenaire. Hydravions, chasseurs embarqués, hélicoptères : l’histoire de la BAN est celle d’une adaptation permanente, au service de la Marine nationale et des enjeux de défense en Méditerranée.
Des origines à la Seconde Guerre mondiale
Créée en 1925, la BAN de Hyères s’impose rapidement comme un bastion de l’aviation embarquée. Ses pistes voient défiler des hydravions, puis des chasseurs destinés aux porte-avions de la Marine nationale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est occupée et fermée en 1942, avant d’être reprise par la Marine en 1944.
Dans les décennies suivantes, la base devient un haut lieu de la chasse embarquée. Corsair, Avenger, Étendard IV…, autant d’appareils qui s’entraînent aux missions d’interception et de frappe navale. Hyères accueille aussi l’école 59S, où les futurs pilotes de chasse s’initient au pilotage sur Fouga Zephyr avant de rejoindre les flottilles opérationnelles.
Le capitaine de frégate Manuel- Joris est passé à trois reprises par la base : en 1980, dans les années 2000, puis de 2018 à 2023, où il a terminé sa carrière. Il se remémore l’époque où la base était encore dédiée à la chasse embarquée : « Dans les années 1980, il y avait l’escadrille 3S, avec des Nord 262, mais aussi la 59S et la flottille 17F. Je descendais avec la flottille 12F Crusader pour des exercices interalliés avec les Américains et leurs F-14 Tomcat. »
Il se souvient également de la transition qui s’opère dans les années 2000 : c’est à cette période que Hyères s’est spécialisée dans les hélicoptères. Avec la fermeture de la BAN de Saint-Mandrier en 2004, elle devient le cœur des flottilles d’hélicoptères embarqués de la Marine de la façade Méditerranée..
Les hélicoptères, nouveaux maîtres des airs
Trois flottilles assurent aujourd’hui la puissance aéronavale de la BAN. La 31F, équipée de Caïman Marine, est spécialisée dans la lutte anti-sous-marine. Grâce à son sonar immergé, elle traque les menaces sous la surface. La 35F met en œuvre des Dauphin, assurant des missions de sauvetage en mer et de protection du porte-avions Charles de Gaulle. Enfin, la 36F, armée de Panther, est spécialisée dans la lutte antinavire, la surveillance maritime et la protection des unités de la Marine.
Ces unités s’appuient sur plusieurs pôles d'expertise comme le Centre d’expertise hélicoptères, l’École du personnel du pont d’envol (EPPE) et le Centre d’expérimentations pratiques et de réception de l’aéronautique navale (CEPA/10S). Ce dernier joue un rôle clé dans le développement des équipements de demain, en testant et validant les nouveaux matériels de l’aéronautique navale.
La BAN fonctionne 24h/24 et 365 jours par an avec plus de 1 600 personnes, dont 300 civils. Elle accueille également des aéronefs alliés et des autres armées : avions de patrouille maritime, chasseurs de l’armée de l’Air et de l’Espace, ou encore appareils engagés dans des exercices internationaux en Méditerranée. Au-delà de la maintenance des hélicoptères, la BAN est un centre de formation et de préparation opérationnelle essentiel au soutien des unités aéronavales.
En parallèle, elle joue aussi un rôle clé dans l’action de l’État en mer, en soutien des forces de surveillance maritime, des douanes et de la gendarmerie.
Fait rare en France, la base d’aéronautique navale de Hyères est un aéroport mixte, où cohabitent trafics militaire et commercial. Avec 350 000 passagers et 24 000 mouvements aériens par an, elle est un acteur économique important pour la région, tout en garantissant la priorité à ses missions militaires.
Un ancrage fort dans le territoire
Loin d’être isolée, la BAN entretient un lien étroit avec la population. Elle ouvre régulièrement ses portes aux élus, aux associations et aux jeunes lors des Journées Défense et Citoyenneté (JDC), accueillant près de 5 000 visiteurs par an.
En plus de son rôle militaire, la BAN joue un rôle environnemental. Elle se situe dans une zone naturelle protégée qui compte 204 espèces d’oiseaux et 17 de mammifères. Son service de prévention du risque animalier, en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux PACA, veille à concilier opérations aériennes et préservation de la biodiversité.
Un siècle après sa création, la BAN continue d’évoluer, entre tradition et modernité. Le centenaire marque une étape, mais aussi une ouverture vers l’avenir, où l’innovation et les nouvelles technologies redéfiniront les missions de l’aéronautique navale.
Léa G., photographe
Publié le 15/04/2025
Cette experte énergie au ministère des Armées est aussi photographe indépendante. Elle a embarqué plusieurs jours sur le porte-avions durant la mission Clemenceau.

Spécialiste des enjeux globaux, de l’industrie de défense et de l’évolution de la conflictualité au sein de la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS), Léa travaille à l’intersection de l'art et des sciences sociales. En parallèle de son travail au ministère des Armées, elle utilise la photographie argentique pour poser son regard au quotidien lors de nombreux voyages et rencontres. En 2020, elle a ainsi travaillé sur une série photographique avec des athlètes de haut niveau, tel que Enzo Lefort, dont le sujet était « Le corps en tant qu'instrument de travail ». Ses photos ont été exposées avec Analog Sport à Paris. En 2022, Argentik Mag publie sa série photographique A Lifetime of Realness sur la gentrification à Harlem, et en 2023, Athletica Mag partage son travail avec Marie Patouillet, championne du monde et olympique de paracyclisme.
Cols bleus : Depuis combien de temps travaillez-vous à la direction générale des relations internationales (DGRIS) ?
Léa G. : Diplômée d’une licence en géographie et d’un master en géopolitique, je travaille à la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) depuis décembre 2019. Je suis cheffe de la section « Enjeux globaux, industrie de défense et évolution de la conflictualité » et responsable du portefeuille sécurité énergétique. J’assure l'analyse prospective et le suivi des enjeux énergétiques et de défense. Je travaille notamment sur la sécurité énergétique européenne et française, les rivalités de puissances pour le contrôle des ressources énergétiques, des flux et des filières industrielles, ainsi que sur la transition énergétique. Je pilote également l’Observatoire sécurité des flux et des matières énergétiques du ministère des Armées.
C B. : Pourquoi avez-vous embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle lors de la mission Clemenceau 25 ?
L. G. : J’ai eu l’opportunité d’embarquer sur le porte-avions en Méditerranée dans le cadre de mes missions à la DGRIS, en tant que spécialiste des questions énergétiques. Cette expérience s’est révélée particulièrement enrichissante, notamment pour approfondir ma compréhension du fonctionnement du groupe aéronaval (GAN) dans ses dimensions opérationnelles, techniques et stratégiques, ainsi que de ses interactions avec nos alliés (Italie, Grèce, États-Unis). Avec mon collègue Nicolas R.F., spécialiste des rivalités de puissance en Méditerranée orientale à la DGRIS, nous avons pu rencontrer les différents corps de métiers présents sur le porte-avions et mieux saisir les interactions entre les personnels de pont d’envol, les pilotes, les équipes de maintenance, de chaufferie, de propulsion et l’état-major. Nous avons également pu apporter notre expertise sur les enjeux énergétiques et stratégiques en Méditerranée à plusieurs reprises. Le besoin d’analyse sur la situation en Syrie, à la suite de la chute de Bachar-el-Assad le 8 décembre 2024, nous a conduits à réaliser une présentation à l’état-major du GAN sur les jeux d’acteurs en Syrie et les enjeux énergétiques entre l’Iran et la Turquie.

C. B. : Vous avez aussi été autorisée à réaliser des photos à bord dont certaines sont publiées dans le numéro d’avril du magazine Cols bleus (n°3125), dans la rubrique portfolio : poursuivez-vous votre activité de photographe en parallèle de vos analyses pour la DGRIS ?
L. G. : En parallèle de mon travail au ministère des Armées, j’exerce en tant que photographe freelance depuis plusieurs années. La photographie me permet d’appréhender et d’interpréter le monde sous un prisme différent. J’ai notamment documenté le phénomène de gentrification à Harlem, suivi des athlètes de haut niveau dans leur préparation olympique et réalisé des portraits pour des magazines, tels que Le Monde Mag et Le Nouvel Obs. Emmener mon appareil photo argentique lors de de cette mission m’a paru naturel et m’a permis de travailler sur un projet photographique liant les deux univers dans lesquels j’évolue. J’ai intitulé cette série de photos “Wave off” : ces deux mots résonnent comme un ordre pour dégager le pont d’envol. Je choisis de porter mon regard sur l’orchestre humain, qui avec une précision quasi-mécanique, rythme le ballet des avions. En pleine Méditerranée, j’ai capturé sur le pont d'envol, les « chiens jaunes » les hommes en « bleus », ceux en « vert ».. et d’autres personnels, lors de la mission Clemenceau 25.
Dans un environnement assourdissant, les quarts et les gestes s’enchaînent, les catapultages des Rafale se succèdent, du matin au soir, ajustant chaque mouvement aux conditions météorologiques changeantes. Je n’ai été là que 72 heures avec l’équipage, mais les 2 000 marins, eux, vivent ensemble à bord pendant plus de cinq mois. Ces photos témoignent de l’atmosphère unique et de l’intensité du quotidien à bord du Charles, avec un prisme très personnel.
La Marine nationale au salon nautique d’Arcachon
Publié le 24/04/2025
60 320 visiteurs se sont rendus à la 10e édition du salon nautique d’Arcachon, du 18 au 21 avril derniers.

Un nouveau partenariat avec le lycée polyvalent de la Mer de Gujan-Mestras
La jeunesse, l'engagement et le devoir de mémoire étaient au cœur des interventions de la Marine. Le commandant de la Marine a signé un nouveau partenariat avec le lycée polyvalent de la Mer de Gujan-Mestras à bord de la Belle Poule. Pour marquer le coup, une cinquantaine d'élèves de cet établissement avaient bénéficié d'une visite exclusive et de rencontres privilégiées avec les marins.
Tout au long du salon, le grand public a été invité à participer à des ateliers ludiques et immersifs, initiation au matelotage et découverte de la navigation sur les cartes marines.Des conseillers en recrutement étaient présents pour informer les visiteurs, en particulier les jeunes, sur les nombreux métiers de la Marine nationale. Les stagiaires de la préparation militaire Marine de Bordeaux, accompagnés de leur chef de centre et d’un instructeur, ont également témoigné de leur quotidien et de leur engagement au sein de ce stage militaire et maritime.
L’escale de la Belle Poule a attiré plus de 6 000 visiteurs, offrant ainsi une occasion unique de découvrir l'histoire de l'un des derniers voiliers ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et son rôle essentiel dans la formation des marins. Un succès qui témoigne de l'intérêt du public pour le patrimoine maritime et l'histoire navale. Cette initiative sera prolongée en 2026 pour les 400 ans de la Marine, avec de nombreuses animations prévues en Nouvelle-Aquitaine.

Dans le sillage de Virginie Hériot
Le salon nautique d’Arcachon avait également choisi de mettre à l’honneur Virginie Hériot, célèbre navigatrice et figure du bassin d'Arcachon. Première femme médaillée d'or aux Jeux Olympiques (Amsterdam 1928), décédée en 1932, elle a milité pour que les goélettes Belle Poule et Étoile soient affectées à l'instruction des officiers de Marine. Cette mise en lumière, à bord de la Belle Poule, a nourri de passionnants échanges entre les marins et les acteurs maritimes locaux autour de nombreux souvenirs historiques.
Evénement incontournable en Gironde, le salon nautique d’Arcachon a célébré la passion de la mer où innovation, tradition et convivialité se sont croisées pour mettre en avant le patrimoine maritime français.
L'intelligence artificielle et les drones : les prémices d’une autonomie totale des machines
Publié le 29/04/2025
Les drones et l’intelligence artificielle (IA) sont deux domaines importants dans l’innovation, mais il est encore difficile de les faire converger. Pourtant, intégrer de l’IA dans ces systèmes pourrait engendrer des évolutions majeures sur le théâtre opérationnel.

Imaginez un instant un drone capable, seul ou en essaim, d’atteindre ses objectifs en zone ennemie ou grise, grâce à l'IA, sans télépilote. Une idée qui commence à faire son chemin dans la Marine. Sans l’IA, ce système atteindra rapidement ses limites d’utilisation. Savoir analyser son environnement, exploiter les données et les trier, prendre des décisions en autonomie sont des capacités essentielles en mission. « Nous avons identifié le besoin de disposer de technologies à base d’IA pour la navigation autonome des drones de surface, sous-marins », commence l’ingénieur en chef de deuxième classe (ICETA2) Mehdi. Ainsi, la détection électromagnétique de mines sous-marines peut nécessiter l’utilisation de l’IA, ce qu’un simple algorithme ne permet pas sans connexion avec un opérateur. Le domaine sous-marin est d’autant plus particulier qu’il est impossible de communiquer avec un cloud pour l’analyse des images : quand il est immergé, les communications d’un drone ne passent pas.
En opération, sur un théâtre contesté, brouillé au niveau électromagnétique, nous ne pourrons pas télécommander de drones. « Demain on va larguer le système et lui dire ce qu’il doit viser. Il va activer sa caméra et chercher grâce à de la reconnaissance optique. » Cependant, l’IA a des limites. Elle nécessite des années d’entraînement pour être aussi performante qu’un cerveau humain. C’est pourquoi le centre de service de la donnée et de l'intelligence artificielle Marine (CSDIA-M) capitalise, entre autres choses, sur la récolte de données, prérequis indispensable à l’utilisation de l’IA.
Une séparation marquée entre drone et IA
Pour implémenter de l’IA dans la dronisation, il faut maîtriser chaque domaine séparément avant de les faire converger. Le MarineLab, qui travaille sur une centaine de nouveaux projets par an, étudie actuellement l’innovation autour des drones d’une part et de l’intelligence artificielle d’autre part. Un projet mené par le pôle innovation de la force océanique stratégique (FOST) applique l’IA pour la reconnaissance d’image : « Cet algorithme développé et entraîné pour un usage spécifique pourrait tout à fait être mis en place sur n’importe quel porteur comme un drone de surface », développe Olivier Dairien, responsable du MarineLab.
Si l’intelligence artificielle est utilisée pour la stabilisation d’un drone aérien, pour le ramener à sa position initiale, par exemple après un coup de vent, il s’agit d’algorithmes élémentaires déployés lors de son élaboration. Il n’est pour l’heure pas possible d’implémenter des algorithmes d’IA dans un drone à bas coût. Cette technologie sollicite une puissance trop importante : « Demain, si on souhaitait embarquer les IA actuelles sur de petits vecteurs (aériens, sous-marins), cela impliquerait que leur longévité en batterie soit considérablement réduite », explique l’ICETA2. C’est pourquoi, seule de l’IA optimisée* pourrait être implémentée dans les drones.

Et dans le civil ?
Si aujourd’hui la Marine travaille sur les deux compétences simultanément, des entreprises civiles ont déjà avancé sur le sujet. Certaines développent des algorithmes permettant d’évaluer – en fonction des conditions météorologiques et de la topographie – comment atteindre un objectif. Le système peut ainsi atteindre sa cible, en autonomie, seul ou en essaim. « Cette intelligence artificielle est capable de développer différentes missions et de trouver celles qui permettront d’atteindre l’objectif », précise l’ICETA2 Medhi. D’autres travaillent sur la détection automatique d’obstacle, l’optimisation de trajets en fonction de la météo, des courants, etc. « Dans ce domaine-là, c’est essentiellement une expertise tirée par le civil. Nous capitalisons cependant les données qui seraient nécessaires pour entraîner les algorithmes développés pour un autre usage au départ », conclut Olivier Dairien.
Petite histoire des véhicules sans pilote : le drone, une utilisation mondiale
Publié le 29/04/2025
1917, la première utilisation d’un aéronef sans pilote contrôlé à distance remonte à la Première Guerre mondiale. Il s’agissait d’un avion français de type Voisin 150 HP, pas encore tout à fait un drone tel qu'on le conçoit aujourd’hui.

C’est à partir des années 1960, lors de la guerre du Vietnam que les États-Unis d'Amérique utilisent des drones d’observation, mais cela reste anecdotique. Le changement d’échelle s’opère lorsqu’ils mettent en service le Predator puis le Reaper. Les missions d’observation au-dessus des Balkans puis de bombardements en Afghanistan amènent l’ensemble des armées à considérer le drone comme un outil incontournable. De nombreuses nations se lancent dans la production, au premier rangs desquels la Chine, les Etats-unis, l'Iran, Israël et la Turquie.
Les drones en Ukraine
Le tournant majeur de ces dernières années est l’agression russe en Ukraine. Dès le début l’utilisation des drones est décisive pour stopper l’armée russe. Preuve en est, le succès à l’été 2022, dans les médias ukrainiens de la chanson « Bayraktar » qui explique comment le drone turc éponyme a transformé « les bandits russes en fantômes ». Elle popularise définitivement le drone. L’utilisation de drones civils comme munitions téléopérées et l’efficacité des drones de surface ukrainiens en mer Noire ont convaincu les derniers sceptiques.
Au-dessus, sur et en dessous de la surface, les marines de premier rang développent et emploient des drones depuis longtemps. L’exemple de l’US Navy est marquant. C’est déjà l’une des rares à posséder une force dédiée à leur intégration au sein de sa flotte, la Task force 59. Le MQ-4C Triton supplée ses avions de surveillance maritime depuis plusieurs années tandis que le drone de surveillance hélicoptère MQ-8C Fire Scout équipe ses littoral combat ships. Washington met également en oeuvre, à titre expérimental, une flotte de drones de surface, la Ghost Fleet Overlord, chargée du transport logistique mais aussi d’essais de systèmes de combat de navires sans équipage.
Dans le domaine sous-marin, elle a reçu l’Orca. Long de 26 mètres, il serait capable de fonctionner de manière autonome pendant plusieurs mois et de réaliser des actions sous-marines. Enfin, l’US Navy poursuit de nombreuses expérimentations sans doute stimulée en cela par les progrès chinois dans ce domaine.
Mais la conception et l’utilisation de drones n’est pas réservée qu’aux marines des grandes puissances. Les Ukrainiens l’ont démontré dès octobre 2022 en utilisant avec succès leur Sea baby contre les Russes. Drone kamikaze de surface, il est constitué d’une embarcation équipée d’un moteur de jet ski, d’une charge explosive, le tout piloté par liaison satellite. Les drones sont un moyen pour les marines d’acquérir ou de maintenir des capacités à moindre coût et de pouvoir rivaliser avec des puissances navales supérieures.
Coopération internationale : être interopérable avec nos alliés
Publié le 29/04/2025
« L’ensemble des systèmes sans pilote capables de soutenir les opérations maritimes », comme ils ont été définis par l’OTAN, doivent être efficaces tout en s’intégrant à l’ensemble des opérations aéromaritimes. À cette fin, l’Alliance effectue depuis quelques années deux exercices annuels.

Le premier, REPMUS pour Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Unmanned Systems est organisé par le Joint Capability Group Maritime Unmanned Systems (JCGMUS) (en français, groupe interallié des systèmes maritimes sans pilote) dont la France fait partie. Cet exercice a pour objectif principal d’expérimenter l’efficacité des matériels présentés par les alliés au cours de plusieurs scénarios crédibles, joués en conditions réelles.
Le deuxième exercice consacré aux drones et organisé conjointement par le commandement allié à la transformation (ACT) et le commandement maritime allié (MARCOM) de l’OTAN, s’intitule Dynamic Messenger. Exercice d’expérimentation opérationnelle, il vise le développement et l’intégration de l’action des drones aux opérations maritimes de l’OTAN. L’accent est mis sur la doctrine, la formation et l’interopérabilité.
Les deux exercices sont organisés et planifiés consécutivement, dans les mêmes zones d’exercice autour du Centre d’opérations d’expérimentation maritime (MEOC), au Portugal.
Doctrine européenne
Au niveau européen, le domaine des systèmes maritimes sans pilote a été intégré au programme Unmanned Maritime Systems (UMS) piloté par le groupe de travail Safety and Regulations for European Unmanned Maritime Systems (SARUMS), qui relève de l’agence européenne de défense. Il a pour objectif de renforcer les capacités européennes grâce à plusieurs projets de recherche liés aux systèmes sans pilote. Il mène également la réflexion sur l’intégration des drones aux composantes classiques d’une force navale mais aussi sur les réglementations et législations régissant la sécurité nautique des opérations en mer applicables aux drones.
Début 2025, en réponse aux actes de sabotages répétés sur des câbles sous-marins en mer Baltique le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a demandé l’envoi de drones, de frégates et d’avions dans la région afin d’y mettre un terme. Les enseignements tirés de REPMUS, de Dynamic Messenger et du groupe de travail SARUMS sont désormais à l’épreuve des opérations.
Comment la Marine affine ses moyens de lutte anti-drone
Publié le 29/04/2025
l’automne 2024, la Marine a testé un brouilleur fabriqué par une entreprise française, pendantun exercice Wildfire. Exemple d’un test couronné de succès qui a donné lieu à un embarquement quasi immédiat sur frégate et un résultat opérationnel, illustrant l’efficacité de la démarche Perseus.

Moins de 60 jours ! C’est le temps écoulé entre les préparatifs du test et un résultat opérationnel, grâce au fructueux travail d’équipe entre la Marine (la Force d’action navale, le centre d'expertise des programmes navales et l’état-major de la Marine), la direction générale de l'Armement (centre d’essais du Levant) et l’industriel. Il y a quelques mois, Cols bleus (n°3121 octobre 2024) évoquait le cas d’usage sur la frégate multi-missions Languedoc d’un système de boules optroniques, PASEO XLR. L’équipement a été intégré très rapidement après des essais concluants. Ces caméras nouvelle génération ont été conçues pour assurer l’identification de tout type de menace à très longue distance. Elles peuvent également être utilisées en conduite de tir pour l'artillerie de tout calibre.
Pour la Marine nationale, le besoin d’améliorer les capacités de lutte anti-drone est primordial car la menace est omniprésente, et pas seulement en mer Rouge. Récemment, plusieurs bâtiments français ont dû se défendre contre des munitions rodeuses, des drones capables de rester longtemps en mer ou en l’air jusqu’à ce qu’une cible leur soit désignée. Parfois c’est un bateau de pêche qui dissimule une charge explosive. Ce fut le cas dans le golfe d’Aden où la frégate de défense aérienne Chevalier Paul avait vu s’avancer vers elle une simple barque dronisée, chargée d’explosifs. Ce drone avait été neutralisé à la mitrailleuse.
Afin d’adapter ses moyens de lutte anti-drone, la Marine fait évoluer en permanence l’entraînement suivi par ses équipages.
Dans le domaine capacitaire, la Marine vient de donner une nouvelle preuve de réactivité. Il s’agit cette fois d’un système de brouillage. Après l’avoir d’abord testé lors d’un exercice Wildfire, le brouilleur mis au point par l’industriel a obtenu des résultats suffisamment probants pour être embarqué à bord d’une frégate dès la fin de l’exercice. Cette solution de brouillage bimode (radiofréquences de télépilotage et GNSS système de navigation global par satellite) génère une bulle de protection contre les drones et armements à guidage GNSS en bloquant les capacités de positionnement, de navigation et de pilotage de ces engins. Il peut être employé contre des drones aériens ou de surface. Le succès opérationnel a été au rendez-vous avec un drone aérien de grande taille hostile qui a été brouillé et neutralisé en opération, quelques semaines après Wildfire.
« Les essais ont été suffisamment probants pour le faire partir immédiatement après l’avoir expérimenté », explique un officier, qui souligne que cette rapidité d’exécution est rendue possible grâce à la combinaison entre Wildfire et démarche Perseus. Cette dernière vise à permettre aux militaires de tester eux-mêmes, en conditions réelles durant une opération ou un exercice de préparation au combat, des innovations prometteuses issues des laboratoires d’expérimentation des forces maritimes ou de l’industrie de défense. Pour les industriels, il s’agit d’un laboratoire grandeur nature pour améliorer leurs systèmes. Cette approche en boucle courte permet d’accélérer l’emploi et l’intégration de nouveaux systèmes, donc de répondre plus rapidement à des besoins opérationnels.
« Cela permet de couvrir différents domaines de vulnérabilité des drones. Il faut s’adapter en permanence à l’évolution de la menace, que l’on peut contrer avec des systèmes variés sur étagère, peu coûteux et que l’on va garder le temps qu’ils restent efficaces ».
Marine et industriels se placent donc dans un rythme d’innovation rapide adapté face à des cycles d’évolution des menaces drones qui se raccourcissent sans cesse.