Chouette mission à bord du porte- avions Charles de Gaulle
Publié le 08/01/2025
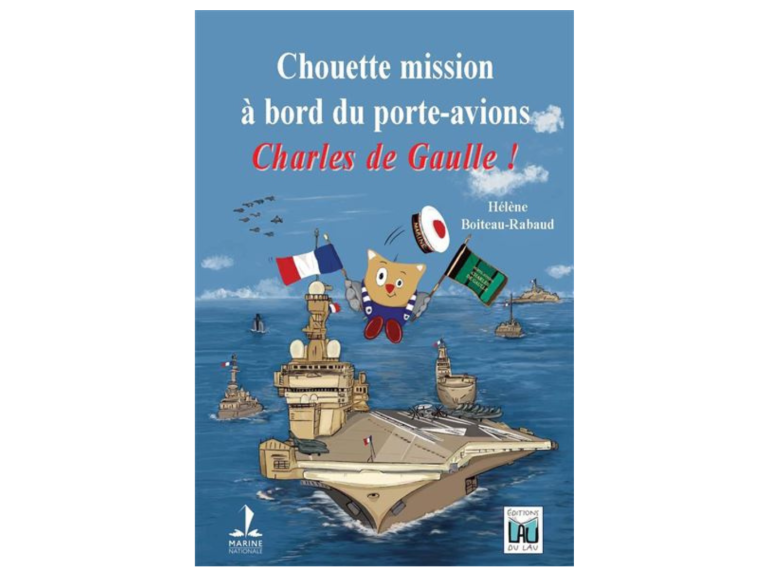
Le papa de Baptiste est marin à bord du plus grand bateau de la Marine, le porte-avions Charles de Gaulle. Juste avant d’embarquer, il a réservé à son fils une surprise de taille : aujourd’hui, le petit garçon va pouvoir monter sur le porte-avions pour le visiter. L’émerveillement et l’excitation font bientôt place à la tristesse car, de retour à la maison, sa peluche a disparu. C’est le début d’une mission top secrète pour retrouver la petite chouette.
Le papa de Baptiste est marin à bord du plus grand bateau de la Marine, le porte-avions Charles de Gaulle. Juste avant d’embarquer, il a réservé à son fils une surprise de taille : aujourd’hui, le petit garçon va pouvoir monter sur le porte-avions pour le visiter. L’émerveillement et l’excitation font bientôt place à la tristesse car, de retour à la maison, sa peluche a disparu. C’est le début d’une mission top secrète pour retrouver la petite chouette. Ce livre pour enfant retrace l’aventure de Houpette-le-Super-Chouette qui se balade dans le navire sans entrave : cuisines, infirmerie, hangar, central opération…, rien ne lui échappe, il aura même droit à un vol dans un Rafale. En prime, des coloriages, des mini-jeux, un « dico » et un « Le saviez-vous ? ». Une jolie façon de découvrir le Charles de Gaulle et de raconter le quotidien des marins en mission.
Chouette mission à bord du porte- avions Charles de Gaulle , de Hélène Boiteau-Rabaud.
Édition du Lau, 154p., 15 €. Une partie des droits sera reversée à l’Entraide Marine-Adosm
Mémoires poétiques d’explorateurs
Publié le 08/01/2025
« Il semble qu’il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu’on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. » écrivait Milan Kundera dans L’Insoutenable légèreté de l’être. Des paysages grandioses du Ladhak jusqu’aux mystères de la banquise en passant par les canaux de la Patagonie et la Vallée de l’Omo en Éthiopie, 25 explorateurs français se sont plongés dans le passé pour faire émerger un souvenir poétique de leur vie d’aventures. Marin, plongeur, scientifique, réalisateur, alpiniste, astronaute, aventurier, photographe animalier…, tous ont accepté de prendre la plume pour retranscrire l’éternité d’un instant de grâce, qui a touché leur âme. Un livre d’une grande fraîcheur qui donne soif de découvrir le monde.
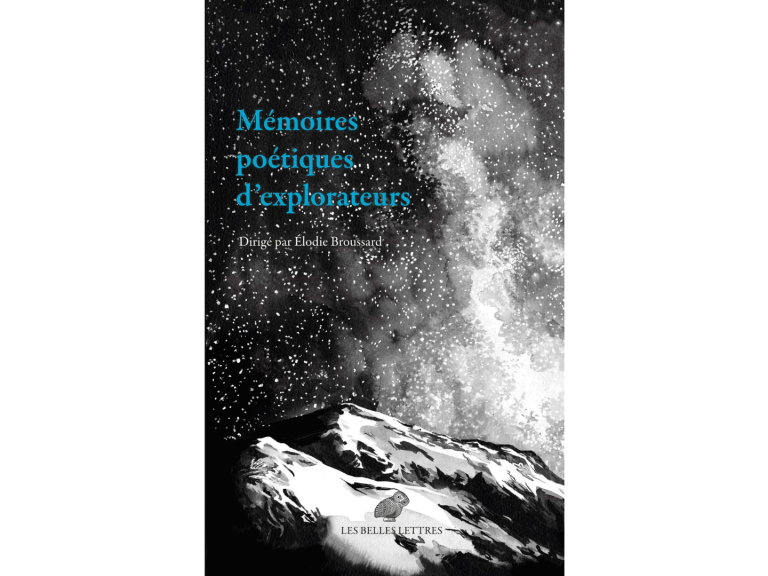
« Il semble qu’il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu’on pourrait appeler la mémoire poétique et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté. » écrivait Milan Kundera dans L’Insoutenable légèreté de l’être. Des paysages grandioses du Ladhak jusqu’aux mystères de la banquise en passant par les canaux de la Patagonie et la Vallée de l’Omo en Éthiopie, 25 explorateurs français se sont plongés dans le passé pour faire émerger un souvenir poétique de leur vie d’aventures. Marin, plongeur, scientifique, réalisateur, alpiniste, astronaute, aventurier, photographe animalier…, tous ont accepté de prendre la plume pour retranscrire l’éternité d’un instant de grâce, qui a touché leur âme. Un livre d’une grande fraîcheur qui donne soif de découvrir le monde.
Mémoires poétiques d’explorateurs, textes recueillis par Élodie Broussard, illustrations d’Amandine Comte
Les Belles Lettres, 208 p., 19 €.
Enjeu environnemental : la France, une nation polaire
Publié le 06/01/2025
L’Arctique est une sentinelle du changement climatique au niveau planétaire. Elle revêt donc un intérêt scientifique pour l’humanité tout entière. Dotée d’une tradition multiséculaire d’exploration et d’expédition dans les régions de hautes latitudes, la France est le premier pays à installer, dès 1963, une base de recherche scientifique dans l’archipel arctique du Svalbard où elle partage une base permanente avec l’Allemagne dans le village scientifique international de Ny-Ålesund. Elle dispose également d’une base annexe, la base Jean Corbel, spécialisée dans les mesures de physico-chimie, de l’atmosphère et de glaciologie, pouvant accueillir en été huit personnes.

En 2000, la France acquiert un statut d’observateur au Conseil de l’Arctique, créé par la déclaration d’Ottawa de 1996. Signée par les huit États de la zone, elle constitue l’enceinte politique de coopération régionale référente sur les questions arctiques. En novembre 2008, alors qu’elle a pris la présidence de l’Union européenne, la France organise, à Monaco, une conférence internationale sur l’Arctique, donnant naissance à l’Observatoire scientifique de l’Arctique. Lancé en 2010, il coordonne quelque 400 chercheurs dans les domaines des sciences de la Terre, des sciences de l’environnement et des sciences humaines et sociales. Dans les zones polaires, les infrastructures terrestres et les moyens logistiques français sont gérés par l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV).
Equilibrer les extrêmes : stratégie polaire de la France jusqu’en 2030
Une première dans l’histoire du pays. Présentée le 5 avril 2022 par Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur chargé des pôles et des affaires maritimes, la stratégie polaire 2030 est une véritable feuille de route polaire axée sur le renouveau de la recherche scientifique. Déployée dans le cadre du Comité interministériel de la Mer et des Pôles (CIMER-POLES), elle sert la coopération européenne et internationale aux pôles Nord et Sud, où la France est impliquée. L’un des principaux objectifs de cette stratégie est d’offrir plus de moyens à la recherche, face à la menace du dérèglement climatique en Arctique. La stratégie polaire à horizon 2030 se décline en cinq grands chapitres. Premier axe : porter une stratégie polaire globale et d’équilibre (en fait partie le lancement d’une « Décennie des mondes polaires » qui pourrait se dérouler de 2025 à 2035). Deuxième axe : soutenir à l’échelle européenne et internationale une recherche au long cours, innovante et exemplaire. Troisième axe : définir un dispositif et des moyens renforcés pour la science dans les mondes polaires (il est fait mention de la création d’une fondation française pour les pôles).
Le quatrième axe est celui qui concerne particulièrement l’Arctique : la stratégie prévoit un triplement des moyens consacrés à l’Arctique, poussant le gouvernement à installer une nouvelle base scientifique au Groenland et à construire un nouveau navire océanographique pouvant naviguer dans ces zones froides, le renforcement de la présence française au Conseil de l’Arctique, la protection de l’environnement et du développement durablement (qui se traduirait pas l’arrêt de l’exploitation des énergies fossiles au pôle Nord), d’investir les cercles de réflexion et manifestations internationales, de retrouver un niveau ambitieux de recherche et d’échanges académiques, de disposer de nouvelles structures à terre comme en mer et enfin la valorisation de la présence scientifique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le cinquième axe concerne la protection de l’Antarctique.
Cette stratégie a donné lieu à une proposition de loi de programmation polaire, dont la première lecture a eu lieu au Sénat le 26 octobre 2023, suivie du One Polar Summit en novembre 2023.
Changements climatiques dans le Grand Nord : la glaciologue Daphné Buiron
Publié le 06/01/2025
Docteure en climatologie et glaciologie, Daphné Buiron est partie hiverner un an sur la base Dumont d’Urville, en Terre Adélie. Quatre ans plus tard, elle découvre l’Arctique et se passionne pour cette région, la culture Inuit et la vie dans le Grand Nord. Guide d’expédition depuis neuf ans sur des navires de croisière dans les pôles, elle n’a de cesse de transmettre sa passion pour ces territoires en péril à travers ses livres, ses photographies et ses conférences.

Cols bleus : Quelles sont les causes du changement climatique en Arctique ?
Daphné Buiron : L’intensification de l’effet de serre, en réponse aux activités anthropiques, est la cause principale du réchauffement mondial. La combustion des énergies fossiles produit un excès en dioxyde de carbone dans l’atmosphère. L’agriculture intensive renforce la production de méthane et de composés azotés. Tous ces gaz s’accumulent dans l’atmosphère, amplifient l’effet de serre et dérèglent le climat. Certaines rétroactions climatiques renforcent ces phénomènes. Par exemple, dans les pôles et autres zones glaciaires, l’effet d’albédo, réflexion de l’énergie solaire par les glaces, diminue, accentuant ainsi le réchauffement de ces régions. Le principal puits de CO2 est l’océan, suivi de la respiration des végétaux. Environ 30 % des émissions anthropiques de CO2 sont dissoutes dans l’océan. Plus les eaux sont froides, plus elles ont cette capacité d’absorption.
Ainsi, la déforestation ou la diminution de phytoplancton renforcent le changement climatique. En Arctique, la température moyenne sur 30 ans a augmenté d’environ 4°C, soit trois fois plus qu’en France.
C. B. : Quelles sont les conséquences pour la faune et la flore ?
D. B. : Avec moins de jours de neige dans l’année, la flore polaire tend à accéder à plus d’ensoleillement, propice à la croissance. L’Arctique verdit, la toundra grandit, s’étoffe. De nouvelles espèces s’implantent qui pourraient déstabiliser l’écologie de ces espaces.
La flore arctique est spécifiquement adaptée aux conditions climatiques extrêmes. Si la température, la luminosité, l’accès aux ressources nutritives changent, certaines espèces s’adapteront, d’autres non. Il en est de même pour les animaux. Les espèces polaires sont suradaptées à des conditions très particulières de vie. La modification d’un petit paramètre entraine des conséquences sérieuses sur l’équilibre des écosystèmes. Par exemple, les bancs de poissons apprécient des masses d’eau de température froide spécifique. Si ces eaux se réchauffent, les poissons pourraient se déplacer plus au Nord. Or, ils sont la base alimentaire d’animaux prédateurs, ou d’humains, qui devront conjuguer avec ces nouveaux itinéraires. La chaîne alimentaire peut ainsi être bouleversée. Les ours polaires se nourrissent des phoques, nombreux sur la banquise printanière. Les phoques mettent bas à cette période sur la glace côtière. Le maintien de la glace de mer printanière est ainsi très important, c’est un facteur clef de la santé des écosystèmes marins de l’Arctique. Avec le réchauffement, la banquise se forme plus tard et fond plus tôt dans certaines régions. C’est un facteur sensible dont l’évolution est à surveiller de près. En outre, la banquise côtière protège également les berges des fortes tempêtes. Sans elle, l’érosion s’intensifie.

C. B. : Quelles sont les conséquences sur les populations locales ?
D. B. : Elles sont nombreuses ! Par exemple, une banquise qui s’affine et se fragilise représente un danger pour les personnes qui l’arpentent ou y chassent. D’un autre côté, la saison de pêche en eau libre est de ce fait plus étendue et ainsi facilitée. Sur les terres arctiques, la couche supérieure du sol est gelée sur plusieurs mètres d’épaisseur depuis la dernière période glaciaire, c’est ce qu’on appelle le pergélisol. Actuellement, de vastes zones dégèlent, provoquant des glissements de terrain et des inondations, et libérant du méthane gazeux dans l’atmosphère. Ceci renforce le réchauffement et menace les villages construits sur ce sol. Des infrastructures s’effondrent, des routes sont détruites. Plusieurs villages ont déjà été déplacés. L’accès à la nourriture se modifie, tout un équilibre de connaissance ancestrale est à réinventer. C’est un défi écologique et social.
C. B. : Quel avenir pour le climat en Arctique ?
D. B. : Les climatologues travaillent constamment à affiner les simulations des futurs possibles scénarios d’évolution des températures. Ils dépendent de nombreux paramètres parfois difficiles à prévoir. Ces dernières années, la fonte des glaces a été plus rapide que les scénarios préétablis par les scientifiques. Le futur de l’Arctique n’est pas encore écrit.
C. B. : Avez-vous le sentiment que la population est éveillée sur le sujet ?
D. B. : Oui et non. Aujourd’hui on peut difficilement dire que la population ignore l’existence du changement climatique, mais peu de personnes sont conscientes de la gravité que cette situation représente et des enjeux qui en découlent. L’Arctique est certes une zone éloignée, mais la hausse du niveau des mers en réponse à la fonte des glaces polaires nous concerne tous. Les conséquences de ce qui se passe en Arctique et en Antarctique sont mondiales. Nous avons besoin de politiques qui prennent des décisions adaptées et motivent à l’action.
C. B. : Quel est votre rôle en tant que climatologue ?
D. B. : Le travail des climatologues aujourd’hui est essentiellement de la prévision et de la communication: comprendre au mieux le système climatique et alerter. J’écris, je fais de la sensibilisation dans les écoles, j’organise des conférences dans les entreprises, j’essaie d’apporter ma pierre pour que les décisions prises aujourd’hui soient justes et adaptées pour imaginer demain un avenir positif à la vie sur notre belle planète.
C. B. : Quelles solutions existent ? Le phénomène peut-il être inversé ou ralenti ?
D. B. : Rien n’est perdu c’est certain, tout est à sauver !
Si nous limitons rapidement nos émissions de gaz à effet de serre, en quelques années, la tendance s’inversera. La stabilisation ne se fera pas immédiatement car le temps de vie de certains gaz à effet de serre dans l’atmosphère est de plusieurs années, d’où l’importance d’agir rapidement. En parallèle, nous devons trouver des solutions innovantes pour remplacer les énergies fossiles, continuer les recherches, revoir nos pratiques de consommation, d’alimentation, réfléchir à nos philosophies de vie. C’est un défi de taille, passionnant et réel, que d’organiser des solutions efficaces, éthiques et équitables.
L'archipel du Svalbard
Publié le 08/01/2025










Major Michaël : chef de la centrale électrique à Crozet
Publié le 07/01/2025
« Très tôt, vers treize ans, j’étais décidé à m’engager », raconte le major Michaël. Enfant, il est fasciné par les récits de son beau-père, qui aime partager les souvenirs de son service militaire sur le Clemenceau et sa carrière dans la Marine marchande. Synonymes de voyages et d’aventures, les noms des mers du globe attisent la curiosité du jeune garçon.

Au lycée, il se rend au forum des métiers avec sa classe. L’adolescent passe la majeure partie de son temps au stand de la Marine à feuilleter les brochures de recrutement, pour savoir à quel métier il peut prétendre. Un an plus tard, il intègre l’École de maistrance pour devenir mécanicien naval. Le major explique : « Cette spécialité est une force de l’ombre, on est assez isolé, on travaille dans les fonds, on n’est pas forcément visible, malgré tout, c’est une spécialité importante, on est responsable des besoins primaires, eau douce, énergie… ». Le large panel de secteurs à maîtriser séduit le major Michaël qui, déjà, « bricolait un peu ». « La Marine accélère la débrouillardise car on doit s’adapter sans cesse. Sur un bateau, l’expression ”en tout temps, en tout lieu” prend tout son sens, car un événement peut survenir n’importe quand et il faut pouvoir répondre très vite le bâtiment, lui, continue d’avancer ». Au fur et à mesure, il grimpe les échelons et se dirige vers le brevet de maîtrise « machines thermiques ». Il aime l’expertise et la technicité de sa spécialité : « C’est un des domaines où on est capable de s’en sortir partout et n’importe où. »

Sa soif de voyager est étanchée par ses nombreux embarquements. Il aime être sur l’eau mais tend l’oreille lorsque les marins racontent leur hivernage dans les terres australes et antarctiques françaises, « c’était un peu mystérieux, cela a tout de suite éveillé ma curiosité, le lointain, la potentielle aventure, je me suis dit que ça pouvait être une sacrée expérience. » En 2013, le major Michaël rejoint l’archipel Crozet pour un premier hivernage qui sera suivi de deux autres en 2016 et en 2024. Quand on lui demande ce qu’il aime, la réponse est immédiate : « Tout. Aucune journée ne se ressemble, j’adore le froid, je suis un passionné d’ornithologie, j’aime la proximité avec la faune endémique de là-bas et la biodiversité est exceptionnelle. » 25 millions d’oiseaux peuplent l’île, soit l’équivalent du nombre d’habitants de New Delhi, deuxième plus grande ville du monde. Si les oiseaux sont légion, la présence humaine est plus discrète, au total 30 personnes vivent à Crozet en période d’hivernage. Scientifiques, militaires des trois armées, étudiants en service civique, contractuels de l’Hexagone et d’outre-mer : une poignée de gens dont la diversité de profils offre un brassage insolite qu’apprécie le major Michaël : « Au niveau social, c’est très intéressant, il y a un melting pot riche en enseignements. Ça force l’ouverture d’esprit, le pragmatisme et ce sont vraiment de belles expériences. »
Chef de la centrale électrique à Crozet, le major Michaël est responsable de toute la production et de la distribution d’énergie électrique sur la base, des groupes électrogènes de secours du centre de transmission et de l’hôpital. « Je suis également responsable de toute la partie ravitaillement et distribution stockage de carburants. Je m’occupe enfin de la sécurité et de la prévention sur la base et les sites isolés », ajoute le major Michaël dont le gros chantier, cette année, consistera à remplacer un moteur de groupe électrogène. Pour sa prochaine affectation, il espère embarquer sur une frégate de type La Fayette, un bateau qu’il aime, où les machines peu automatisées requièrent tout son savoir- faire de mécanicien naval.

Focus : Marin dans les terres australes et antarctiques françaises
Des paysages à couper le souffle, une exceptionnelle proximité avec la faune et la flore ou la soif d’aventure, les marins affectés dans les terres australes et antarctiques françaises (TAAF) partent tous avec le désir de vivre une expérience unique à l’autre bout du monde. Ils sont 13 marins actuellement en mission dans les TAAF dont la zone économique exclusive couvre 2,3 millions de km², soit plus de 20 % du territoire maritime français. Souvent issus des spécialités mécanicien, électrotechnicien ou manœuvrier, les marins embarquent pour 13 mois d’hivernage dans l’un des districts composant les TAAF : l’archipel Crozet, les îles Kerguelen, les îles Saint- Paul et Amsterdam. Ils exercent leurs missions dans un cadre exceptionnel en lien avec d’autres militaires, des scientifiques et quelques civils.
Septembre 2001 : entrée à l’École de maistrance
2002 : brevet d’aptitude technique mécanicien naval
2002 à 2006 : affectations sur les FASM Primauguet et Georges-Leygues
2009 : brevet supérieur puis affectation sur la FASM Jean de Vienne
2013 : chef de centrale à Crozet
2016 : responsable de chaland à Kerguelen
2018 : affectation sur la FLF Guépratte
Juin 2021 : brevet de maîtrise puis affectation sur la FREMM-DA Alsace
Septembre 2023 : obtention des épreuves de sélection professionnelle
2024 : chef de centrale à Crozet
Meilleur souvenir
« Le conflit en mer Rouge est un souvenir fort. Nous sommes passés de périodes d’exercices à une véritable menace. On a senti qu’on avait franchi un cap, les armements étaient véloces, il fallait réagir très vite à tous les niveaux. Il y a eu des moments de doutes, le rythme était intense mais sur le bateau tout le monde se serrait les coudes. Il y a toujours eu du dialogue, la mayonnaise a bien pris, l’entente était très bonne. »
LA FRÉGATE LA FAYETTE RENFORCE LES MOYENS BRESTOIS
Publié le 01/10/2024

Une frégate de type La Fayette à Brest ? Bien que basée à Toulon, la FLF La Fayette a rejoint cet été la zone maritime de l’Atlantique. En 2022, la frégate a fait l’objet d’un important programme de rénovation, au niveau de la structure, du système d’armement et des moyens électroniques. Avec ces ajustements, sa durée de vie opérationnelle a été rallongée. Venant appuyer les patrouilleurs de haute mer, les anciens avisos, la FLF assure les mêmes missions : surveillance et défense de l’espace maritime, renforcement de la présence dans la zone et poursuite des missions de police en haute mer. Dès 2026, le relais sera pris par les nouveaux patrouilleurs hauturiers.
LA BRETAGNE AU JAPON
Publié le 01/10/2024

Au pays du Soleil-Levant, alors que pointent les premiers rayons de l’aube, la frégate multi-missions Bretagne réalise sa relève d’équipage. Cette escale, de l’autre côté du monde, traduit les liens étroits entre les marines française et nippone. Après avoir participé aux exercices Valliant Shield et Rimpac 24, la Bretagne poursuit ainsi les interactions entre les deux nations dans le cadre de leurs intérêts en Indopacifique et achève sa première partie de mission.
RETOUR À QUAI POUR LE GROUPE JEANNE D’ARC
Publié le 01/09/2024

Fin de mission. Parti le 19 février, le groupe Jeanne d’Arc, composé cette année du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre et de la frégate de type La Fayette (FLF) Guépratte, est de retour à son port base, Toulon, après 148 jours de déploiement. Après un périple qui les a conduits de l’Afrique de l’Ouest aux États-Unis en passant par l’Amérique du Sud, les 160 officiers-élèves achèvent leur formation.
DÉFILÉ DU 14 JUILLET À PARIS
Publié le 01/09/2024

4 000 militaires ont eu l’honneur de défiler sur l’avenue Foch ou de la survoler. Y figuraient les marins de l’École navale, l’École de maistrance et l’École des mousses, ceux du Commando Kieffer, du bataillon de fusiliers marins Amyot d’Inville, de la frégate multi- missions Alsace, du bâtiment ravitailleur de forces Jacques Chevallier, de l’équipage bleu du sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Triomphant et enfin des Flotilles 4F, 11F, 12F, 17F, 21F, 28F, 32F, 33F et 35F. Des stagiaires de préparation militaire Marine et des réservistes opérationnels faisaient également partie du tableau final







