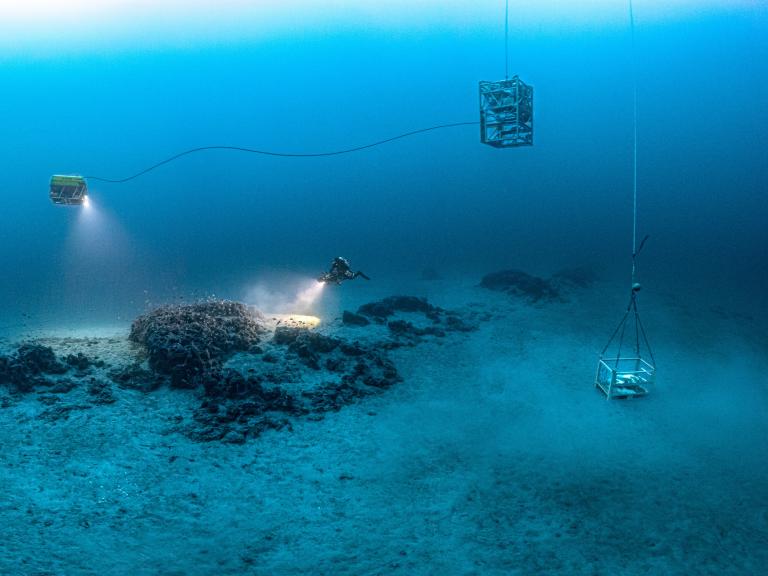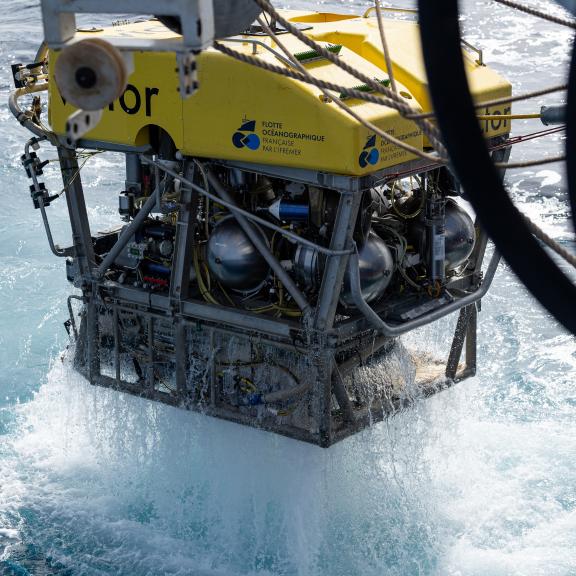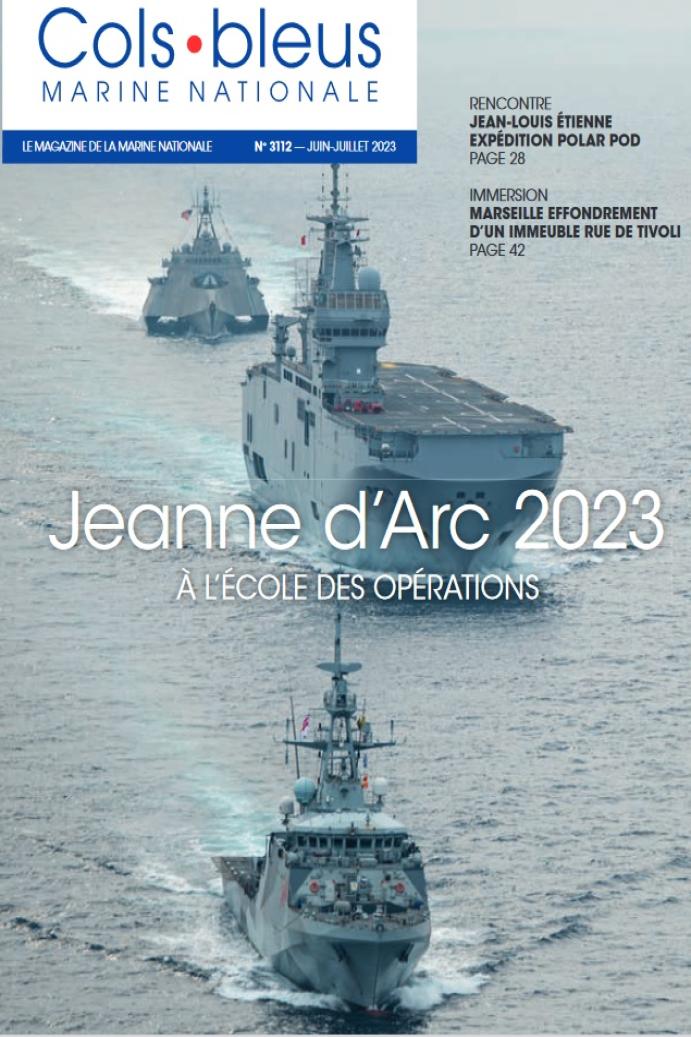Jeanne d'Arc 2023 : mission accomplie
Editeur
Le site Colsbleus.fr est édité et géré par le Service d’information et de relations publiques de la Marine nationale (SIRPA) : 60, boulevard du général Martial Valin - 75015 Paris
Directeur de la publication : CV Sébastien Perruchio, directeur de la communication de la Marine nationale.
Directrice de la rédaction : CC Emilie Duval
Pour joindre le SIRPA Marine, un numéro unique 09 88 68 46 71
.
Equipe éditoriale
Rédactrice en chef : ASC Nathalie Six
Rédacteurs : EV1 Margaux Bronnec, ASP Clémence de Carné, SACS Philippe Brichaut, SACS Laurence Ollino-Deloof
Equipe technique :
Webmaster : MT Antoine Bordelet
Chargé de projet : EV1 Pierre-Elie Diby
Maintenance applicative : Sopra Steria
Réalisation du site
Le site a été réalisé par Cap Gémini
Hébergement
Le site est hébergé par le ministère des Armées
.
Propriété intellectuelle
Les contenus présentés sur ce site sont soumis à la législation relative aux informations publiques et sont couverts par le code de la propriété intellectuelle (CPI).
Toute demande de réutilisation des vidéos, des photographies, des créations graphiques, des illustrations, des représentations iconographiques et des lexiques, ainsi que l’ensemble des contenus éditoriaux produits pour l’animation éditoriale du site doit être adressée à l’adresse suivante : sirpa.marine@gmail.com
Crédits photographiques et autres mentions relatives aux droits d’auteur : Les photographies présentes, ainsi que l’ensemble des œuvres figurant sur ce site proviennent de sources différentes.
Les crédits photographiques et autres mentions relatives aux droits d’auteur, tels que spécifiés sur ce site, doivent être respectés.
.
Liens
L’établissement de liens vers le présent site est possible. La mention explicite du site colsbleus.fr dans l’intitulé du lien est souhaitée. Le ministère de la défense se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non-conforme à l’objet du site colsbleus.fr.
Réutilisation des informations publiques
Les demandes de réutilisation d’informations publiques sont à transmettre, pour accord, à l’adresse suivante :
Le simple accès aux informations publiques est gratuit pour les particuliers comme pour les entreprises.
La réutilisation non commerciale, notamment à des fins pédagogiques, est autorisée à la condition de respecter l’intégrité des informations et de n’en altérer ni le sens, ni la portée, ni l’application et d’en préciser l’origine et la date de publication.
Données personnelles
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’opposition (art.38), d’accès (art.39), de rectification ou de suppression (art.40) des données qui vous concernent.
Ce droit s’exerce, en justifiant de son identité :
par voie postale : Marine Nationale, SIRPA Marine, Rédaction Cols bleus - 60, boulevard du général Martial Valin - 75015 Paris
Avertissement Les informations figurant sur ce site et/ou accessibles par ce site proviennent de sources considérées comme étant fiables. Toutefois, ces informations peuvent contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques.
Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait l’objet d’une mise à jour, entre le moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur en prend connaissance.
Droit applicable L’utilisation de ce site est régie par le droit français, quel que soit le lieu d’utilisation.
En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents pour connaître de ce litige.