Les marins célèbrent le 243ème anniversaire de la bataille de la Chesapeake
Publié le 06/09/2024
La bataille de la Chesapeake est devenue « la victoire navale de référence » pour les marins d’aujourd’hui et de demain. Sa célébration annuelle, dans toutes les unités, permet la pleine appropriation des valeurs qu’elle porte. Vécue en équipage elle vise à nourrir la cohésion des équipages et l’esprit combattant. Sur tout le territoire métropolitain et outre-mer, les marins ont célébré cet anniversaire.

A Toulon, première cérémonie officielle pour le VAE Christophe Lucas depuis sa prise de fonctions en tant que préfet maritime de la Méditerranée. Lecture de l’ordre du jour du chef d’état-major de la Marine et remises de médailles étaient prévues lors d’une cérémonie des couleurs spéciale « Chesapeake ».
Durant 3 heures, les marins (plus de 600 participants en équipe) se sont ensuite affrontés au cours d’un chalenge « swim and run » organisé par le bureau sport de la base navale.
La Musique de la Marine nationale, présente lors des cérémonies, s’est produite en concert dans l’Amphithéâtre de la Naïade avec un programme musical spécialement composé par son chef pour la commémoration de la Chesapeake !
A Cherbourg, la journée a débuté par une cérémonie qui a rassemblé les marins, civils et militaires de la façade. Puis une centaine d’entre eux ont participé à un challenge sportif mêlant course à pied, natation, course d’orientation et parcours d’obstacles valorisant l’esprit de cohésion, d’engagement et de combativité.
A Brest, les marins de l’antenne de la Force d’action navale étaient aux côtés d’une délégation américaine de la 6e flotte de l’US Navy présente pour l’occasion. Cette participation était particulièrement symbolique puisque la victoire de la flotte française face à la flotte britannique lors de la bataille de la Chesapeake a été une victoire décisive de la guerre d’Indépendance des États-Unis.
La journée s’est ensuite poursuivie par des activités sportives organisées notamment par le service d’entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) d’ALFAN Brest et un déjeuner cohésion renforçant ainsi l’esprit d’équipage autour du souvenir de la victoire de cette bataille historique célébrant la gloire et la combativité de la Marine nationale.
A Toulon pour les unités de le Force d’action navale, la cérémonie de commémoration de la bataille de la Chesapeake s’est tenue sur le quai Milhaud 6. Elle a été présidée par le vice-amiral d’escadre Christophe Cluzel, commandant la Force d’action navale (FAN) et la Force aéronavale nucléaire avec la présence du vice-amiral Serge Bordarier, commandant la Force de l’aéronautique navale (ALAVIA). Cette commémoration a également permis l’adieu aux armes du contre-amiral Eric Lavault, commandant la Maîtrise des fonds marins, au terme de 34 ans de service.
Une délégation de chaque unité de la FAN et d’ALAVIA établie à Toulon était présente ainsi que des associations d’anciens combattants contribuant au devoir de mémoire pour entretenir le lien entre les générations de marins présentes et futures. Les honneurs aux drapeaux des bâtiments de combat et de la Force de l’aéronautique navale ont été rendus afin d’honorer les batailles passées et le sacrifice des marins.
Parmi toutes les victoires de la Marine, celle du 5 septembre 1781 dans la baie de Chesapeake trouve une résonnance toute particulière dans les valeurs de combativité, d’innovation et de force morale qui ont forgé l’institution. Un rappel historique à l’ensemble des marins de la force qui perpétuent l’héritage afin de bâtir la préparation opérationnelle pour faire face aux crises actuelles et à venir.
Rendez-vous annuel, cet évènement offre l’opportunité à toutes les unités de la FAN basées à Toulon de se retrouver autour du swim and run, un défi sportif en équipe, vecteur de cohésion pour l’ensemble des participants.
Le capitaine de corvette Patrice Magotteaux, commandant le Centre du service militaire volontaire de Brest, a procédé à la lecture du rappel historique de cette victoire navale française ainsi que du message du chef d’état-major de la Marine, à l’ensemble du personnel présent composé notamment de volontaires du SMV et de leurs cadres. A l’issue, une quinzaine d’entre eux ont éprouvé leur combativité et esprit d’équipage lors de la course d’obstacles organisée par le bureau EPMS d’ALFAN Brest !
A Lorient, les fusiliers marins et commandos Marine de la Force maritime des fusiliers marins et commandos ont commémoré la bataille de Chesapeake. Dès 7h30, les élèves de l’École des fusiliers marins se sont prêtés au jeu du Swim and Run, un aquathlon où les marins ont enchaîné 325 mètres de natation et 5,3 kilomètres de course à pied.
Les personnels de la base des fusiliers marins et commandos, accompagnés des personnels de la frégate de défense et d’intervention (FDI) Amiral Ronarc’h et de ceux de la base de l’aéronautique navale de Lann Bihoué (dont les fusiliers marins de l’unité Brière) se sont ensuite eux aussi mis sur la ligne de départ.
Les marins avaient le choix de le faire en solo, en relais avec un nageur et un coureur, ou en duo en faisant les deux épreuves sanglés ensemble.
Après ce beau moment sportif, les marins se sont retrouvés sur la place d’arme de la base pour la remise des prix et pour la cérémonie de commémoration de Chesapeake, présidée par le nouvel Alfusco, le contre-amiral Samuel Majou.
Aux Antilles, le capitaine de vaisseau Le Tutour, commandant de la base navale de Fort-de-France a lu l’ordre du jour devant une assemblée de marins civils et militaires et de personnels militaires d’autres entités des FAA (Forces armées aux Antilles). A l’issue de la cérémonie, une centaine de participants de toutes les unités basées à Fort-de-France (base navale, frégates de surveillance Germinal et Ventôse, bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Dumont d’Urville, patrouilleur Antilles-Guyane LaCombattante) ont pris le départ des activités organisées. Des militaires des autres armées (état-major interarmées, 33ème RIMA, DICOM,...) se sont joints aux marins pour réaliser 3 km de course à pied et 750 m de nage dans une ambiance conviviale dans laquelle les marins ont partagé un moment de cohésion avec les personnels d’autres unités des FAA.
A Hyères, le service EPMS de la base d’aéronautique navale d’Hyères a organisé un parcours d’obstacles (environ 1 km sur le sable, la terre et dans l’eau) au club militaire de voile au profit des marins de la BAN. Défi relevé haut la main pour nos marins du ciel.
A Lanvéoc-Poulmic, le capitaine de vaisseau Max Blanchard, commandant la base d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic, a présidé la cérémonie de commémoration qui s’est déroulée en tenue de sport. A l’issue, plus de 300 personnels de la base ont participé au cross organisé par le bureau EPMS de la BAN. Une cinquantaine de personnes a assisté à la conférence sur le thème « Chesapeake et forces morales : du succès au combat » animée par le VAE Xavier Petit (ALFOST) et organisée par l’École navale. Elle a été suivie d’un moment de convivialité sur le front de mer.
A Marseille, une cérémonie militaire a été organisée sous la présidence du vice-amiral Lionel Mathieu, commandant la Marine à Marseille. Cette cérémonie a rassemblé tous les marins de la garnison dont le CIRFA Marine, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, la compagnie de gendarmerie maritime, une délégation de réservistes citoyens et les marins des états-majors interarmées, pour raviver l’esprit d’équipage et l’engagement militaire.
Après une revue des troupes et la lecture de l’ordre du jour relatant la bataille historique de Chesapeake rappelant l’importance de cet événement dans l’histoire maritime française et renforçant la combativité et la résilience des participants, un temps de convivialité permettant aux marins de partager un moment d’échange a été initié.
La commémoration de Chesapeake est, cette année encore, l’occasion de réaffirmer les valeurs chères aux marins : honneur, esprit d’équipage et engagement pour la Nation. Elle a permis de renforcer les liens au sein de la communauté maritime de Marseille, sous l’égide du commandement de la Marine à Marseille, et de rappeler que l’esprit d’équipage est un défi quotidien à relever, en mer comme à terre.
A Marseille, la journée a débuté dans toutes les casernes du Bataillon de marins-pompiers par la lecture de l’ordre du jour de l’amiral Vandier, ancien CEMM à l’origine de cette célébration dans la Marine nationale. Cette lecture était précédée, pour toutes les compagnies, par celle de l’évocation historique du quartier-maître Daniel Touché, marin-pompier mort en service commandé le 5 septembre 1980.
Le bureau sports conviait ensuite le personnel du bataillon et plusieurs unités et partenaires invités sur la plage du Prophète, pour prendre part à une activité sportive créée dans un esprit d’aguerrissement.
Si les conditions météo exceptionnelles de la veille ont obligé le service EPMS à écarter le parcours nautique et aquatique initialement envisagés, la météo n’a nullement entaché le bel état d’esprit des quatorze équipes présentes.
Des équipes représentant le consulat des États-Unis, la police municipale, la gendarmerie maritime, le bataillon de fusiliers marins Détroyat, les nageurs-sauveteurs de la ville de Marseille et bien sûr les marins-pompiers se sont rencontrées autour d’activités sportives et ludiques qui mettaient en exergue les notions de cohésion, de combativité, de dépassement de soi qui contribuent au développement de l’esprit d’équipage.
L’équipage B de L’Astrolabe a commémoré la bataille de la baie de Chesapeake et dans le cadre de sa préparation physique et militaire du combattant (PPMC), organisé une sortie sportive dans les hauts de l’île de La Réunion.
Au programme, la descente du canyon du trou blanc, situé dans la commune de Salazie, en utilisant différentes techniques : descente en rappel, tyrolienne, sauts, franchissement vertical…
Tout en renforçant l’esprit d’équipage, cette sortie a favorisé l’intégration des nouveaux marins embarqués et a été l’occasion de cultiver la volonté des marins de se surpasser physiquement, mais aussi psychologiquement. Dans l’esprit Chesapeake, cette journée a rappelé à tous les enseignements tirés de cette bataille : un entraînement de qualité, la constante implication de tous les marins de l’équipage et la nécessaire endurance à entretenir pour durer en mer, en mission et au combat.
A Brest, l’équipage du patrouilleur outre-mer Jean Tranapea participé au challenge sportif des commémorations de la bataille de Chesapeake, organisé par le bureau EPMS de la division entraînement d’ALFAN Brest.
Sur le site du Portzic, la symbolique du bâtiment a pu être présentée aux autres équipages présents. Il représente un tricot rayé, animal emblématique de la Nouvelle-Calédonie futur port d’attache, enlaçant le glaive, l’ancre et la croix de Lorraine des Compagnons de la Libération sur fond de l’archipel calédonien.
L’assemblage des tranches du Jean Tranape est terminé. Il attend maintenant de rallier Boulogne-sur-Mer pour terminer son armement. A l’issue, il rejoindra la base navale de Brest pour y conduire une série d’essais en mer avant son stage de mise en condition opérationnelle et son départ pour Nouméa à l’été prochain.
Nommé en hommage à Jean Tranape, Compagnon de la Libération et natif de La Nouvelle-Calédonie, ce patrouilleur est le 4ème d’une série de six bâtiments dédiés aux missions de protection, de souveraineté et d’action de l’État en mer dans les zones économiques exclusives outre-mer. Deux patrouilleurs seront positionnés dans les ports de Nouméa, Papeete et Port-des-Galets.
A bord de la FREMM Languedoc en escale à Mersin en Turquie. Les marins ont commémoré la bataille de la Chesapeake lors d’une cérémonie avec lecture de l’ordre du jour par le commandant. L’histoire du Languedoc est liée à la bataille de Chesapeake. En effet, le vaisseau de ligne Le Languedoc est mis à flot en 1776 et son histoire commence sous les ordres de l’amiral d’Estaing lors de la campagne d’Amérique. Une escadre de treize bâtiments avec comme vaisseau amiral LeLanguedoc quitte Toulon pour prêter main forte aux insurgés. L’escadre participe à plusieurs combats navals non décisifs. Il repart en 1781, sous les ordres du marquis d’Argelos, au sein de l’une des trois escadres de l’amiral de Grasse. Au cours de cette campagne, LeLanguedoc participe, le 5 septembre 1781, à l’une des plus belles victoires de la Marine : la bataille de la baie de Chesapeake qui scellera la victoire des insurgés sur les Britanniques.
A Nouméa, les marins de la base navale ont commémoré le 243ème anniversaire de la bataille de Chesapeake. Le capitaine de vaisseau Julien Fort, commandant de la base navale, a débuté cette commémoration par la lecture de l’évocation historique de cette bataille riche en enseignements devant les marins des unités « calédoniennes » (Vendémiaire, d’Entrecasteaux, DIRISI, DICOM, EMIA…). Après une remise de décorations et de récompenses, tous se sont ensuite retrouvés sur le lagon calédonien pour s’affronter dans un rallye combinant kayak et course d’orientation. Enfin, un déjeuner cohésion a rassemblé tous les marins dont les plus sportifs se sont vu remettre un trophée « Chesapeake » spécialement conçu par les ateliers de la base navale.
En Gironde, les armuriers du détachement « armement » du CEPA/10S de Cazaux ont proposé à leurs homologues marins proches de la BA 120 de se retrouver, afin de partager un moment sportif de cohésion et de convivialité.
Les marins de la DGA du site de Biscarosse, de l’Escadron d’Hélicoptère 01.067, et du CEAE 00.331 de la BA120 ont répondu présents à l’appel, preuve que même loin d’une base navale, les marins célèbrent la Chesapeake.
La journée a débuté par le discours du chef de détachement cazalin, rappelant le contexte de cet événement du 5 septembre 1781, réunissant une nouvelle génération de militaires près de 240 ans plus tard. Puis en binôme, les marins ont dû évoluer au travers d’un redoutable parcours d’obstacles, suivi d’une course en canoë rappelant les nombreux navires prêts à s’élancer hors de la baie de Chesapeake, avant de terminer par un circuit « run & bike » pour éprouver l’endurance des participants. Ce moment sportif a mis en avant la ténacité, la combativité, ainsi que la maîtrise de différents milieux, caractéristique des marins au fil du temps. Cet événement a été l’occasion de vivre pleinement l’esprit d’équipage, de créer des liens entre marins venant de différents horizons, spécialités, et parcours, qui n’ont que très rarement l’opportunité de se rencontrer malgré la proximité géographique, mais aussi de mettre en valeur leur appartenance à la Marine nationale.
A Brest, le service de l’entraînement physique militaire et sportif (EPMS) de la base navale de Brest / Arrondissement Maritime Atlantique a organisé, au stade de Keramazé de Plouzané, un match de rugby opposant la sélection du XV de l'Atlantique à celle de la Méditerranée. Le commandant de l’arrondissement maritime Atlantique, le vice-amiral d’escadre Jean-François Quérat a donné le coup d’envoi du match en présence de monsieur Yves Du Buit, maire de Plouzané. Avec un score de 16 à 14, la sélection du XV de l’Atlantique a remporté le match. Cette rencontre a également permis aux sélectionneurs de détecter le personnel ayant le potentiel pour intégrer le rugby club de la Marine nationale (RCMN), et ainsi participer aux rencontres nationales, internationales au profit de l’institution. Réunissant 60 joueurs, encadrants et arbitres et près de 300 spectateurs, cet événement a remporté un vif succès.
Au COMAR Nantes, chaque marin commandant un fier vaisseau de ligne ou une frégate était prêt à en découdre. Passée la déception de devoir pour certains être à la manœuvre de navires ennemis et sous les ordres de l’amiral Graves plutôt que de Grasse, les marins ont eu à cœur d’appliquer le cap donné par le CEMM dans son ordre du jour et de remplir leur mission stratégique, en faisant appel à toutes leurs connaissances tactiques et nautiques. Sautes de vent, feux à bord, captures de vaisseau par l’ennemi… rien n’a été épargné à nos marins. Mais avec audace et résilience ceux-ci ont fait face et bien servi leur patrie. A l’issue de la bataille, Français et Britanniques se sont réconciliés et ont pu rejouer le match autour d’un déjeuner, prêt à profiter de ce retour d’expérience pour mieux affronter l’ennemi l’année prochaine.
A bord du Prairial, les marins de la frégate de surveillance, en semaine d’entraînement, ont marqué une pause au mouillage pour célébrer la victoire de Chesapeake en communion avec tous les marins français.
Les mots de l’amiral Vandier ont raisonné dans la baie d’Opunohu, évoquant cette illustre victoire et incitant les marins à prendre exemple sur leurs anciens. L’ancien chef d’état-major de la Marine rappelle, dans son ordre du jour, l’importance de l’entraînement, de l’innovation et de la capacité d’adaptation, éléments clés que l’équipage du Prairial s’attache à cultiver à la veille de son départ en déploiement dans le Pacifique.
Télépilote de drone : un métier qui donne des ailes
Publié le 17/09/2024
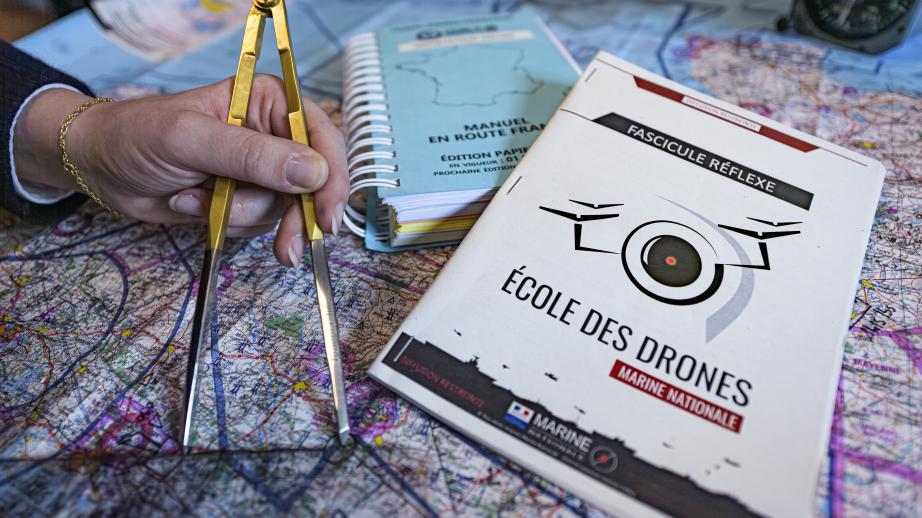








Centre de services de la donnée et de l'intelligence artificielle Marine : La Provence teste le premier data hub embarqué de la Marine
Publié le 02/02/2024
Le capitaine de vaisseau éric Herveleu, chef du centre de services de la donnée et de l’intelligence artificielle Marine (CSDIA-M) à Toulon, et les deux commandants de la Provence (équipages A et B) ont travaillé de concert sur cette expérimentation inédite

Cols bleus : à quoi sert le centre de services de la donnée et de l’intelligence artificielle Marine (CSDIA-M)?
CV Eric Herveleu :Créé en 2019, ce qui n’était à l’époque que le CSDIA-M est un outil modulaire et un centre d’expérimentation. L’objectif du CSDIA-M est aussi notre mantra : mettre en place des solutions pour obtenir une connaissance multi-champs/multi-milieux. Nous sommes le référent data pour la Marine pour ce qui concerne les architectures techniques, les techniques d’intelligence artificielle, le traitement de données et les produits de la donnée. Le rôle du CSDIA-M est de récupérer, stocker, traiter et restituer les données opérationnelles de la Marine pour des entités internes ou externes au ministère des Armées. Le CSDIA-M assure une tutelle technique et méthodologique dans la valorisation des données afin de rationaliser les efforts de la Marine. Enfin, nous réalisons des preuves de concept dans le domaine de l’intelligence artificielle, des outils d’aide à la décision utilisant les techniques de la simulation et de la recherche opérationnelle et des cas d’usage exploitant de la donnée massive.
CB : Qu’est-ce qu’un cas d’usage ?
CV E. H. : Ce sont les applications que chaque marin, chaque bâtiment, chaque force, souhaiterait avoir. Faire des cas d’usage c’est se poser sur un écosystème générique et être capable d’y convoquer certaines données et d’y mettre certains traitements. Ça c’est la théorie !
CB : Comment se traduit cette théorie dans le monde réel ?
CV E. H. : Avec les data scientists, les ingénieurs cloud, les data officers du CSDIA-M, la DGA et nos partenaires industriels, nous avons mis au point le premier data hub embarqué (DHE), que nous avons installé à bord de la FREMM Provence.
CV Lionel Siegfried (commandant de la FREMM Provence B) :
Implanter le DHE sur une FREMM à double équipage multiplie les chances de succès de la Marine : en effet, cela permet d’avoir en permanence un équipage en charge de son exploitation en opération, et un équipage en appui des développements numériques aux côtés du CSDIA-M et des industriels. L’effort est ainsi continu, et le lien permanent entre les architectes et les opérationnels.
CB : Quel est le rôle d’un data hub embarqué et de son expérimentation sur la Provence ?
CV E. H. : Le DHE vise à exploiter les données opérationnelles grâce à des solutions de data-vizualisation et des outils d’intelligence artificielle, pour fournir à l’équipage des outils performants d’aide à la décision. Ces solutions doivent être accessibles depuis les intranets embarqués voire les systèmes métiers. Un opérateur de FREMM, c’est déjà un Jean-Michel Jarre, quelqu’un qui doit composer avec plusieurs écrans. Lui en rajouter un, ce n’est pas l’aider du tout ! Il faut fédérer tout cela à travers un seul navigateur web, standardiser au maximum.
CV L. S. : L’automatisation a conduit à la numérisation des bâtiments, tandis que les réseaux ont démultiplié les accès aux données. La donnée est partout sur nos bâtiments, il s’agit maintenant de mieux l’exploiter ! Aujourd’hui les marins n’ont accès qu’à certaines données à travers une multitude de systèmes, et ils passent beaucoup plus de temps à rechercher ces données qu’à les exploiter. L’objectif du DHE est d’améliorer ce rendement pour permettre aux marins de comprendre mieux et de décider plus vite dans un monde où l’intelligence artificielle promet d’énormes gains de performances. En pratique, le DHE est un super-ordinateur qui est capable de stocker et de traiter automatiquement toute la donnée utile à travers une interface unique. Si nous parvenons à ouvrir les vannes de la donnée de nos systèmes vers le DHE, il sera alors possible de mettre un univers d’applications numériques à la portée de nos opérateurs. L’approche singulière du DHE, c’est de tout faire en parallèle : la capacité de stockage et de calcul est installée à bord avec son interface opérateur, et le développement des applications est réalisé en même temps que les travaux sur les connecteurs de données. Les marins du bord, qui sont des experts de leurs métiers, travaillent ainsi sur l’expression de leurs besoins à travers les « cas d’usage », en lien avec les experts du numérique du CSDIA-M ou les industriels. Sur la Provence, j’ai d’abord exprimé des besoins qui correspondent à du temps perdu par les opérateurs. Quelques mois plus tard, l’objectif est que les marins voient arriver les solutions aux problèmes soulevés sous forme de « patch logiciel ». C’est extrêmement encourageant et stimulant.
CB : Pouvez-vous citer des applicatifs du DHE ?
CV L. S. : Les tests ont déjà commencé sur la première version de LEVIATHAN qui constitue l’interface principale du DHE. C’est un peu comme un système d’exploitation à l’instar de Windows. Dans notre cas d’usage, il prend la forme d’un système d’information géographique qui permet d’accéder à des couches d’informations stockées dans le DHE, comme des calques de géolocalisation, des fonds cartographiques ou des outils d’aide à la visualisation. Colbert GPT est également déployé à bord de la Provence. C’est une IA générative, un Chat-GPT version militaire qui peut travailler sur des données opérationnelles sensibles comme les notes de renseignement, les rapports de fin de mission ou toute autre documentation opérationnelle accessible. L’implantation de ce type d’outil interactif est une vraie concrétisation de transformation numérique pour les marins qui retrouvent des interfaces ludiques et proches des usages civils directement sur leur système de combat. S’il est déjà possible de traduire des textes en, ou depuis des langues étrangères, il sera bientôt possible de faire du speech to text pour ne plus rien rater d’une communication radio. De manière générale, le DHE va très vite héberger toutes les applications utiles déjà en service dans les armées, et de nombreux développements d’applications ont été lancés, voire déjà livrés avec Naval Group, MBDA, THALES, le Centre d’expertise des programmes navals, et le FAN L@B. Si la donnée arrive dans le DHE, les applicatifs numériques devraient donc s’agréger très vite, en tous cas bien plus vite que les cycles d’innovation habituels portant sur le matériel.
CB : Quelle sera l’étape suivante ?
CV E. H. : Le DHE testé sur la Provence va passer en série. ALFOST s’est également montré intéressé pour demander que soit installé un DHE sur les prochains SNA. On devrait être en mesure de déployer les premiers bâtiments avec des DHE en 2025. Le passage en série est conditionné au retour d’expérience de la Provence, qui permettra de savoir si le DHE a apporté une plus-value au bateau ou non.

Un partenariat fructueux avec l’ISEN Méditerranée à Toulon
Le partenariat de la FREMM Provence avec l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique (ISEN) à Toulon est né d’un constat : l’exploitation du formidable potentiel de la donnée nécessite de développer les « cas d’usage » et cette semaine était une occasion unique de mettre en contact les équipages avec les développeurs autour de projets concrets. L’intelligence artificielle (IA) et les capacités de traitement modernes vont offrir aux équipages de nouveaux gains opérationnels. Depuis quelques mois, les marins de la Provence se préparent à cette révolution grâce aux experts du domaine – y compris dans le monde civil – pour développer notamment l’« App store » du bord au travers d’applications opérationnelles utiles à l’équipage. Selon le commandant en second de l’équipage B de la Provence, première frégate à accueillir un data hub embarqué (DHE), consacrer « l’innovation week » annuelle de l’ISEN au thème de l’exploitation de la data à bord de la Provence, participait à cette montée en gamme : « l’objectif était triple : bénéficier de propositions d’application opérationnelle de la part de jeunes ingénieurs, faire rayonner la Marine et éventuellement susciter chez eux des vocations pour participer au développement de la Marine « data centrée ». Répartie en dix groupes de travail, la promotion de Master 2 de l’ISEN Méditerranée a découvert en un temps record les capacités d’une FREMM et les contraintes opérationnelles des marins de la Provence pour répondre à des problématiques.
L’implication de la Marine a été un facteur clé du succès de cet événement : une délégation de marins de l’équipage B de la Provence, du FAN L@B, du CSDIA-M et du Pôle écoles Méditerranée ont encadré et conseillé les étudiants, en jouant le rôle de mentors. à la fin de la semaine, chaque groupe a présenté son application opérationnelle à un jury composé du commandant de l’équipage B de la FREMM Provence, du chef du CSDIA-M et du responsable de la transformation numérique de la force d’action navale. « Le résultat est très positif », se réjouit le commandant en second de la Provence B. « Les étudiants se sont impliqués avec énergie et enthousiasme, en s’appropriant une problématique à la fois originale et concrète pour eux. Ils nous ont proposé plusieurs idées très intéressantes : des applications d’aide à la décision pour la classification automatique de pistes tactiques du système de combat, pour générer des ordres de bataille, pour élaborer des compte-rendu automatiques, pour la détection automatique de pannes et la maintenance prédictive ou encore pour les réservations de zones ». à la clef, trois prix sont venus récompenser l’audace, l’efficacité et la créativité des projets. Tous se sont donnés rendez-vous à bord de la Provence pour une visite : la plus belle des récompenses pour ces futurs ingénieurs dont certains travailleront peut-être un jour pour la Marine dans le domaine de l’innovation.
Amiral Nicolas Vaujour, chef d’état-major de la Marine
Publié le 23/04/2024
Chef d’état-major de la Marine depuis le 31 août 2023, l’amiral Nicolas Vaujour a accordé un entretien à Cols bleus à l’occasion de sa prise de fonctions. Le CEMM est revenu sur un parcours riche en expériences opérationnelles, avant de partager sa vision des enjeux d’un contexte toujours plus volatil et de développer son ambition pour la Marine.

COLS BLEUS : Amiral, quels sont vos premiers mots pour les marins, militaires et civils qui servent au sein de la Marine ?
CEMM : C’est avant tout pour moi une grande fierté d’avoir été nommé dans ces fonctions par le président de la République. Je mesure l’honneur qui m’est fait de commander 42 000 hommes et femmes, militaires et civils, présents partout dans le monde, sur mer, sur terre et dans les airs. C’est une charge immense. Au moment de « prendre le quart », je dis aux marins mon engagement à continuer à servir avec détermination pour réussir la mission qui m’est confiée.
CB : Quels sont les grands jalons qui ont marqué votre vie de marin ?
CEMM : J’ai découvert la vie opérationnelle embarquée outre-mer, en Martinique, sur le Ventôse, alors tout récemment sorti des chantiers. Chef de l’équipe de visite, j’ai été engagé dans les opérations de contrôle de l’embargo de l’ONU au large d’Haïti1. Une expérience qui éduque au sang-froid et au professionnalisme.J’ai ensuite choisi de rejoindre la spécialité de détecteur et plus particulièrement le domaine de la défense anti-aérienne. Un monde où il faut décider vite, s’adapter en permanence et être agile. Le central opérations d’une frégate de défense aérienne (FDA) est une ruche, où se construit un formidable travail d’équipe, où chacun à sa place, chaque mot compte, chaque action est indispensable à l’interception de l’avion ennemi. Sans surprise, ce parcours m’a conduit à naviguer sur le Jean Bart, le Cassard, le Forbin et le Chevalier Paul.
CB : Cette vie embarquée vous a vu commander trois bâtiments à la mer.
CEMM : Oui, le bâtiment école (BE) Lion, l’aviso Commandant Birot et la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. Sur le BE, on apprend aux autres à naviguer. C’est aussi un formidable apprentissage du commandement pour un jeune officier. Sur les avisos, c’est la force de l’équipage qui nous permet de remplir les missions. La FDA, c’est un concentré de toute l’expérience de la Marine rassemblé dans un outil de combat remarquable.Ces affectations m’ont conduit à participer à de nombreuses opérations, notamment en océan Indien ou en Méditerranée orientale, souvent au sein d’un groupe aéronaval, que ce soit avec le Charles de Gaulle ou au sein de CSG2 américains, dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme international, notamment Enduring Freedom ou « Héraclès ».
CB : Vous avez également servi dans des postes à terre ?
CEMM : Les combats à terre sont probablement moins connus et plus discrets, mais tout aussi indispensables à la réussite de nos missions. J’y ai découvert une grande richesse et un profond dévouement de ceux qui y travaillent. J’ai ainsi servi à l’état-major d’ALFAN à la division entraînement, puis comme chargé du domaine « lutte au-dessus de la surface ». Plus tard, j’ai rallié Paris, d’abord comme assistant militaire du général Georgelin, puis au sein de la division cohérence capacitaire de l’état-major des armées. J’ai alors été en charge du renouvellement de la composante « frégate » de la Marine, et notamment des frégates de défense et d’intervention (FDI), dont la tête de série, l’Amiral Ronarc’h, poursuit son armement à Lorient.
Comme amiral, j’ai successivement été en charge des opérations (ALOPS), puis des relations internationales de la Marine (ALRI). Trois années très denses avec de nombreux temps marquants : l’opération « Hamilton » de frappe de rétorsion dans la profondeur en Syrie, la continuité des opérations de la Marine pendant la crise du Covid, les déploiements du GAN…
En 2021, j’ai été nommé sous-chef d’état-major « opérations » des armées. À ce titre, j’ai dirigé sous les ordres du CEMA l’ensemble des opérations des forces françaises, à l’extérieur comme à l’inté-rieur de nos frontières. Là non plus, les événements n’ont pas manqué, tant le rythme d’engagement des armées est intense. Je pense évidemment aux conséquences de la guerre en Ukraine, mais également à la réarticulation de notre dispositif en Afrique, ou tout récemment à l’opération « Sagittaire » d’évacuation de ressortissants au Soudan, qui a vu pour la Marine l’engagement de la Lorraine et des commandos Marine.
CB : Vous avez donc vu la Marine agir de l’extérieur. Qu’en retenez-vous ?
CEMM : La Marine montre chaque jour son efficacité en opérations, dans une diversité d’engagements remarquable : de la surveillance du littoral à la permanence de dissuasion nucléaire, de la police des pêches au déploiement du GAN, des pistages de sous-marins aux actions spéciales des commandos Marine. C’est une richesse incroyable. Malgré les difficultés qui ne manquent pas, la Marine agit et nous pouvons en être fiers.
Les savoir-faire développés en opérations sont précieux dans le contexte actuel. Et c’est cela l’autre enseignement de mes deux années à la tête des opérations des armées : l’imprévu devient la règle. La situation géopolitique atteint un niveau de volatilité et d’incertitude inédit. Le réarmement naval que nous constatons en mer en est un marqueur frappant. Cela nous impose d’être prêts à des engagements plus durs et exigeants, qui pourraient s’imposer à nous sans préavis et de manière brutale.
CB : Comment la Marine doit-elle se préparer pour être à la hauteur de ces enjeux ?
CEMM : La préparation au combat doit se trouver au centre de notre action collective. En ce sens, la loi de programmation militaire 2024-2030 nous donne le cap à suivre. L’effort consenti par la Nation est majeur. Les engagements votés confirment la volonté de disposer d’une Marine et d’armées fortes et cohérentes. Ils poursuivront le renouvellement des moyens par le lancement de programmes majeurs et le développement de capacités nouvelles, performantes et adaptées aux enjeux du monde. Nous avons parlé des FDI, mais je pense aussi aux patrouilleurs outre-mer, aux bâtiments ravitailleurs de forces ou aux SNA de type Suffren, dont les capacités dépassent celles des générations précédentes.
L’enjeu pour la Marine est d’exploiter tout le potentiel de ces nouveaux moyens à la pointe de la technologie, tout en poursuivant nos missions avec les moyens les plus anciens. Le rythme des opérations l’impose. Nous devons être acteurs de ce monde incertain, développer nos savoir-faire, proposer des options face aux crises que nous rencontrons. Notre ADN, c’est de faire face, de nous adapter et d’agir avec les moyens que nous avons.
Le plan Mercator dresse les lignes de force à suivre pour répondre à cette ambition. Ce plan porte la détermination du temps long pour poursuivre le renouvellement de la Marine et l’agilité du temps court pour adapter nos forces aux enjeux actuels.
Je m’inscris sans réserve dans la continuité de cette vision stratégique accélérée par l’amiral Vandier, qui a inlassablement développé l’esprit combatif de la Marine.
CB : Sur quelles forces la Marine peut- elle compter ?
CEMM : La plus grande richesse de la Marine, ce sont les marins, les équipages et l’esprit qui les anime. C’est ce qui nous permettra de poursuivre notre mission malgré les turbulences.
Notre trésor, c’est l’esprit d’équipage. Sur un bateau, un sous-marin, dans un aéronef ou dans un commando, la valeur collective vaut plus que la somme des talents individuels. La performance, l’engagement et la détermination de chacun sont indispensables au succès de la mission. Cet état d’esprit imprègne la Marine, tant à l’échelle de l’unité que de la Marine tout entière. Il importe de le consolider. Cela fonde notre excellence en opérations.
CB : Quelle consigne donnez-vous aux marins qui nous lisent ?
CEMM : Au regard du contexte et des enjeux, je demande aux marins de cultiver leurs talents et de les développer, en étant :
- prêts individuellement et collectivement ;
- combatifs, du quotidien des pontons au poste de combat en haute mer, déterminés à ouvrir des voies nouvelles pour vaincre ;
- ouverts au monde extérieur. Connaître les autres au sens large – l’autre bateau, l’autre force organique, les autres armées, les Marines partenaires – est indispensable pour vaincre ;
- audacieux, car pour réussir, il faut dépasser l’habitude et inventer de nouveaux modes d’action.
J’aime beaucoup la devise du Chevalier Paul, « Oser et vaincre ». Il faut oser pour vaincre. Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme et la détermination de chacun.
1 À la suite d’un coup d’État militaire, l’ONU met en place le 3 juin 1993 par la résolution 841 un embargo sur les produits pétroliers, ainsi que sur les armes à destination d’Haïti.
2 Carrier Strike Group : groupe aéronaval.
Le Krasnodar sous haute surveillance
Publié le 01/12/2023
La FREMM Normandie a accompagné le sous-marin russe et le remorqueur Sergey Balk au large des côtes françaises, du 18 au 20 octobre derniers, contribuant ainsi à la maîtrise des approches françaises. Ils avaient été suivis par les autorités portugaises et espagnoles depuis le détroit de Gibraltar.

La marine britannique a repris la surveillance dans la Manche. Destination finale du convoi : son port d’attache dans la Baltique.
Victoire de l'équipe féminine Marine de rugby
Publié le 01/12/2023
Après avoir remporté ensemble le championnat du monde militaire de rugby, les équipes du rugby club de l’armée de Terre (RCAT) et du rugby club de la Marine nationale (RCMN) se sont affrontées le 11 novembre à l’occasion du traditionnel challenge Foch Ronarc’h.

Lors du premier match, opposant les équipes féminines, la Marine s’est imposée 27 à 22. Sur la pelouse du stade Jean Bouin, les hommes se sont ensuite affrontés. Le match s’est terminé sous la pluie sur une égalité de 22 à 22.
Marins des débarquements, 80 ans après
Publié le 01/06/2024
L’année 1944 annonce la chute de l’Allemagne nazie. Les Alliés débarquent le 6 juin sur les côtes normandes, puis le 15 août en Provence.
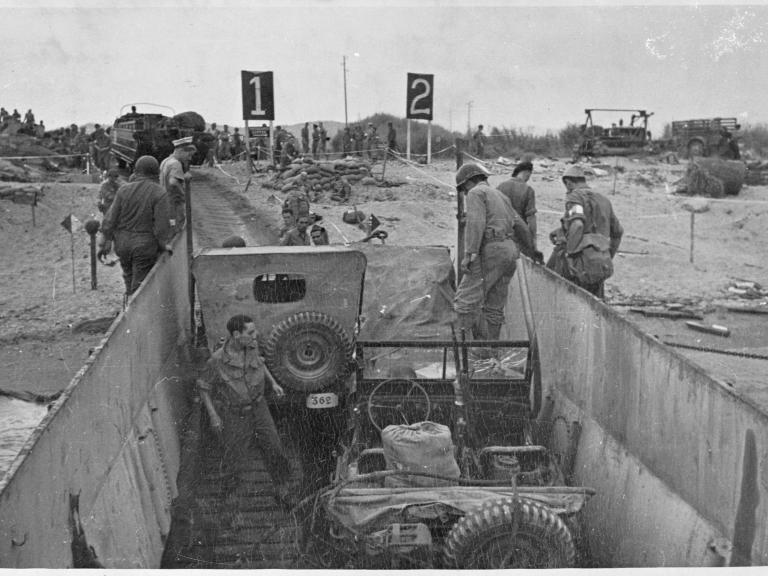
Les opérations Overlord et Dragoon vont permettre de contourner la fortification naturelle formée par les Alpes et de remporter ainsi une bataille décisive contre le IIIe Reich. 80 ans après, retour sur ces étapes historiques, parfois méconnues, qui ont pavé le chemin de la Libération du pays et continuent d’inspirer la Marine et les marins.
Peu après minuit, le 6 juin, trois divisions aéroportées touchent le sol de France : la 82e et la 101e américaines à l’ouest du front d’invasion, dans la région de Sainte-Mère-église et la 6e division britannique à l’est, sur la rive droite de l’Orne. Dans le même temps, au nord de Caen, 200 Britanniques amenés par six planeurs réussissent à prendre les deux ponts de Bénouville afin de protéger le flanc est.
Le plus grand débarquement de l’histoire
Puis, le 6 juin 1944 à l’aube, l’opération Neptune, la phase d’assaut de l’opération Overlord, commence. En quelques heures, 156 177 hommes partis du Royaume-Uni déferlent sur les côtes. Dirigée par l’amiral Bertram Ramsay, la force navale et amphibie du plus grand débarquement de l’Histoire est composée de 6 939 navires, dont 4 126 bâtiments de charge constitués en 47 convois destinés aux manœuvres de débarquement.
Intenses bombardements navals
L’escadre de combat est forte de 137 grands navires de guerre, dont sept cuirassés et une vingtaine de croiseurs. S’ajoutent à cela 221 destroyers, frégates et corvettes, 495 vedettes, 58 chasseurs de sous-marins, 287 dragueurs de mines, quatre poseurs de mines, deux sous-marins. À cette flotte gigantesque viennent s’ajouter 736 navires auxiliaires et 864 navires marchands pour le transport de vivres, munitions et pour servir d’hôpitaux flottants. Parmi les navires marchands, 54 blockships seront coulés pour former des rades artificielles. Après d’intenses bombardements, la flotte d’invasion met à l’eau les barges de débarquement. à partir de 6 h 30, en fonction de la marée, les opérations se succèdent d’ouest en est sur les plages, à Utah et Omaha d’abord, les plages américaines, puis sur les plages du secteur britannique plus à l’est, Gold, Juno et Sword. Cinq divisions sont engagées. Les Allemands, qui s’attendaient à un débarquement à marée haute, avaient hérissé l’estran d’obstacles minés destinés à détruire les barges. Mais l’opération à mi-marée rend inopérants la plupart de ces dispositifs, qui sont ensuite neutralisés. À Utah, les Américains ne rencontrent pratiquement pas de résistance. À l’est, Britanniques et Canadiens pénètrent rapidement à l’intérieur des terres.
Omaha la sanglante
Mais à Omaha, la situation est catastrophique. Les Américains se heurtent à la farouche résistance de la 352e division d’infanterie allemande. Les blindés, si efficaces sur les autres plages, n’ont pas pu aborder et les GIs sont pris sous un feu continu. La plage devient « Omaha la sanglante ». Après un nouveau bombardement naval décisif, les Américains parviennent à se dégager en début d’après-midi. Mais ils ont perdu 2 500 hommes. Au soir du 6 juin 1944, les Britanniques et les Français tiennent une bande longue de 35 km et profonde de 11 à 15 km. Lorsque le « jour le plus long » s’achève, les Alliés ont établi quatre têtes de pont. 3 500 hommes ont été tués ce jour-là, 7 300 sont blessés ou ont disparu. La seconde phase de l’opération Overlord et la bataille de Normandie peuvent commencer.
Opération Mulberry
La création de ports artificiels
« Pour débarquer autant de troupes et pouvoir les ravitailler en chars, artillerie, pétrole et vivres, il fallait des ports en eaux profondes, or Le Havre et Cherbourg n’avaient pas de plages qui se prêtaient au débarquement. Les Alliés décidèrent de construire en Grande-Bretagne deux ports artificiels qui seraient remorqués à travers la Manche jusqu’aux plages d’Arromanches et Omaha Beach. Ce dernier n’a jamais été opérationnel. Celui d’Arromanches, conçu pour durer un été, a finalement permis de débarquer 2 millions et demi d’hommes, 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de matériel et continua d’être utilisé
pendant huit mois.»
Défilé du 14 juillet 1942 à Londres. Philippe Kieffer à la tête de ses hommes
1er bataillon de fusiliers marins commandos
Dix ans de recherches ont été nécessaires pour retrouver les visages des 177 hommes du 1er bataillon de fusiliers marins commandos ayant débarqué le 6 juin 1944 sur la plage de Sword Beach. Benjamin Massieu et Jean-Christophe Rouxel retracent leurs parcours.
Cols bleus : Quel était le projet qui a donné naissance à votre livre ?
Benjamin massieu : L’idée était de permettre aux lecteurs de rencontrer les 177 hommes qui ont débarqué le jour J et, au-delà de ce jour mythique, de découvrir leurs portraits, leurs itinéraires personnels, et comprendre l’aventure humaine que cela a été.
C. B. : Avez-vous pu rencontrer les familles des hommes du commando Kieffer ?
B. M. : Oui bien sûr, nous sommes en contact avec beaucoup d’entre elles. C’est à chaque fois touchant lorsque nous leur faisons découvrir un pan de leur histoire familiale. Certains avaient jeté un voile sur leur participation au Débarquement, je pense notamment à Paul Mariaccia. Sa femme et ses filles n’ont appris sa participation qu’en 2004, quand son neveu a trouvé par hasard son nom dans la liste des 177.
C. B. : Pourriez-vous nous présenter l’un des 177 ?
B. M. : Georges Bouchard vit avec son père en Colombie lorsqu’il apprend la défaite de 1940. À quinze ans, il fugue pour aller se battre et libérer sa mère et sa sœur restées en France. à Bogota, il prend un chalutier pour l’île de Sainte-Lucie où il embarque sur un convoi qui l’emmène jusqu’en Angleterre, en pleine guerre de l’Atlantique. Là, trop jeune pour s’engager, les Britanniques télégraphient à son père qui en réponse, accepte de l’émanciper. Il s’engage dans la Marine avant de rejoindre les commandos en novembre 1943 jusqu’à la fin de la guerre.
Le 7 juin prochain, à Ouistreham, des stagiaires des préparations militaires Marine, venus de toute la France, porteront les 177 portraits des hommes du commandant Kieffer à l’occasion des cérémonies commémoratives.
Dans la nuit du 26 au 27 février 1944, le lieutenant de vaisseau Charles Trépel commande un raid de reconnaissance sur les côtes néerlandaises, avec sept de ses hommes. Prévu depuis plusieurs mois, celui-ci doit renseigner les Alliés sur les défenses allemandes. Aucun des commandos débarqués n’est revenu à bord.
La rutilante MTB 682, navire de guerre britannique, fend la mer en direction de la plage de Wassenaar, huit kilomètres au nord de Scheveningen, sur la côte néerlandaise. À son bord se trouvent le lieutenant de vaisseau Trépel, le second maître Hagneré et les quartiers-maîtres Rivière, Cabanella, Guy, Devillers, Lallier et Grossi. Tous font partie du 1er bataillon de fusiliers marins (BFM) dirigé par Philippe Kieffer. Ils ont quitté les côtes britanniques dans l’après-midi, pour participer à l’opération Premium. Leur objectif : repérer une usine dans laquelle les Allemands construisent des fusées destinées à être lancées sur Londres, et se renseigner sur leurs défenses. C’est la seconde fois qu’ils entreprennent ce raid. Trois jours plus tôt, ils ont dû faire demi-tour à cause d’un incident technique. Trépel est déterminé. En décembre, son raid sur Berck-plage, destiné à évaluer les défenses de l’ennemi et le tromper sur un éventuel lieu de débarquement, a lui aussi été annulé car jugé trop périlleux. Persévérant, il est parvenu à convaincre les autorités britanniques de lui confier ce nouveau raid. Cette fois, rien ne pourra le faire dévier de sa trajectoire.
Premiumlost no news
La vedette arrive sur site avec deux heures de retard. Les hommes partent vers la côte sur un doris (embarcation légère d’environ 3 à 6 mètres, à fond plat, propulsée à la rame) contenant un radeau. Soudain, des fusées rouges en provenance de la rive illuminent le ciel. À 30 mètres de la plage, les commandos montent dans le radeau et s’éloignent vers le rivage. Trois nouvelles fusées sont tirées. Les quartiers-maîtres Lallier et Grossi, restés dans le doris, attendent leur retour. Tout à coup, des aboiements et des cris couvrent le clapotis des vagues. Il est 4 h 30 et les six commandos devraient déjà être rentrés. Ordre de patienter une demi-heure. Les fusées continuent d’éclairer la nuit et des éclats de torches électriques parcourent le ciel. À 5 h, le doris rejoint la vedette. Les six commandos ne rentreront jamais. À Londres, le raid est classé ainsi : Premium lost no news*.
Fausse identité
Le 24 mai 1945, l’enseigne de vaisseau de première classe Mazeau émet un rapport annonçant les pertes du 1er bataillon de fusiliers marins commandos et les recherches infructueuses pour repérer les six disparus. À la Libération, leurs corps sont finalement retrouvés, ils ont été enterrés comme aviateurs alliés inconnus. Dans son rapport d’enquête, l’EV1 Hulot précise que « tous portent sur leur visage l’expression d’avoir terriblement souffert ». Ont-ils été saisis par le froid en voulant regagner le rivage ? Étaient-ils attendus par l’ennemi ? Leur disparition demeure, encore aujourd’hui, un mystère.
* Premium a disparu, aucune nouvelle
Trépel dans les mémoires
« Modèle de l’officier commando, Charles Trépel est une personnalité qui inspire toujours le commando, même de nos jours, affirme le capitaine de corvette Benoît, commandant du commando Trépel. Je fais souvent référence à son dernier raid car il force l’humilité, précise-t-il. Plutôt que d’en tirer des leçons, souvenons-nous de ce que cette opération nous enseigne. Aurions-nous fait différemment aujourd’hui ? Non. L’issue de ce raid est un rappel à l’ordre : il ne peut y avoir de succès tactiques et stratégiques sans prise de risques. »

Carte du raid de Wassenaar

Opération Dragoon en Provence, la liberté vient de la mer
Le débarquement de Provence fut avant tout une volonté française. Churchill était opposé à cette opération car il considérait qu’il fallait continuer en Italie ou dans les Balkans. De Gaulle a réussi à l’imposer pour des raisons de politique intérieure et de restauration de la souveraineté française.
A l’aube du 15 août, trois divisions américaines commandées par le général Patch, suivies le lendemain par les trois divisions françaises du général de Lattre de Tassigny, sont débarquées entre Hyères et Cannes. Elles sont appuyées sur les arrières de l’ennemi par le parachutage d’une division anglo-américaine, et sont précédées par des raids commandos nocturnes. Il s’agit de prendre pied en Provence pour remonter par la vallée du Rhône, ce qui permettra d’opérer la jonction avec les forces débarquées en Normandie, et à terme de couper l’Allemagne des ports atlantiques. La participation française à Dragoon est considérablement plus importante que pour Overlord : à terre, il y a quasi-parité avec les Américains, avec la 1re armée française qui comprend notamment le 1er régiment de fusiliers marins. Deux des trois forces commandos sont françaises, dont le groupe d’assaut naval de Marine Corse du commandant Seriot. Sur mer, on compte 34 navires de guerre français, presque le triple de ce qui était présent pour Overlord, dont le cuirassé Lorraine et six croiseurs qui assurent l’appui-feu.
Victoire éclair en Provence
En supériorité numérique et matérielle, les Alliés progressent beaucoup plus vite que prévu. Le 19 août, les Allemands se replient vers la vallée du Rhône, à l’exception des places de Marseille et Toulon qui ont ordre de tenir jusqu’au bout. Ces dernières se rendent le 28 aux troupes françaises, alors que les Anglo-Américains atteignent les rives du Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence. L’opération Dragoon, planifiée sur deux mois, a atteint ses objectifs en deux semaines. Mieux encore, la nouvelle du repli allemand a été un des éléments déclencheurs de l’insurrection parisienne du 19 août. Le 12 septembre, les forces alliées débarquées en Provence et en Normandie effectuent leur jonction à Nod-sur-Seine, en Côte-d’Or.
Une unité retrouvée dans le combat
Pour la Marine nationale, le débarquement de Provence fait acte de réunification entre les éléments séparés voire dressés les uns contre les autres par la défaite de 1940 : FNFL de Grande-Bretagne ou ralliés depuis l’empire colonial, ceux de la force X internés à Alexandrie, la marine d’Afrique du Nord sous contrôle de Vichy jusqu’en 1942, et même les marins engagés dans les forces françaises de l’intérieur. Ayant pris, volontairement ou contre leur gré, des chemins différents quatre ans plus tôt, ils se trouvent maintenant réunis en force sur les côtes varoises pour reconquérir le sol métropolitain, notamment Toulon, d’importance tant stratégique que sentimentale pour la Marine.
Le débarquement oublié
Pendant longtemps, c’est le débarquement de Provence et non de Normandie qui s’est trouvé au centre du discours mémoriel, en raison d’une participation française plus marquée. Pour le vingtième anniversaire, en 1964, le général de Gaulle privilégie ainsi l’inauguration du mémorial du Mont-Faron et ne se rend pas sur les plages de Normandie. Mais bien vite, Overlord prend le dessus dans la mémoire publique, que ce soit dans la culture populaire, l’enseignement scolaire et même les hommages nationaux. Lié directement à la libération de la capitale, fortement valorisé à l’international par le cinéma américain à partir des années 1960, le débarquement de Normandie a aussi, dans le contexte de la Guerre froide, l’avantage sur celui de Provence d’impliquer de nombreux pays désormais membres de l’alliance atlantique et de la communauté européenne. Néanmoins, la mémoire du débarquement de Provence reste vive localement. Elle est redynamisée sur le plan national à partir du cinquantenaire en 1994, notamment sous l’angle des combattants africains de la 1re armée.

Marins des débarquements
André-Georges Lemonnier, capitaine de corvette Hubert Amyot d'Inville, groupe naval d'assaut
Vétéran des deux guerres mondiales, ayant participé aux deux débarquements de 1944, l’amiral André-Georges Lemonnier est né le 24 février 1896 à Guingamp. A l’âge de 17 ans, il est admis à l’École navale en 1913 et en sort major de promotion. Dès la Première Guerre mondiale, il sert à bord de divers navires et sous-marins. Capitaine de frégate en 1933, il prend le commandement du contre-torpilleur Le Malin. En 1940, il est capitaine de vaisseau et commande le croiseur léger Georges Leygues.
Après l’armistice, il reçoit l’ordre de rejoindre Libreville, mais se retrouve bloqué à Dakar. Il se rallie au général de Gaulle en novembre 1942 qui le nomme chef d’état-major de la Marine en juillet 1943.
En Normandie …
L’amiral Lemonnier dirige dès 1943 les opérations navales de la libération de la Corse puis s’emploie à réconcilier les marins de l’armée d’armistice et ceux des FNFL. « Un seul principe nous guidait : nous voulions que nos navires fussent au premier rang, à l’heure de l’assaut », écrit l’amiral dans son ouvrage Paisible Normandie. Lors du Débarquement, l’état-major allié avait prévu d’inclure seulement quelques bâtiments français légers. Lemonnier réussit à convaincre le First Sea Lord d’accorder une place plus importante à la Marine française. Une dizaine de navires français seront du D Day dont le Georges Leygues et le Montcalm.
… comme en Provence
À la tête de l’escadre française en tant qu’adjoint de l’amiral américain Hewitt, André-Georges Lemonnier est directement impliqué dans le débarquement de Provence, le 15 août 1944. « Le choix de la zone d’assaut ne demande pas de longues études…, détaille l’amiral français dans Cap sur la Provence, récit qu’il fit du débarquement de 1944. Il ne reste qu’un secteur convenable : la région de Saint-Tropez – Saint-Raphaël […], la décision est vite prise. » Lemonnier entre dans le port de Toulon le 13 septembre à bord du Georges Leygues, accompagné du reste de l’escadre française. Au lendemain du conflit, il occupera les fonctions de directeur du Collège de défense de l’OTAN et d’adjoint naval du général Eisenhower au grand quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE). Secrétaire perpétuel de l’Académie de Marine, il termine sa carrière en 1956 au grade d’amiral et s’éteint à Cherbourg le 30 mai 1963 à l’âge de 67 ans.
Le 10 juin 1944, au volant de sa Jeep, le capitaine de corvette Hubert Amyot d’Inville, commandant du 1er régiment de fusiliers marins (RFM), file sur les routes en direction de Montefiascone, ville italienne à 80 kilomètres au nord de Rome. Il n’atteindra jamais la ligne de front. Son véhicule saute sur une mine, et il meurt sur le coup. Il avait 35 ans. Cet ancien capitaine au long cours de la Marine marchande est incorporé, en 1940 comme enseigne de vaisseau de réserve. Il prend le commandement du dragueur de mines La Trombe avec lequel il participe à la bataille de Dunkerque. Son navire y est coulé. Il en réchappe et réussit à rallier Londres pour s’engager dans les forces navales françaises libres (FNFL). Affecté au 1er bataillon de fusiliers marins (BFM), il est présent à Dakar lors des affrontements qui opposent la marine britannique et quatre navires des FNFL à des troupes du gouvernement de Vichy. Lors de la campagne de Syrie en juin 1941, son commandant, le lieutenant de vaisseau Détroyat, est tué. Amyot d’Inville lui succède. Il mène ses hommes lors des batailles de Bir Hakeim et d’El-Alamein en 1942, puis pendant la campagne de Tunisie en 1943. Désormais capitaine de corvette et à la tête d’un régiment (le 1er BFM est devenu le 1er RFM), il s’engage dans son ultime campagne en Italie. 80 ans plus tard, la Fondation de la France Libre lui a rendu hommage en faisant installer, lors d’un voyage mémoriel le 19 mai 2024, une plaque commémorative à l’endroit où il est tombé. Les autorités françaises, italiennes ainsi que l’amicale nationale des fusiliers marins étaient présentes. Sa mémoire perdure aussi à travers le bataillon de fusiliers marins basé à Brest qui porte son nom depuis 2020.

Le plus jeune, Pierre Dourous, venait d’avoir 20 ans. Son chef, le capitaine de corvette Géraud Marche, en avait 39 : commandant du groupe naval d’assaut de Corse, il avait été officier des sports à l’École navale. Avec son équipe de rugby, il avait même raflé le titre de champion de France de la Marine. Le 15 août 1944 à minuit quinze, tous deux sautent sur des mines allemandes dissimulées dans la roche ferrugineuse de la pointe de l’Esquillon. Un décor paradisiaque pour un scénario de film d’horreur. Sur les 67 hommes du commando, onze sont tués sur le coup, des dizaines laissés dans un état grave et de nombreux hommes faits prisonniers.
Tous volontaires, ils appartenaient au groupe naval d’assaut créé en 1943 par le contre-amiral Robert Battet pour collecter des renseignements, en particulier sur les côtes italiennes. Il incombe au groupe de débarquer personnel et matériel, de nuit, sur des radeaux pneumatiques. En ce 15 août, leur but est de se frayer un passage au travers des défenses allemandes et de gagner la corniche d’or (route nationale 98) proche et la route nationale 7 distante, elle, de plus de cinq kilomètres. Ces deux voies sont vitales : il faut empêcher les Allemands de gagner Saint-Raphaël et Fréjus, où la 36e division d’infanterie américaine va débarquer. Malheureusement, la mission se solde par un échec.
Dans le Cols bleus n° 363 du 28 août 1954, l’un des survivants, l’ingénieur mécanicien en chef Chaffiotte, avait décrit la mission très périlleuse de ces marins ayant mis un pied sur la côte varoise, avant toutes les autres unités débarquées : « Le 14 août, nos vedettes stoppaient à 1 500 mètres dans le sud du Trayas, à l’ouest de Cannes […] Nous étions fiers d’être les premiers à reconquérir le sol de notre pays. […]. La première route à atteindre était environ à deux cents mètres. La progression se faisait silencieuse, rapide. Déjà, l’officier en tête de la colonne, l’ORIC (officiers de réserve interprète et du chiffre, NDLR) Auboyneau avait parcouru une centaine de mètres, quand il sauta sur une première mine. »
80 ans plus tard, Paul Meyere a voulu « mettre un visage sur les noms inscrits dans la stèle érigée au-dessus de la calanque des deux frères à Théoule ». Aidé de Benoît Senne, ancien commando Marine, et de Paul Catania, il a contacté une quarantaine de familles de vétérans ou de marins disparus. Un ouvrage devrait bientôt paraître en hommage à ces hommes morts pour la France.

Après la plage, objectif Berchtesgaden, finir la guerre
Le 8 mai 1945, l’Allemagne capitule. Un résultat obtenu moins d’un an après les débarquements grâce à de très nombreux exploits militaires, auxquels les unités de la Marine ont pris part. Cols bleus les remet en lumière, rappelant ainsi le courage et la valeur de ces marins, qu’ils soient issus des Forces navales françaises libres (FNFL), de la Marine de l’armée d’armistice ou des Forces françaises de l’intérieur (FFI)
Le 1er régiment de fusiliers marins (1er RFM)
« L’officier des équipages Colmay, avec ses mitrailleuses, disperse les allemands qui, enhardis, se risquent sur la route. Il n’a pas trente hommes en tout. Tant pis, il tiendra son carrefour héroïquement jusqu’à la nuit. Il tiendra malgré l’ordre de repli du commandant ». Cet extrait de l’article de L’EV Guillemin paru dans le Cols bleus n° 34 du 12 octobre 1945 relatant la libération d’Autun (71), illustre l’état d’esprit des marins du 1er RFM. Débarqué le 16 août à Cavalaire (83), le régiment, après avoir vaillamment participé à la reprise de Toulon, n’a pas connu d’engagement sérieux depuis. Les 6, 7 et 8 septembre, la mission du 2e escadron est, avec le concours d’unités de l’armée de Terre et d’un groupe de FFI, d’intercepter à Autun une colonne allemande de 4 000 hommes. Constitué dès 1940 à Londres, le 1er RFM a été de tous les combats de la France libre avant de mener ceux de la libération de l’Hexagone. Après Autun, ce seront les durs combats dans les Vosges et en Alsace. Envoyé sur l’Atlantique pour participer à la réduction de la poche de Royan, le 1er RFM est rappelé d’urgence en Alsace pour parer à la contre-attaque allemande de décembre 1944. Enfin, en avril 1945, il participe aux combats du massif de l’Authion dans les Alpes du Sud où s’est retranché l’ennemi. Le régiment est l’une des trois unités FNFL à avoir été fait Compagnon de la Libération.
Le 1er bataillon de fusiliers marins commandos (1er BFMC)
Placé sous les ordres de Philippe Kieffer, il est créé au printemps 1942. Avant le Débarquement de Normandie, le 1er BFMC est intégré au commando n° 4 appartenant à la Special Service Brigade commandée par Lord Lovat. Après leur emblématique débarquement sur Sword Beach le 6 juin 1944, ils combattent dans la campagne normande jusqu’au 27 août. à cette date, seuls 24 hommes sur 177 sont indemnes. En novembre, ils reprennent la lutte lors de la bataille de l’Escaut qui vise à libérer le port d’Anvers. Avec le commando n° 4, dont Philippe Kieffer est maintenant le commandant en second, ils débarquent sur l’île néerlandaise de Walcheren et y neutralisent l’ennemi. Les sept commandos Marine actuels sont les héritiers du 1er BFMC dont ils ont repris l’iconique béret vert.
Le régiment blindé de fusiliers marins (RBFM)
Créé en octobre 1943 en Afrique du Nord, le RBFM est principalement constitué de marins de l’armée d’armistice d’Afrique du Nord, renforcés par des recrues. Il est équipé de chasseurs de char M10 Wolverine, de scout cars M3A1 et de Half-Track. Il est intégré à la 2e division blindée (2e DB) du général Leclerc et débarque en Normandie en août 1944. Premiers combats dans les secteurs d’Alençon et Argentan (61). Puis ce sera la libération de Paris où, sous les yeux de Parisiens médusés, l’un des Wolverine touche à deux reprises, depuis le haut des Champs, un char ennemi embusqué place de la Concorde (soit 1 800 mètres), un exploit pour l’époque. Les marins avaient remplacé les lunettes de visée d’origine de leur char par celles de canons de Marine. Après la capitale, le RBFM poursuit son aventure avec la 2e DB : Dompaire, Baccara, les Vosges, Strasbourg, la dure bataille d’Alsace. Un retour en arrière pour liquider la poche de Royan et enfin l’Allemagne avec la ruée vers Berchtesgaden. Parmi les marins du RBFM, figurait un certain Philippe de Gaulle, alors enseigne de vaisseau, décédé en mars dernier, et le second maître fusilier marin Jean-Alexis Moncorgé, chef du char Souffleur II, plus connu sous son nom de scène : Jean Gabin.
La flotte française
Une fois la protection des convois et l’appui feu des débarquements effectués, la flotte française ne reste pas inactive. En Méditerranée, la flank force affronte les dernières unités de la Kriegsmarine dans le golfe de Gêne et bombarde la côte italienne où l’ennemi s’est retranché. À l’ouest, afin d’en interdire l’utilisation aux Alliés et de continuer la lutte, des milliers d’Allemands se sont retranchés dans plusieurs ports. Ces zones prennent le nom de poches de l’Atlantique. Cinq seront reprises avant octobre 1944 à un prix exorbitant. Pour les autres, il est décidé d’en faire le siège. Il faut empêcher l’ennemi de nuire depuis ces poches. La flotte française va en assurer le blocus. En avril 1945, l’assaut de la poche de Royan et de l’île d’Oléron est ordonné par le gouvernement français. Le bataillon de fusiliers marins FFI de Rochefort appuyé par 10 navires français, des aéronefs de l’aéronautique navale, ainsi que le régiment de canonniers marins, constitué en Afrique du Nord et ayant rallié l’Hexagone en octobre 1944, participent aux combats. Les dragueurs de mines entament pour leur part le déminage des eaux du littoral, une tâche encore inachevée à ce jour. Enfin, dans l’IndoPacifique, le cuirassé Richelieu, intégré à une force navale britannique, combat les Japonais.
Les FFI de la Marine
Lorsque les Alliés libèrent l’Hexagone, bon nombre de marins démobilisés en 1940, après le sabordage de Toulon ou encore de l’armée d’armistice, forment ou rejoignent des unités FFI avec l’idée d’en découdre avec l’ennemi. C’est le cas pour l’École navale de la Marine de Vichy réfugiée à Clairac (47) au nord d’Agen ou encore de l’école d’apprentissage de la direction des constructions et armes navales (DCAN), réfugiée quant à elle à Jausiers (04) au fond de la vallée de l’Ubaye. Ailleurs, les anciens marins se regroupent et forment spontanément des unités : bataillon de fusiliers marins de Rochefort, bataillon de marche de Lorient, bataillon de marche du Finistère, bataillon de fusiliers marins de Dunkerque, etc. Face à ce foisonnement, le ministre de la Marine du gouvernement provisoire, Louis Jacquinot, décide de les regrouper sous un commandement unique en créant le 4e régiment de fusiliers marins. Le temps manquera pour toutes les amalgamer mais elles participent aux sièges et à l’assaut des poches de l’Atlantique restantes, permettant ainsi aux unités régulières de foncer vers l’Allemagne.
80 ans du débarquement en Normandie - Devoir de mémoire
Publié le 01/07/2024
La mémoire était vive les 4, 5, 6 et 7 juin 2024 pour les commémorations des 80 ans du Débarquement. Dans le public, venu nombreux et parfois de très loin, on entendait parler français et anglais, comme le Jour J sur les plages de Normandie. Vétérans, enfants, fusiliers marins, lycéens, retraités, matelots, chefs d’État, civils et militaires, tous s’étaient donné rendez-vous afin de rendre hommage aux hommes qui débarquèrent le 6 juin 1944, sous le feu ennemi, pour libérer le pays enchaîné par les forces nazies depuis 1940.

En mer, sur terre et dans les airs, les marins ont répondu présents sur l’ensemble des cérémonies pour honorer la mémoire, transmettre et célébrer la liberté.
Marins de combats - Cap sur les Jeux
Publié le 01/07/2024
Ils sont treize. Treize sportifs de haut niveau, du judo à la voile, du kitesurf au canoë (ici, la céiste Eugénie Dorange, à Toulon avec l’équipage de la FREMM Alsace, le 18 juin dernier), représentant fièrement la Marine nationale à laquelle ils appartiennent. De Paris à Tahiti, ils défendront les couleurs de la France aux Jeux de la xxxiiie olympiade du 26 juillet au 11 août 2024. Grâce au centre national des sports de la défense, le tandem armées-fédérations participe à l’effort national.

L’armée de champions
Il était une fois... le bataillon de Joinville
Onze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une unité de l’infanterie baptisée « Bataillon de Joinville » voit le jour dans l’ancienne École normale militaire de gymnastique de Joinville-le-Pont. Ce n’est pas anodin. La France qui a pris en 1948 la tête du conseil international du sport militaire (CISM) prône le sport comme ferment de paix.

Alors que la plupart des jeunes Français sont tenues de faire leur service militaire, l’unité propose aux meilleurs athlètes du pays, dès 1956, de poursuivre leur entraînement sportif dans un cadre militaire. Les fédérations sportives y voient un fantastique tremplin pour leurs futurs champions. Tout en remplissant leurs obligations militaires, les jeunes sportifs bénéficient de conditions optimales (encadrement technique de qualité, entraîneurs civils performants, cadres militaires qualifiés et émulation avec la présence des meilleurs athlètes). À partir de 1967, le bataillon se délocalise au sein de l’École interarmées des sports de Fontainebleau sur le camp Guynemer. 54 fédérations délégataires y envoient de 450 à 550 jeunes athlètes.
Une pépinière de champions
Les champions passés par le bataillon de Joinville sont légions : le cycliste Jacques Anquetil, le footballeur Michel Platini, le vainqueur de Roland Garros Yannick Noah, le lutteur Ghani Yalouz, le judoka David Douillet, l’escrimeur Jean-François Lamour ou encore le perchiste Jean Galfione.
En 2002, fin de la conscription : fin de l’histoire ? L’idée avait trop de qualités pour ne pas survivre. Douze ans plus tard, le Bataillon renaît de ses cendres sous une appellation modernisée et sans équivoque : l’armée de Champions. Officiellement École interarmées des sports, elle chapeaute alors 118 athlètes valides et 15 para sportifs, dans 21 disciplines. Elle est divisée en deux compagnies : d’un côté, les disciplines estivales regroupant 22 fédérations sportives au sein de l’École interarmées des sports, de l’autre les disciplines hivernales au sein de l’équipe de France militaire de ski. Sous contrat avec les armées, ils dépendent du centre national des sports de la défense (CNSD), sorte de Prytanée sportif, à la fois siège administratif et lieu de rencontres ouverts sur l’Agora représentée par la « Place d’armes des Joinvillais » du camp Guynemer de Fontainebleau.
En 2019, deux ans après que Paris a officiellement obtenu l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le CNSD signe un protocole de soutien à l’événement. Ce protocole voit plus loin que les Jeux, il entend poser les jalons d’une collaboration étroite, dans la durée, entre les ministères des Armées et de l’Intérieur (gendarmerie nationale) et le mouvement sportif. L’État s’engage à soutenir l’innovation dans les secteurs de la recherche, du développement et du handicap en particulier.
Un palmarès élogieux
Depuis la création du bataillon, les 20 500 athlètes du contingent ont rapporté 45 médailles olympiques, 312 titres mondiaux civils ou militaires et 952 titres nationaux ou internationaux. Ce palmarès fait de lui un fabuleux ambassadeur de la France aux quatre coins du monde, dans la francophonie et au delà. En 2024, ce sont plus de 220 sportifs de haut niveau qui se sont engagés, parmi lesquels le maître Charline Picon (Marine nationale) avec une cinquième participation aux JOP de cette année, les nageurs Alain Bernard et Hugues Dubosc (gendarmerie nationale), Martin Fourcade (biathlon, armée de Terre), ou encore la double médaillée olympique Clarisse Agbegnenou (gendarmerie nationale). La dynamique lancée il y a près de 65 ans n’est pas prête de s’essouffler.
Dans le sillage du…
Commandant Erwan Lebrun, chef du bataillon de Joinville
Cols bleus :En quoi consiste votre rôle à la tête du bataillon de Joinville ?
Commandant Erwan Lebrun : Il est proche de celui d’un commandant d’unité. Je commande les sportifs de haut niveau de la défense (SHND), d’un point de vue administratif, et je dois leur fournir une formation militaire adaptée, sur la phase d’incorporation et tout au long de leur engagement.
C. B. :Quels sont les prérequis pour ce poste ?
CDT E. L. : Connaître le sport militaire et le mouvement sportif français pour naviguer d’une sphère à l’autre. Nous devons faire comprendre au sportif qu’il est militaire, et aux militaires que les sportifs sont en quête de performance et doivent tout mettre en œuvre pour y parvenir. Lors des Jeux, la planification d’entraînement est très fine. La moindre sollicitation extérieure peut perturber la performance, à l’instar d’un soldat qui se prépare à aller en opération militaire. Leur métier, comme celui du militaire, est d’être prêt physiquement pour être performant sur leur mission : la compétition.
C. B. : Comment préparez-vous cette armée de Champions ?
CDT E. L. : Le bataillon de Joinville ne les prépare pas physiquement, ce n’est pas notre mission. Nous sommes là pour les accompagner, travailler sur l’entraide, l’esprit d’équipage, le dépassement de soi. Pendant nos stages de formation militaire, nous les mettons dans une situation parfois inconfortable pour qu’ils réussissent à transposer leurs qualités lorsqu’ils en auront besoin. L’objectif est de les sortir de leur zone de confort, en jouant sur la qualité d’hébergement, le rythme, le sommeil, l’alimentation.
C. B. : Quelles disciplines allez-vous suivre pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ?
CDT E. L. : Dans le cadre de ma mission, je vais suivre bien entendu l’ensemble des sportifs de haut niveau. D’un point de vue plus personnel, en tant que judoka et directeur des équipes de France militaires de judo, j’aurai forcément un regard attentif sur cette discipline qui reste mon sport de prédilection !
Gardiens de la flamme
Sécuriser le symbole des Jeux
Leur présence est inséparable de la flamme olympique. Parmi une centaine de gardiens sélectionnés pour cette mission (armées, police nationale, gendarmerie nationale et sécurité civile) trois appartiennent à la Marine nationale : les premiers maîtres Erwan et Nicolas et le second maître François assurent la sécurité et l’intégrité de la flamme sur différents tronçons du parcours. Chargés de recharger les lanternes, ils soutiennent surtout les différents porteurs de flamme lors du relais. Des hommes de l’ombre.
Leur mission a débuté au stade panathénaïque d’Athènes, lors de la cérémonie de passation de la flamme olympique de la Grèce à la France, le 26 avril 2024. Le lendemain, les gardiens embarquent avec la flamme, qui devient la 65e passagère du Belem. Direction Marseille. Durant la traversée, le premier maître (PM) Erwan et le second maître (SM) François sont aux petits soins du feu sacré. Toutes les huit heures, ils se relaient pour lui « donner le biberon, non pas à base de lait, mais de 50 millilitres de paraffine liquide ». Afin d’éviter qu’elle ne s’éteigne ou ne provoque des incendies à bord, elle est conservée dans une lanterne dont le modèle souffle sa trentième bougie cette année. Celle-ci est équipée d’un filtre à particules à nettoyer régulièrement, en plus de la suie qui s’accumule sur les vitres. Sa mèche doit, quant à elle, être changée tous les quinze jours. Émettant une chaleur pouvant atteindre 60° C, la lanterne est transportée dans une boîte en plexiglas dotée d’une poignée en plastique. Plutôt que de la conserver en permanence dans la même pièce, les gardiens de la flamme l’ont déplacée un peu partout sur le Belem : « Nous voulions rendre accessible l’image de la flamme, permettre à l’équipage de la voir au quotidien et de prendre des photos avec », explique le SM François. Le feu sacré a donc exploré les cuisines, découvert l’atelier du charpentier avant de grimper au sommet du mât. Entre deux promenades de leur protégée, les marins s’impliquent aussi dans la vie à bord. Tous deux moniteurs EPMS (entraînement physique militaire et sportif), ils ont organisé des séances sportives chaque après-midi rassemblant aussi bien les membres de l’équipage, les 16 jeunes du programme d’insertion de la Caisse d’Épargne que les journalistes embarqués. Une fois arrivés à Marseille le 8 mai, les gardiens relatent lors de leur RETEX (retour d’expérience) les difficultés rencontrées dans l’entretien quotidien de la flamme. Un document précieux qui servira à leurs successeurs sur les prochains tronçons, comme le PM Nicolas.
Un dispositif sécuritaire sur mesure
5e dan de karaté, ce chef de secteur au centre du service militaire volontaire de Brest a d’abord été gardien de la flamme entre Poitiers et Brest du 25 mai au 7 juin et le sera de nouveau entre Lille et Paris du 2 au 26 juillet. Avec le PM Erwan et le SM François, il fait partie des 17 militaires sélectionnés pour ce rôle en 2023 en raison de leur engagement sportif aussi bien dans la vie civile que militaire. Les gardiens ont ensuite suivi en novembre un séminaire au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sur leurs rôles dans le dispositif des convois escortant les porteurs de la flamme. « La plus importante formation a eu lieu en mars 2024 à Troyes pendant une semaine. Nous avons simulé un parcours de la flamme passant par Nogent-sur-Seine et Romilly avec l’ensemble du convoi composé des porteurs de flamme, de bus, de véhicules de gendarmerie et de CRS. » Dans ce dispositif, un gardien se tient en permanence aux côtés du porteur pour réagir à une éventuelle chute ou un malaise de ce dernier. Si la torche olympique venait à s’éteindre, un second gardien est présent à proximité avec une lanterne de secours contenant elle aussi le feu sacré afin de la rallumer. Les gardiens de la flamme jouent donc un rôle vital dans la préservation du symbole des Jeux jusqu’à sa destination finale à Paris, le 26 juillet. Elle servira alors à allumer la vasque olympique qui illuminera la Ville lumière pour la durée des épreuves.

Johanne Defay surfeuse
Portraits de champions
Ils sont treize. Treize sportifs de haut niveau, du judo à la voile, du kitesurf au canoë (ici, la céiste Eugénie Dorange, à Toulon avec l’équipage de la FREMM Alsace, le 18 juin dernier), représentant fièrement la Marine nationale à laquelle ils appartiennent.
Maître Charline Picon (49er FX)
La championne se réinvente
L’or à Rio, l’argent à Tokyo, les jeux de Paris sont riches de promesses pour Charline Picon. Enfant, elle commence la planche à voile en 1995 à la Tremblade où les odeurs d’iode se mêlent à celle des pins. Depuis, la véliplanchiste a (tout) raflé : un titre mondial en 2014, cinq titres européens entre 2013 et 2021 et deux podiums olympiques en 2016 et en 2021. Cet été, elle revient avec un nouveau défi : l’athlète change de discipline pour concourir dans la catégorie de dériveur 49er FX, où elle sera en binôme avec Sarah Steyaert. Pas question de se reposer sur ses lauriers, le challenge est de taille pour cette quatrième participation olympique !
Cols bleus : Participer aux Jeux Olympiques en France, dans votre pays, était-ce un rêve pour vous ?
Charline Picon : Vivre les jeux à la maison a fortement pesé dans la balance après Tokyo. Les jeux en France c’est une opportunité unique dans la carrière d’un athlète. Donc oui un rêve, et il fallait monter un projet pour pouvoir le vivre.
C. B. : Le 49er FX est une discipline en équipage, jusqu’ici votre sport était la planche à voile. Le fait d’être deux, représente- t-il un challenge supplémentaire ?
C. P. : C’est clairement le plus gros challenge : apprendre à communiquer, puis communiquer efficacement.
C. B. : Avez-vous eu l’impression d’apprendre un nouveau sport ?
C. P. : Oui complètement ! Le vent, les parcours restent identiques mais techniquement c’est un autre sport, même les noms des bouts sont différents.
C. B. : Depuis quand et comment vous préparez-vous pour ces JO ?
C. P. : En septembre 2021, j’ai contacté Sarah Steyaert pour voir si elle était d’accord pour sortir de sa retraite sportive et partir sur ce projet fou. Après un premier test on a signé. Il a fallu d’abord apprendre la technique de ce bateau très exigeant par son instabilité puis apprendre à naviguer à deux et à communiquer. Il y a aussi toute la partie matelotage, la préparation physique et la préparation mentale.
C. B. : Quels sont les points forts de votre binôme ?
C. P. : L’expérience et la complémentarité.
C. B. : Quels sont vos liens avec la Marine nationale ?
C. P. : Je suis entrée dans l’armée de Champions en septembre 2013. Ça m’a permis d’être à plein temps dans ma préparation olympique et d’avancer sereinement. Les stages d’acculturation militaire nous sont proposés plusieurs fois par an, afin de créer une cohésion entre athlètes de différents sports, rencontrer le monde militaire, et créer des liens. Ça reste de sacrées expériences ces stages, on va s’en souvenir longtemps !
C. B. : Quel sera votre prochain défi après les JO ?
C. P. : Apprendre à naviguer sur un plus gros bateau ! Je pars en famille autour du Pacifique sur un catamaran. Encore une sortie de ma zone de confort car je n’ai jamais navigué sur un tel bateau, mais j’ai besoin d’un beau projet pour prendre une grande inspiration auprès de ma fille et mon conjoint. En rejoignant une association environnementale, je veux rendre ce projet utile et peut-être en produire un film.

Matelot Joan-Benjamin Gaba (Judo - 73kg)
« Déterminé, motivé et honoré »
Jeune recrue de l’armée de Champions, Joan-Benjamin Gaba est entré dans la Marine en octobre 2023. Pour canaliser son énergie débordante, ses parents l’inscrivent au judo à six ans. Déjà familier des terrains de football et de rugby, il se découvre une passion pour cet art martial japonais. Ses points forts sur le tatami ? Son physique, sa puissance, son cardio et sa capacité à attaquer aussi bien à droite qu’à gauche. Champion de France des moins de 73 kilos, il portera avec fierté son kimono bleu aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Cols bleus : Avez-vous conscience de votre chance de participer aux Jeux Olympiques en France, dans votre pays ?
Joan-Benjamin Gaba : Ça n’arrivera plus c’est certain. Les étoiles sont alignées, c’est assez improbable que ça tombe sur notre génération. On va essayer d’en profiter au maximum et de puiser dans la force que les Français nous enverront pour faire la meilleure performance possible.
C. B. : Comment se déroule une journée- type d’entraînement pour les Jeux Olympiques ?
J-B. G. : On s’entraîne tous les jours du lundi au vendredi et parfois le samedi. Le matin c’est préparation physique, on alterne entre séances de cardio et de musculation. L’après-midi c’est judo, on commence avec la technique et ensuite il y a entraînement, puis combats et confrontations. Je me confronte à des judokas de ma catégorie n’ayant pas été sélectionnés pour les JO, mais le niveau des athlètes français est bon, ce sont donc des partenaires de qualité.
C. B. : Trois mots pour décrire votre état d’esprit ?
J-B. G. : Déterminé, motivé et honoré.
C. B. : Pour ces Jeux Olympiques, quels sont vos objectifs de médaille ?
J-B. G. : C’est un sport de combat, donc on a tous une mentalité de conquérant, on veut tous gagner, c’est évident. Si on vise le bronze, c’est certain qu’on n’aura pas l’or, donc je vise la médaille d’or.
C. B. : Quel sera votre prochain défi après les JO ?
J-B. G. : Être champion du monde 2025.

Quartier maître Axel Mazella (Kite Foil)
Entre ciel et mer
C’est une consécration pour les amateurs de kitesurf du monde entier. Cet été à Marseille, ce sport fait son entrée aux JOP. Pratiquée par une poignée de passionnés dans les années 90, cette discipline sportive s’est progressivement popularisée et professionnalisée. À l’image du kitesurf, ce qui était au départ un simple loisir pour Axel Mazella a bien vite mué en une soif de compétition. Âgé de 26 ans, le Toulonnais est aujourd’hui déterminé à marquer l’histoire de ce sport.
Cols bleus : Comment décririez-vous les sensations du kite foil?
Axel Mazella : Notre planche est à un mètre au-dessus de l’eau grâce à l’aileron attaché en dessous. On a vraiment la sensation de voler, d’être en apesanteur.
C. B. : Comment avez-vous été sélectionné pour les JOP ?
A. M. : Nous avons été sélectionnés par la Fédération française de voile qui s’est basée sur nos performances de la saison dernière. J’ai été le Français le mieux classé sur les quatre épreuves internationales, dont les championnats d’Europe où je suis arrivé premier.
C. B. : Comment appréhendez-vous les JO ?
A. M. : Je prends les choses étape par étape. Aujourd’hui je ne pense pas aux JO mais à ma préparation physique.
C. B. : Qu’avez-vous ressenti en portant la flamme à Toulon ?
A. M. : Beaucoup d’émotion, car il s’agit de ma ville natale et tous mes proches étaient présents. De nombreuses personnes m’ont aussi encouragé, pris des photos voire ont couru à mes côtés sur les 200 mètres de mon tronçon. C’était très beau, qu’une simple flamme provoque autant d’émulation.
Quartier-maître Hélène Noesmoen (planche à voile IQFoil)
Une aventure familiale
La planche à voile était un jeu. Quand Hélène Noesmoen a débuté, elle s’amusait sur l’eau avec ses frères et sœurs. Aujourd’hui, championne du monde (2020) et triple championne d’Europe en IQFoil, la sportive est toujours accompagnée par son frère Pierre, devenu son entraîneur. Elle rejoint l’armée de Champions en 2021 et devient marraine du sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Triomphant. Cette intégration dans la Marine et le soutien du CNSD lui ont permis de mettre son travail d’ingénieur sur pause afin de se concentrer sur l’IQFoil.
Cols bleus : Comment avez-vous vécu le passage de planche à voile à l’IQFoil?
Hélène Noesmoen : Au début, j’ai dû tout réapprendre, me remettre dans la peau d’un débutant. Je trouvais ça génial, car dans le sport de haut niveau, on est vraiment appliqué tous les jours à s’entraîner et progresser sur des détails. Avec le passage au foil, la marge de progression est devenue énorme. Seul le foil est en contact avec l’eau, il y a un équilibre plus fin à trouver, au début on commet beaucoup d’erreurs d’appui, ce qui provoque de grosses chutes.
C. B. : Qui sont vos partenaires d’entraînement pour la préparation des Jeux ?
H. N. : Je suis dans un sport individuel mais autour de moi, j’ai une équipe super soudée, c’est une préparation collective. Les partenaires d’entraînement sont comme des concurrents d’entraînement et permettent d’élever le niveau de jeu. Ceux n’ayant pas été sélectionnés pour les Jeux ont accepté de m’aider à repousser mes limites et à élever mon niveau pour être prête. Eux aussi sont là pour ramener la médaille à la France car la voile est un sport de partage.
C. B. : Quels sont vos points forts pour ces Jeux ?
H. N. : La capacité d’adaptation est ma plus grande force. À Marseille, c’est encore plus vrai parce qu’en Méditerranée la météo évolue très vite avec de petits effets de vent liés à la chaleur. L’été sur ce plan d’eau, d’une heure à l’autre ça peut changer beaucoup, la clef sera de s’adapter.

Quartier-maître Nicolas Goyard
« J’ai grandi avec la mer »
À bord du catamaran familial, un petit garçon de deux ans embarque pour une transatlantique. 26 ans plus tard, Nicolas Goyard n’a rien oublié de son enfance sur l’eau. Désormais, c’est sur sa planche équipée d’un foil, qu’il survole la mer. Intéressé par tous les aspects de son sport, il développe des foils et dessine ses propres planches. L’entrée de l’IQFoil * comme nouveau format de planche à voile, lui permet de gagner sa place pour les Jeux Olympiques. Cet été, à Marseille, Nicolas Goyard compte bien décrocher une médaille (en plein vol) !
Cols bleus : Quand et où avez-vous commencé à pratiquer la voile ?
Nicolas Goyard : La voile me suit depuis très longtemps, j’ai grandi avec la mer, c’est mon élément. J’ai vécu sur le bateau de mes parents jusqu’à mes dix-huit ans. Depuis tout jeune, j’ai appris à sentir le vent, les vagues, à barrer le bateau, donc toutes les sensations je les avais déjà. En Nouvelle-Calédonie, j’ai commencé l’Optimist à six ans, et la planche à voile à neuf ans.
C. B. : Quelles sont les sensations éprouvées en planche à voile à foil ?
N. G. : La liberté est forte, avec la vitesse il y a de l’adrénaline, c’est un sport de glisse. Derrière, on a une sensation de contrôle qu’il faut garder, toujours sur le fil de rasoir, à pousser la chose au maximum malgré l’instabilité. Et la connexion avec la nature est juste magique, on vole au-dessus de l’eau, on a l’impression d’être sur un tapis volant.
C. B. : Quels sont vos points forts pour les JO ?
N. G. : L’expérience car le nombre d’heures passées sur le foil me donnent un avantage sensoriel, ma capacité d’autoanalyse, mon endurance musculaire, et enfin ma vitesse.
C. B. : Quels sont vos liens avec la Marine nationale ?
N. G. : C’est une fierté d’avoir rejoint l’armée de Champions en octobre 2021. Le statut de sportif de haut niveau est souvent bancal et cette structure nous apporte justement une vraie stabilité. Je suis le parrain du Suffren, j’ai pu visiter le sous-marin et rencontrer l’équipage. C’était une riche expérience avec de très beaux échanges entre marins.
* Sur ce support, la dérive est remplacée par un foil surélevant la planche hors de l’eau en vitesse de planage

Quartier-maître Nicolas Goyard
Second maître Shirine Boukli (Judo – 48kg)
« Petite mais déterminée »
Le judo est une histoire de famille. Sous les regards avisés de son père et de son oncle, tous deux anciens judokas, Shirine Boukli pratique ce sport de combat depuis l’âge de quatre ans. Elle a d’ailleurs débuté dans le club de son oncle dans le Gard. Ceinture noire à 15 ans, elle combat aujourd’hui dans la catégorie des moins de 48 kg. En 2021, elle participe aux Jeux de Tokyo mais la jeune femme est éliminée dès le premier tour. Trois ans plus tard, plus déterminée que jamais, elle arrive pour Paris 2024, avec en poche un double titre de championne d’Europe et celui de vice-championne du monde.
Cols bleus : Vous êtes la marraine du porte-hélicoptères amphibieDixmude, qu’est-ce que cela représente ?
Shirine Boukli : Quand on m’a annoncé que j’étais marraine du Dixmude, j’avais du mal à y croire. Je suis Shirine, une judoka dans les – 48 kg et je deviens marraine d’un énorme navire de guerre ! Je suis très fière et j’espère rendre fier l’équipage le 27 juillet. Je devrais les rencontrer en septembre.
CB: Quels sont vos points forts ?
S. B. : Ma capacité à varier mon judo, mon expérience et ma détermination. J’ai beaucoup travaillé sur le ne-waza (le sol) et des choses plus précises pas toujours visibles, mais qui apportent des opportunités.
CB : Quelles sont les sensations éprouvées lors d’un combat ?
S. B. : C’est une montée d’adrénaline immédiate, et il faut s’adapter en permanence à son partenaire pour réussir à trouver l’ouverture pour une attaque.
CB : Quel appui vous apporte l’armée de Champions ?
S. B. : C’est un soutien depuis 2021 qui me garantit une stabilité financière. Le commandement est toujours à notre écoute dans les bons moments comme dans les plus difficiles. Avec les autres sportifs, on forme aussi une vrai « team de champions », on se soutient, on s’encourage.

Matelot Johanne Defay (surf)
La numéro 1 française
Historiquement, jamais une Française n’avait atteint ce classement mondial. La numéro 1 en France occupe la 2e place du podium international. Née au Puy-en-Velay en 1993, cette Réunionnaise d’adoption est la première surfeuse à intégrer l’armée de Champions. Marraine de la base navale de Port des Galets à la Réunion, elle peut compter sur le soutien très enthousiaste et créatif des marins* d’Outre-mer. Une chance de médaille très forte.
Cols bleus : Qu’ont de spécial ces Jeux ?
Matelot Johanne Defay : Je n’ai participé qu’aux Jeux de Tokyo, et il y avait le Covid, c’était un peu bizarre. Alors je mesure la chance que j’ai de vivre des JO dans mon pays : c’est incroyable !
C. B. : Qui sont vos principales concurrentes ?
J. D. : L’Américaine Caity Simmers, numéro 1 mondiale, et l’Australienne Molly Picklum, sur la troisième place du podium. En France, la deuxième qualifiée au JO est la Tahitienne Vahine Fierro. Sur le circuit pro, elle est en deuxième division ; en revanche aux JO, elle est une grande locale de la vague mythique de Teahupo’o où vont se dérouler les épreuves, elle sera clairement une des filles à battre !
C. B. : Quel spot vous plaît le plus ?
J. D. : Ça dépend des humeurs ! Il y a autant de vagues différentes que de jours, c’est ce qui rend cette pratique si spéciale. J’adore les longues droites puissantes comme JBay, en Afrique du Sud. J’ai commencé à 7 ans, et j’ai tout de suite accroché ! Même, en jouant dans les vagues à la nage ou en bodyboard.
C. B. : Comment vous entraînez-vous ?
J. D. : J’ai deux routines. à la Réunion, on essaye de faire un entraînement surf le matin, puis en fonction des conditions, en fin de journée je fais de la musculation, de la course à pied et du vélo pour l’endurance fondamentale, du yoga pour le flow, des étirements, du skate. Je fais deux entraînements par jour voire trois. Avec mon mari qui est aussi mon préparateur physique, on travaille beaucoup le mental et le physique de front car c’est indissociable. En compétition, ou en déplacement - 8 à 9 mois par an – je m’adapte mais toujours avec beaucoup de surf au programme.
C. B. : Connaissez-vous les autres sportifs de l’armée de Champions ?
J. D. : Oui bien sûr, c’est aussi pour cela que j’adore en faire partie. Je rencontre d’autres sportifs, d’autres carrières, d’autres chemins de vie, et c’est très inspirant en tant qu’athlète.

Johanne Defay surfeuse
Second maître Jean-Baptiste Bernaz (Voile ILCA 7)
Réaliser un rêve d’enfant
De Pékin à Tokyo, en passant par Londres et Rio, Jean-Baptiste Bernaz est un vétéran des Jeux Olympiques. Médaille d’or à la Coupe du monde de voile 2017 et champion du monde d’ILCA7, le Provençal de 36 ans est parrain du Pôle École Méditerranée et se prépare désormais pour les JOP.
Cols bleus :Qu’est-ce qui vous a poussé à faire de la voile en compétition ?
Jean-Baptiste Bernaz : J’étais avec mon père chez David Ginola qui nous avait invités pour regarder la Coupe de l’America. Cela m’a immédiatement fait rêver, je devais avoir 8 ans ! Je me suis tourné vers mon père et je lui ai demandé comment embarquer sur ce type de voilier. Sa réponse a été simple : « À bord de ces bateaux-là, il y a plein de champions du monde ou de médaillés olympiques en Laser* donc si tu veux prendre part à ces courses, deviens l’un d’entre eux ». Ça a été le déclic pour moi.
C. B. :Où se déroulera l’épreuve olympique ?
J.-B. B. : Dans la rade sud de Marseille. Pour ma catégorie, l’ILCA 7, les courses auront lieu deux fois par jour du 1er au 5 août. À l’issue de ces dernières, les 10 premiers du classement général seront qualifiés pour la Medal Race qui se tiendra le 6 août devant la Marina olympique du Roucas-Blanc. Les points de cette ultime course compteront double donc il faudra certainement performer pour remporter une médaille.
C. B. : Comment appréhendez-vous cette édition des JO en France ?
J.-B. B. : Avec beaucoup d’envie et de motivation, grâce à toute l’énergie glanée auprès de ma famille et de mes amis. Ce seront peut-être mes derniers JO donc je ne veux rien regretter jusqu’à la fin.
* Ancien nom de l’ILCA7 jusqu’en 2021

Jean-Baptiste Bernaz évolue en voile ILCA 7
Second maître Marc-Antoine Olivier (Nage en eau libre)
Une belle entrée en Seine
Premier nageur de l’armée de Champions à avoir rejoint la Marine, Marc-Antoine Olivier plongera, cet été, dans les eaux de la Seine pour une course de dix kilomètres. À vingt ans, le nageur en eau libre remportait la médaille de bronze aux Jeux de Rio. Huit ans plus tard, il est vice-champion du monde. Cette fois, les Jeux sont à domicile. Marc-Antoine Olivier espère monter sur la plus haute marche du podium.
Cols bleus :Comment vous entraînez-vous pour les Jeux Olympiques ?
Marc-Antoine Olivier : Je m’entraîne à Ostia en Italie depuis les Jeux de Tokyo. Chaque semaine, on fait huit entraînements en bassin et deux en mer. Je suis dans un groupe avec quatre de mes plus gros concurrents. Ce n’est pas évident au quotidien parce que ça demande de l’exigence tous les jours, mais pour notre discipline c’est important. J’ai aussi pas mal de compétitions jusqu’aux Jeux, qui me permettent de gagner en expérience pour la course de cet été.
C. B. :Pour la nage en eau libre, plutôt eau douce ou eau salée ?
M.-A. O. : J’aime bien la mer, avec le sel on est porté, c’est plus facile, sauf quand la mer est très agitée. Une mer sans vagues, c’est idéal.
C. B. :La qualité de l’eau de la Seine a fait couler beaucoup d’encre, qu’en pensez-vous ?
M.-A. O. : Ce sont mes troisièmes Jeux, à chaque fois la qualité de l’eau est remise en question. Il n’y a jamais eu de problèmes, les organisateurs ont toujours su répondre présents. J’ai déjà fait des coupes du monde en Amérique du Sud, où les eaux étaient bien pires que celle de la Seine.
C. B. :Quel est votre meilleur souvenir avec la Marine ?
M.-A. O. : Les championnats de France militaires en 2018, il y avait une ambiance incroyable et j’ai pu découvrir un univers que nous, athlètes de haut niveau, n’avons pas l’habitude de côtoyer. J’ai pu rencontrer des marins du Charles de Gaulle qui repartaient en mission juste après, c’était vraiment sympa de discuter avec tout le monde.
Marc-Antoine Oliver nage en eau libre
Matelot Eugénie Dorange (Canoë)
Un sourire à toutes épreuves
Après la danse, l’équitation, le ski, Eugénie Dorange souhaite faire de l’aviron comme ses cousins. À Auxerre, pas d’aviron, mais avec sa sœur, elle débute le kayak à 8 ans puis le canoë trois ans plus tard, sport asymétrique et exigeant. Qualifiée pour ses premiers Jeux à 25 ans, elle s’entraîne plus de quinze fois par semaine sur l’eau, ce qui ne l’empêche pas de se préparer à passer le concours du barreau en septembre. Elle a rejoint l’armée de Champions en 2023 et devient marraine de la frégate Alsace.
Cols bleus :Pourquoi avez-vous fait cette bascule du kayak vers le canoë ?
Eugénie Dorange : Avant les femmes n’avaient pas le droit de faire du canoë car soi-disant cela déformait le bassin. La première compétition internationale date de 2009 aux championnats du monde et le canoë féminin intègre les Jeux seulement à Tokyo, en 2021. En club, j’ai eu la chance de rencontrer les premières Françaises sélectionnées en « canoë dames ». Cela m’a montré que des filles pouvaient aussi pratiquer cette discipline.
C. B. :Vous attendiez-vous à être sélectionnée ?
E. D. : Sur le papier, ça fait quelques années que je suis la meilleure française, et il fallait assurer cette année encore pour être qualifiée. C’était un objectif dans mes cordes, mais une sélection olympique n’est jamais gagnée d’avance et implique énormément de stress. Aujourd’hui, je suis qualifiée en monoplace mais j’ai une petite déception de ne pas m’être qualifiée en biplace parce que c’était notre objectif avec mon équipière.
C. B. : Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’approche de cette compétition ?
E. D. : La distance est différente entre le biplace et le monoplace. Toute l’année, je me suis préparée sur du 500 mètres, en équipage. Là, la préparation change car je vais courir 200 mètres en monoplace. Tous les jours comptent, chaque séance, chaque coup de pagaie doit être optimisé pour progresser et être performante aux Jeux. Mon objectif est de faire descendre mon chrono au maximum pour être compétitive. Une fois au Jeux, tout est possible.

Matelot Eugénie Dorange évolue en canoë
Quartier-maître Jérémie Mion (Voile 470)
Se défier au quotidien
De la voile en Île-de-France. Ce n’est pas courant, pourtant, c’est à Cergy-Pontoise, à l’âge de 11 ans que Jérémie Mion a découvert cette discipline. Champion du monde en 2018, trois fois champion d’Europe, troisième de la transat Jacques Vabre en 2021, cet éternel optimiste aime la connexion avec la nature, la mer, le vent, ce sentiment d’évasion. Aux Jeux de Paris 2024, il concourt en 470 au côté de Camille Lecointre.
Cols bleus :Quelle est la spécificité du 470 ?
Jérémie Mion : Le 470 est un dériveur de 4m70 de long. Il y a trois voiles : une grand-voile, un foc et un spinnaker. Jusqu’à présent, les équipes n’étaient pas mixtes, donc j’ai déjà fait les jeux de Rio et Tokyo avec Sofiane Bouvet et Kévin Peponnet. Depuis cette olympiade, c’est devenu mixte donc on s’est associé avec Camille il y a presque deux ans. Je suis équipier et Camille est barreuse.
C. B. :Quel sera votre objectif ?
J. M. : On vise l’or, comme cela si ça foire on aura le podium (rires). Je pense qu’on peut oser rêver de la médaille d’or mais on est lucide. Ce sport est soumis à la météo, ce n’est pas simple. Si on fait un podium on sera quand même très content. Avec Camille, on a décidé d’aller vite mais on a tous les deux une grosse expérience.
C. B. :Et votre prochain défi ?
J. M. : Retenter une olympiade si j’ai encore de l’énergie. Sur le court terme, j’ai dans l’idée de changer de support et de partir en 49er * avec Jean-Baptiste Bernaz et sur du long terme, j’aimerais retenter les courses au large.
C. B. :Pourquoi l’armée de Champions ?
J. M. : La voile est un sport peu médiatisé à l’origine. Ce n’est pas simple de vivre de notre sport. Être dans l’armée de Champions me permet de me concentrer sur mon sport avec une solde tous les mois. Nous partageons aussi des valeurs communes entre sportifs de haut niveau et marins : l’entraide, la persévérance, l’humilité. J’ai l’impression d’être rentré dans une grande famille qui nous épaule et compte sur nous.
* Classe de dériveur à deux équipiers de 4,99 mètres de long.

Second maître Hugo Boucheron (Aviron)
Force et endurance
Champion du monde (2016), champion d’Europe (2018) champion de France (2020) et champion olympique (2021). Hugo Boucheron peut s’enorgueillir d’un palmarès exceptionnel. Entré dans l’armée de Champions en 2018, ce rameur a d’abord pratiqué seul avant de ramer en duo puis à quatre et huit. Avec son coéquipier Matthieu Androdias, ils souhaitent décrocher la victoire devant leurs proches et faire résonner la Marseillaise sur les podiums.
Cols bleus :Quelles sont les sensations éprouvées lors d’une course ?
Hugo Boucheron : C’est une intense douleur (rires). L’aviron est un sport technique et physique. Le muscle est très sollicité avec une forte présence de lactates qui amènent une douleur dans l’effort. C’est vraiment un épuisement total et en même temps, il faut réussir à gérer son corps techniquement. Pour autant, on va chercher le plaisir dans la réussite de son geste pour aller au bout de l’effort avec son coéquipier et surtout passer la ligne en premier.
C. B. : Pour quelles raisons vous êtes- vous tourné vers le « deux de couple » ?
H. B. : Lors de sélections nationales individuelles aux championnats de France, nous nous sommes démarqués avec mon coéquipier, Matthieu Androdias. Le club a décidé de nous faire évoluer ensemble et notre duo a bien fonctionné. Depuis 2015, nous continuons en équipe.
C. B. : Comment avez-vous rejoint l’armée de Champions ?
H. B. : Je suis arrivé en équipe de France élite chez les seniors, en 2014. Je n’avais pas de sponsors et d’argent, donc j’étais entraîneur dans mon club à mi-temps et je m’entraînais en parallèle. Pour être capable de rivaliser contre la concurrence et les exigences internationales, il faut avoir beaucoup de temps pour pratiquer (en moyenne trois fois par jour). Je devais augmenter le rythme d’entraînement et de récupération. J’ai rejoint l’armée de Champions en 2018, et elle m’accompagne pleinement dans mon projet olympique. Et les résultats sont là ! J’ai remporté plusieurs titres internationaux. Un sportif doit pouvoir se concentrer à 100 % sur son sport et la Marine me permet de pouvoir faire cela toute l’année.

Matelot Emma Lombardi (Triathlon)
Trois sports en un
Elle n’a que 22 ans, mais nourrit déjà des ambitions de titre olympique. Membre de l’équipe féminine de triathlon, le matelot Emma est la plus jeune sportive de la Marine nationale à avoir été sélectionnée. Elle est aussi la marraine de la frégate de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul.
Le sport a toujours fait partie de son quotidien, grâce à ses parents qui l’inscrivaient, elle et son frère, à une association sportive chaque année. Emma Lombardi a ainsi commencé la natation à l’âge de cinq ans avant de découvrir le triathlon quatre ans plus tard. Ce sport a la particularité de combiner la natation, le cyclisme et la course à pied. Encore lycéenne, elle se lance dans la compétition et connaît une ascension fulgurante. Championne du monde espoir en 2021 puis championne du monde en relais mixte l’année suivante, la triathlète iséroise est classée numéro 3 mondial en 2023. Elle-même ne s’y attendait pas : « Cela a été une surprise pour moi, j’avais pour objectif de courir avec les plus grandes, mais je ne pensais pas faire de telles performances ! Mais je pense que je dois encore travailler ma vitesse et mon explosivité. » *
Grâce à ses performances, elle fait partie des trois triathlètes féminines à avoir été sélectionnées pour représenter la France, cet été aux JOP. L’épreuve olympique aura lieu le 31 juillet et sera divisée en trois tronçons. La course commencera par 1500 m de natation dans la Seine, suivie de 40 km de cyclisme répartis en sept tours et se conclura par 10 km de course à pied. Le pont Alexandre-III sera le point de départ et la ligne d’arrivée. L’athlète participera aussi à la course en relais mixte prévue le 5 août.
* Source : Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) Provence-Alpes-Côte d’Azur, ministère des Sports.

Matelot Emma Lombardi en triathlon
Des stages pour les blessés
Le sport, clé de la reconstruction
Chaque année, des marins, blessés ou malades, bénéficient de stages de reconstruction par le sport. Ces derniers de pratiquer une activité physique, créer du lien social et renouer avec l’Institution.
En plus d’un soutien et d’un accompagnement administratif, médical, social, juridique et humain, la CABAM propose depuis 2022 ses propres stages de réadaptation par le sport afin de motiver les malades et les blessés et d’enclencher leur processus de reconstruction. Il existe actuellement deux stages par an financés par l’association Entraide Marine 1 pouvant accueillir jusqu’à dix marins. Le second maître Pierre* en a lui aussi bénéficié. Après un accident de travail et un alitement de plusieurs mois, « cela m’a permis de rompre l’isolement et de recréer du lien avec la Marine. Si la CABAM ne m’avait pas contacté, je ne les aurais jamais connus. » L’activité sportive suscite la cohésion et des encouragements, sans porter de jugement. Elle place le blessé ou le malade dans une dynamique valorisante quelle que soit sa pathologie. « Le sport fait du bien au moral, souligne Clémence de Vitry, assistante sociale d’Entraide Marine. J’ai vu des marins qui ne se connaissaient pas se confier des choses très personnelles et garder contact des mois après. »
« Handicapables »
« On parle de reconstruction par le sport, mais il faut surtout voir les stages sportifs comme un premier jalon, une main tendue », admet Clémence de Vitry. « Une fois l’isolement terminé, c’est là que peuvent démarrer les démarches administratives, des envies professionnelles. C’est un premier pas dans la vie d’après. » Il existe ainsi une multitude de stages de reconstruction par le sport, organisés par le Centre National des Sports de la Défense (CNSD), le Cercle sportif de l’Institution nationale des Invalides (CSINI) ou la Cellule d’aide aux blessés de l’armée de Terre (CABAT) laquelle organise annuellement les Rencontres militaires blessures et sports (RMBS). Ces rencontres s’articulent autour d’activités physiques adaptées à chaque handicap et permettent aux blessés de l’ensemble des armées et services de retisser du lien social. C’est le cas du maître Corentin*, commando Marine, souffrant d’un stress post-traumatique. « J’avais fait part de mon envie à la CABAM de participer aux Invictus Games et ils m’ont proposé de commencer par un stage RMBS, où les rencontres sont primordiales. J’ai découvert plusieurs sports dont le rugby fauteuil. » Corentin a ensuite fait un stage multisports, plus intense et proche de la compétition.
L’objectif est de « montrer à chacun qu’il est capable, on parle alors d’handicapable. Ce sont des blessés, oui, mais en situation de handicap », explique le commandant Erwan Lebrun, ancien chef du dispositif de reconstruction par le sport pour les armées. C’est pourquoi chaque stage est ouvert à tous et s’adapte à l’ensemble des handicaps et pathologies. « J’ai en tête l’exemple d’anciens militaires qui, par le travail et la volonté, sont allés au-delà de leur handicap et de leurs blessures et sont aujourd’hui au sein du Bataillon de Joinville pour participer aux Jeux Paralympiques. »
D’autres stages sont également ouverts aux familles par le CNSD ou le CSINI, par exemple le stage d’équitation adaptée, qui permet de faire vivre aux blessés des expériences corporelles et émotionnelles avec le cheval. La famille, dont l’accompagnement reste indispensable dans le parcours de reconstruction du blessé, est également conviée. En 2025, un village des blessés devrait voir le jour au CNSD, dans une structure adaptée, capable d’accueillir une centaine de blessés et leurs familles.
EV1 Margaux Bronnec
* Prénoms modifiés
1 Vous voulez faire un don à Entraide Marine-Adosm ? Rendez-vous sur https://www.entraidemarine.org/adherer-et-faire-un-don-en-ligne

Tous marins, civils et militaires
Publié le 01/09/2024
Déployés principalement le long des façades maritimes, 2 800 civils de la Marine œuvrent à l’accomplissement des missions de la Marine, dans les états-majors comme au plus près des unités opérationnelles. Employés dans les filières numériques, techniques, administratives, logistiques et de soutien, ces hommes et ces femmes travaillent en complémentarité avec le personnel militaire. Qui sont-ils ? Cols bleus est allé à leurs rencontre.

Interview croisée : « Attirer et fidéliser le personnel civil »
« La Marine nationale est riche de ses marins civils, militaires et réservistes. Notre action collective est de bâtir une marine prête pour vaincre en opérations. Je compte sur chacun des 2 800 civils de la Marine. »
Amiral Nicolas Vaujour, chef d’état- major de la Marine
L’ingénieur général de l’armement Guillaume de Garidel-Thoron (service de soutien de la flotte), le vice-amiral Serge Bordarier (aéronautique navale) et le capitaine de vaisseau Charles-Henry Orcel (service logistique de la Marine) ont autorité sur près de la moitié des civils de la Marine. Leurs force et services sont les trois principaux employeurs de civils dans la Marine. Pour Cols bleus, ils croisent leurs regards au sujet de cette spécificité.
Cols bleus : Quel est le pourcentage de civils dans chacune de vos forces ?
IGA Guillaume de Garidel-Thoron (SSF) : 60 % soit 552 civils. Cette situation est stable et, à mes yeux, ce pourcentage est satisfaisant.
VA Serge Bordarier (ALAVIA) : En juin 2024, 8 %, soit 388 civils (pour 4 585 militaires d’active). En légère hausse par rapport à juin 2023. La variété des missions opérationnelles de la force de l’aéronautique navale nous oblige à conserver un vivier de militaires projetables en opérations. Parmi le personnel à terre, en charge notamment de la maintenance, il est essentiel de conserver des militaires afin d’alimenter au besoin le premier vivier mais également de compter sur des civils très qualifiés.
CV Charles-Henry Orcel (SLM) : Actuellement, 35 %. Cette population civile est stable. Colonne vertébrale de la compétence au sein du SLM, elle forme une ossature solide et durable des savoir-faire techniques et assure la continuité du service.
C. B. : Considérez-vous les civils comme des marins à part entière ?
IGA G. G. T. : Les civils du SSF sont, je crois, très attachés au SSF et à la Marine. Pour ma part au quotidien, je ne fais pas de différence, à poste équivalent ; tous appartiennent au même équipage, avec des rôles et des statuts – donc des droits et aussi des sujétions – différents.
VA S. B. : Je ne fais aucune distinction.
CV C. H. O. : Aux côtés de nos marins militaires, nos marins civils contribuent avec force, engagement et compétences à la disponibilité des bâtiments de la Marine.
C. B. : À quels postes trouve-t-on des civils dans vos forces ?
IGA G. G. T. : On peut les retrouver à des postes opérationnels comme responsable d’opération, ou ingénieur responsable bâtiments, des postes d’encadrement comme sous-directeur ou chef de bureau, des postes spécialisés dans des domaines techniques, logistiques, achats, ou des postes administratifs.
VA S. B. : 73 % des civils d’ALAVIA exercent des missions à dominante technique (26 % dans le domaine de la maintenance en condition opérationnelle, 22 % en logistique, 15 % en administration, 10 % en santé et sécurité au travail…). Avec une moyenne d’âge de 49,7 ans et une longévité dans les postes, ils apportent une expérience et une expertise indéniables.
CV C. H. O. : Aujourd’hui, il est important de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier, d’où notre effort pour une mixité des postes. Cependant, certains domaines sont spécifiquement choisis pour chaque groupe. Par exemple, l’artillerie navale est principalement occupée par des militaires, tandis qu’en expertise de plongée humaine, nous retrouvons souvent des civils pour garantir une compétence continue dans le temps.
C. B. : Ces postes correspondent-ils à des spécialités où ne peuvent pas être recrutés des militaires ?
IGA G. G. T. : Certains postes sont spécialisés dans des domaines peu courants dans le reste de la Marine, je pense aux achats, à la comptabilité, à l’exécution budgétaire ou à la logistique où la présence de civils est importante. Ces postes qui nécessitent une formation assez longue ne pourraient pas être facilement tenus par des militaires qui sont mutés tous les 2 ou 3 ans. Pour un acheteur sur des dossiers complexes par exemple, une procédure prend environ 2 ans, et c’est donc le temps pour former quelqu’un avant de le « lâcher ».
VA S. B. : Certains domaines nécessitent des compétences techniques particulières. Bien que la majorité des postes pourrait être occupée par des militaires, le recrutement civil reste plus flexible (vivier civil plus large, possibilité de recruter sur contrat de projet) et permet un pourvoi des postes plus facile, notamment sur des fonctions très techniques (expert développement logiciel, architecte systèmes d’information, expert en infrastructures et organisations de défense…).
CV C. H. O. : En théorie, tous les grands domaines d’activité sont ouverts aux civils et aux militaires, mais la répartition se fait en fonction des besoins et des compétences nécessaires.
C. B. : Comment se passe la collaboration entre marins civils et militaires ?
IGA G. G. T. : Elle se passe bien. Évidemment il faut que les uns et les autres aient conscience de la différence de leurs statuts, et il faut prendre soin en particulier de la gestion des ressources humaines. Je crois que ce sont les compétences des uns et des autres qui sont reconnues, plus que le fait d’être civil ou militaire.
VA S. B. : La répartition géographique de la force crée un état d’esprit familial et un sens de la mission partagé. Sur les quatre bases d’aéronautique navale de l’Hexagone, civils et militaires sont quotidiennement au contact des opérations. Cette proximité permet aux civils d’être témoins des résultats opérationnels et d’en comprendre les enjeux.
CV C. H. O. : Ce qui prévaut est l’esprit d’équipage. C’est ma responsabilité, ainsi que celle de chaque directeur, d’y veiller. Tout le monde doit y être engagé avec sa personnalité, ses difficultés et ses qualités. Je constate qu’il existe et qu’il est fort.
C. B. : Quelle est la recette pour une mixité civilo-militaire réussie ?
IGA G. G. T. : Une bonne connaissance de l’autre, de ses contraintes et de ses règles de fonctionnement, une compréhension mutuelle, et quand la compétence est là et comme il y a du travail au SSF, cela ne pose aucun problème.
VA S. B. : Un commandement fédérateur, intégrant les personnels civils à l’ensemble des activités de l’unité (y compris les moments de cohésion/cérémonies) ; un accompagnement des civils lors de leur embarquement et une collaboration au quotidien entre militaires et civils, sans distinction de statut.
CV C. H. O. : Il n’y a pas de recette miracle. Chacun doit se sentir à sa place en fonction de son expérience et de l’importance de son rôle, comprendre le sens de son travail et de sa mission. Notre objectif commun est d’être arrimés aux opérations de la Marine et de faire appareiller le plus rapidement possible un bateau qui en a besoin.
C. B. : Les civils restent plus longtemps à un même poste : avantage ou inconvénient ?
IGA G. G. T. : Cette stabilité est un atout de taille au SSF. Certains sont là (tout en ayant évolué au sein du service) depuis la création du SSF en 2000, et en sont une véritable mémoire vivante.
VA S. B. : Les civils d’ALAVIA occupent leur poste en moyenne 4 ans et 10 mois. En 2024, les flux prévisionnels anticipent le départ de 20 agents d’ALAVIA.
C. B. : Les civils de la Marine sont-ils aussi engagés et loyaux que les militaires ?
IGA G. G. T. : Oui, très franchement je pense que la majorité des civils au SSF sont très attachés à la Marine et au service, et très motivés par la mission, essentielle pour la Marine : si les bateaux n’étaient pas en état technique de naviguer, la Marine s’arrêterait vite !
VA S. B. : Bien sûr ! Le mois dernier, à l’occasion de la cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin, j’ai remis à un agent civil de l’état-major d’ALAVIA la médaille de l’aéronautique navale. Il serait dommage de se priver des civils. Chez nous, près d’un tiers d’entre eux sont d’anciens militaires. Leur expérience est une véritable plus-value pour la force. Enfin, nous intégrons chaque année des stagiaires et apprentis. Cela fait naître des vocations. Autant de bonnes raisons pour attirer et fidéliser les civils au sein de la force !
CV C. H. O. : Un certain nombre de civils cherchent à intégrer la réserve. Cet intérêt spontané témoigne de leur volonté de contribuer davantage à nos missions. En devenant réservistes, ils participent ainsi encore plus activement aux opérations, renforçant ainsi notre capacité opérationnelle globale.
Civils de la Marine, une longue histoire
Depuis la création par Richelieu de la Marine royale en 1626, le monde civil des arsenaux est inséparable de l’histoire de la Marine. La politique de Jean-Baptiste Colbert, ministre d’État de Louis XIV, a permis à la France d’acquérir la plus forte marine du continent européen dans les années 1670-1680.

Les arsenaux, « lieux où l’on construit, entretient, répare et prépare les flottes de guerre, [réunissent] tout un univers de métiers dédiés à la construction navale, foyers de l’innovation technique et logistique. Selon les époques, s’y côtoient l’intendant et le charpentier, le matelot, le soldat, l’officier, le portefaix, mais aussi les ouvriers, les dockers, les contremaîtres et les métallurgistes… ». Ils sont les « coeurs battants de l’histoire militaire » 1.
L’arsenal de Brest est créé en 1631, celui de Rochefort en 1665, et celui de Toulon, qui existe depuis Henri IV, est étendu. D’autres établissements suivront tel l’arsenal de Lorient en 1778 ou encore l’acquisition des forges royales de Guérigny en 1781. Colbert met également en place une administration de la Marine pour gérer les arsenaux, destinés à soutenir les marines du Ponant et du Levant. Cette organisation va rapidement porter ses fruits. Les arsenaux produisent des bateaux de guerre français d’une qualité reconnue hors des frontières du royaume. Mais pour les ouvriers, les conditions de travail se révèlent parfois extrêmement dures.
Ouvriers volontaires et ouvriers "levés"
Parmi les ouvriers employés dans les différents ateliers ou sur les chantiers, on distingue les volontaires des ouvriers « levés ». Les premiers habitent Toulon, Brest, Rochefort ou Lorient et se rendent chaque jour « au parc », tandis que les deuxièmes sont levés dans les villes et villages des provinces côtières, à l’instar des marins et des pêcheurs. Pour pallier les difficultés liées au recrutement du personnel militaire et civil, le roi Louis XVI signe une ordonnance « des classes », le 31 mai 1784, qui oblige les hommes de plus de 18 ans, exerçant comme charpentier, perceur, calfat, voilier, poulieur, tonnelier, cordier et scieur de long, à se faire connaître de l’administration. La durée de l’enrôlement varie alors selon l’affectation du « classé ». Ouvriers et marins sont traités de manière identique.
Une réputation d'excellence
Cette réputation d’excellence des arsenaux français perdure après la Révolution. Les « ouvriers de la Marine » s’illustrent ainsi lors des campagnes napoléoniennes. Dans une lettre au général Bertrand du 29 mai 1809, Napoléon rappelle leur rôle dans « la construction des pontons, péniches et radeaux destinés aux troupes » 2.
Pour la petite histoire, le romancier Guy de Maupassant intègre la Marine en tant que civil en 1872 au poste de surnuméraire en titre à la direction du personnel au bureau des équipages de la flotte. Deux ans plus tard, alors qu’il est nommé commis de 4e classe, son chef le décrit comme « intelligent, bien doué [et] animé du désir de bien faire. Lorsqu’il aura acquis l’expérience qui lui manque, il fera un très bon employé. 3 »
En 1900, le ministre de la Marine Jean-Marie de Lanessan instaure des « commissions chargées des aptitudes professionnelles des candidats à l’embauchage », sachant que de nombreux recrutements s’effectuent également par la voie de l’apprentissage.

Achèvement de la construction du cuirassé Richelieu
Lors de la guerre 1914-1918, tous les arsenaux participent à l’effort de guerre et les effectifs atteignent 70 000 agents en 1917, pour l’ensemble des arsenaux. Le ministre de la Marine Georges Leygues, oeuvre à accroître les libertés de « l’embauchage et du débauchage des ouvriers de la Marine en fonction des besoins », et crée des dispositions sociales novatrices concernant les malades, les accidentés du travail et les congés payés.
De la direction des constructions et armes navales à Naval Group
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une direction centralisée – la Direction centrale des constructions et armes navales – est créée par décret. Des réformes supplémentaires concernant le personnel civil sont mises en oeuvre. Désormais, des fonctionnaires travaillent aux côtés des ouvriers de l’État. En 1961, ils sont regroupés sous l’appellation de « personnel civil du ministère de la Défense, employé par la Marine nationale » et l’inscription maritime est définitivement supprimée en 1965.
En 1991, la Direction des constructions et armes navales (DCAN) devient Direction des constructions navales (DCN). En 2007, afin de lui permettre de s’ouvrir à l’international, l’entreprise est privatisée, l’État restant toutefois actionnaire majoritaire. Elle acquiert la branche activités navales de Thales et est rebaptisée DCNS. Le 28 juin 2017, 400 ans après la création des premiers arsenaux, elle change à nouveau de nom. C’est la naissance de Naval Group. Cette société privée a intégrée une partie des anciens ouvriers de l’État et de nombreux ingénieurs. Elle reste néanmoins détenue majoritairement par l’État français (à hauteur de 62,25 %) quand Thales en détient 35 %.
1. Caroline Le Mao – Les Arsenaux de la Marine du xvie siècle à nos jours, Sorbonne université Presses, 2021.
2 Paul Coat – Les arsenaux de la Marine de 1631 à nos jours (Éditions de la cité, Brest-Paris, 1982).
3. In Les Amis de Flaubert – Maupassant fonctionnaire de ministère (Bulletin no 49, p., 46, 1976).
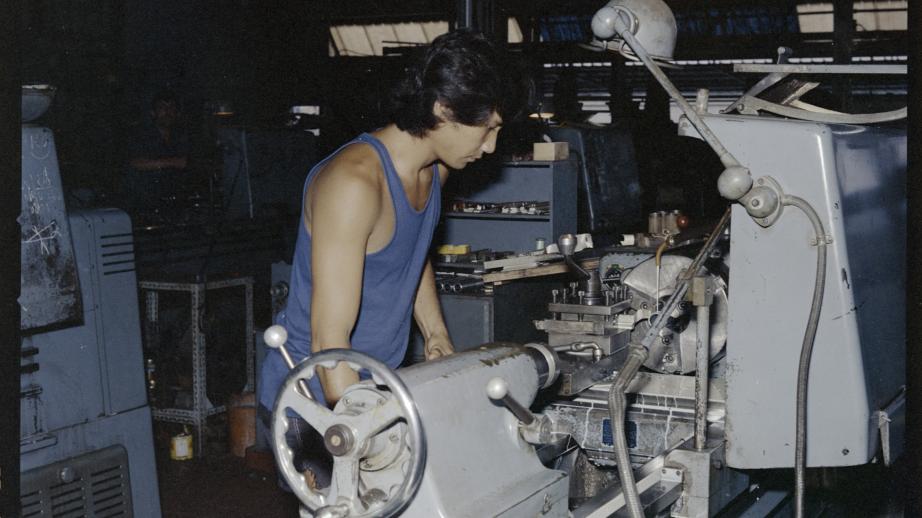
Un ouvrier civil dans le magasin général de pièces détachées de la DCAN de Papeete
Recrutement
La Marine séduit de plus en plus de civils
En augmentation chaque année depuis 2018, le nombre de postes de civil ouverts au recrutement dans la Marine était de 228 (contre 118 départs) en 2023. Cette dynamique positive témoigne d’une attractivité indéniable de la Marine chez les civils. Qui sont-ils ?
Constitués pour 62 % d’hommes et 38 % de femmes, ils étaient 2 773 en 2023. On les trouve essentiellement sur les façades maritimes (à 95 %), les deux pôles principaux étant la base navale de Toulon et celle de Brest. Largement et historiquement présents dans les filières techniques et administratives, les civils révèlent une appétence de plus en plus marquée pour les métiers des systèmes d’information et de communication (SIC), les opérations en milieu maritime et le maintien en condition opérationnelle aéro. Les SIC sont par ailleurs la famille professionnelle qui recrute le plus de civils au sein de la Marine depuis 2023.
Fonctionnaire, contractuel ou ancien militaire
Soutien opérationnel des marins, le personnel civil s’adapte aux nouveaux besoins des unités de la Marine. Cette adaptabilité se traduit par des créations de postes mais aussi de recrutement. D’où viennent- ils ? La majorité d’entre eux sont des fonctionnaires (75 %) recrutés via des concours de la fonction publique. Selon leur grade et catégorie, ils occupent des postes d’encadrement supérieur (catégorie A), intermédiaire (catégorie B) ou d’exécution (catégorie C). Depuis trois ans, des agents de catégorie B sont essentiellement recrutés, alors que les agents civils sont traditionnellement en majorité, agents de catégorie C (39 %) et ouvriers de l’État (17 %).
Les contractuels (8,4 %), en contrat à durée déterminée ou indéterminée, se révèlent un bon choix pour pallier les manques lorsqu’un besoin spécifique se fait sentir, par exemple dans les domaines du numérique, du nucléaire ou de la formation. Depuis la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique élargissant le recours aux contractuels, ce mode de recrutement est même devenu le premier mode de pourvoi (47 %), dépassant le recrutement d’anciens militaires (29 %) via les articles L.4139 du code de la défense, et les concours de la fonction publique (13 %).
Le bureau numérique, 1er employeur de civils à l’état-major de la Marine
La transformation numérique de la Marine est un enjeu majeur pour renforcer sa supériorité opérationnelle et informationnelle. Au cœur de cette évolution, la collaboration accrue entre militaires et civils permet de répondre efficacement aux défis technologiques et stratégiques.

Lancée en 2023 par le bureau numérique (BNUM), la stratégie de transformation numérique centrée sur la donnée de la Marine, nommée « SIGNAL » (Supériorité Informationelle pour la Guerre NavALe) vise à renforcer l’efficacité opérationnelle de la Marine dans un environnement compétitif et imprévisible, en exploitant la force de la donnée et de l’intelligence artificielle (IA).
Pour mener à bien cette transformation, la Marine s’appuie de plus en plus sur du personnel civil en raison de l’évolution rapide et de la complexité des compétences requises dans le domaine numérique. Aujourd’hui, le BNUM est le premier employeur de personnel civil au sein de l’état-major de la Marine. Les compétences techniques pointues et souvent plus actualisées des civils viennent compléter l’expérience et les savoir-faire opérationnels des militaires. Les militaires peuvent donc se concentrer sur les missions nécessitant spécifiquement leur statut. Cette complémentarité permet à la Marine d’améliorer sa capacité à répondre aux défis technologiques actuels et futurs.
Le numérique, un marché en tension
Le marché des métiers du numérique est en tension, particulièrement dans les domaines de la cyber sécurité, du cloud, de la data science et de l’IA. En France et à l’échelle mondiale, la demande en compétences numériques excède largement l’offre. Pour faire face à la concurrence des entreprises du privé et faciliter une embauche rapide, la Marine s’appuie sur des recrutements type « contrats de projet ». Grâce à ces statuts, introduits par la loi de transformation de la fonction publique en 2019, les armées peuvent recruter des profils spécialisés pour des missions précises. Cette synergie entre militaires et civils participe à la construction d’une Marine plus forte, plus agile et plus efficace face aux combats navals de demain.
Apprenti, un premier pas dans la Marine
7 % des civils sont des apprentis : 180 jeunes – 24 ans en moyenne – du CAP à bac+5, qui exercent dans une quinzaine de domaines (numérique, communication, opérations en milieu maritime, achats). Cette première expérience leur permet de découvrir un métier, mais aussi les codes de la Marine, et leur ouvre les portes de l’Institution. Après leur alternance, à eux de choisir : s’ils désirent poursuivre au sein de la Marine, ils peuvent le faire en passant un concours ou en signant directement un contrat. C’est le cas d’Izia, ancienne apprentie à la préfecture maritime de Brest, recrutée à l’issue de sa formation.
Cols bleus : Comment êtes-vous arrivée dans la Marine ?
Izia : En deuxième année de mon master de droit des espace et activités maritimes à l’Université de Bretagne Occidentale, à Brest, j’ai eu la possibilité de trouver une alternance pour terminer mon cursus. J’ai été retenue sur un poste d’apprentissage au sein de la préfecture maritime de l’Atlantique, à la division action de l’État en mer (AEM).
C. B. : Quelles sont vos missions ?
I. : En tant qu’apprentie, j’ai réalisé des synthèses sur les accords de coopération internationale adoptés par le préfet maritime de l’Atlantique et quelques États voisins, dans les domaines relevant de l’action de l’État en mer, comme le sauvetage, la pollution maritime, l’assistance aux navires en difficulté et la circulation maritime. Aujourd’hui, j’assiste le chef de pôle sûreté et police en mer qui est un agent de la direction générale des douanes et droits indirects. Je m’occupe principalement de la sécurisation en amont d’événements liés au monde de la mer (ce que nous appelons « manifestations nautiques »). Notre bureau se charge d’adopter les arrêtés pour créer des zones de règlementation, par exemple lors de l’Arkea Ultim Challenge qui a eu lieu le 7 janvier dernier, ou plus récemment lors du Relais des Océans pour accueillir la flamme olympique. Le dispositif était plus important que d’habitude et nous a tous beaucoup mobilisés. J’en garde un souvenir fabuleux, ayant eu la chance de pouvoir assister depuis le plan d’eau au départ de la flamme vers l’Outre-mer. Le prochain gros dossier sera le Vendée Globe en novembre.
C. B. : Comment s’est déroulée votre intégration ?
I. : Ce fut rapide grâce à la variété de profils et de statuts qui existe au sein de la division AEM : militaires, civils, administrateurs des affaires maritimes et douaniers. À mon arrivée, j’avais reçu un livret d’accueil du personnel civil, bien utile pour apprendre les grades, et se familiariser avec les forces et les unités au sein de la Marine.
C. B. : Quel avantage voyez-vous à travailler dans une équipe mixte, civilo- militaire ?
I. : Le fait de travailler avec des militaires offre une grande richesse dans les échanges, facilitant la collaboration dans le travail et sur les dossiers transverses. Aujourd’hui, j’ai découvert un univers qui m’est devenu totalement familier. J’ai même été initiée à la navigation. Avec mon compagnon, nous avons acquis notre propre voilier, de 6,5 mètres. Naviguer procure un sentiment incroyable.
Les écoles de la Marine, des militaires formés par des civils
23 000 élèves sont formés chaque année dans les écoles et les centres de formation de la Marine. Langues, mathématiques, sciences physiques, informatique, géopolitique, électrotechnique, automatique sont enseignées par 100 professeurs civils aux côtés d’instructeurs militaires.

Cours de travaux pratiques délivré aux élèves du Pôle écoles Méditerranée
Le fait est rare et peu connu : chaque année, certains professeurs de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont détachés vers le ministère des Armées, tant dans les lycées de défense qu’au sein des écoles militaires (centres de formation professionnelle initiale et continue). Une opportunité inédite pour beaucoup d’entre eux, leur permettant d’exercer leur métier en découvrant la Marine.
Première étape pour ces professeurs fraîchement affectés au sein d’une des écoles de la Marine : s’amariner. Certains auront même la chance d’embarquer à bord d’un bâtiment ; le stage embrun bien connu des jeunes marins, restant la méthode la plus efficace pour comprendre le quotidien d’un équipage. Une fois intégrés à l’équipe pédagogique, les professeurs civils profitent de leur proximité avec les enseignants militaires, une autre façon d’intégrer rapidement les codes de la Marine : « Il règne entre nous un bel esprit d’entraide et de reconnaissance qui permet de maîtriser très rapidement ce nouveau langage », témoigne Fabien, professeur d’automatique.
Ces détachements permettent également aux professeurs civils de se frotter à de nouvelles méthodes pédagogiques de transmission des savoirs. « En face nous n’avons pas des élèves mais des marins souhaitant réaliser leurs objectifs », constate Linda, professeur de mathématiques. Des militaires en formation initiale ou continue, pleinement impliqués dans leur parcours professionnel. « Nous faisons de la transmission davantage que de l’éducation. »
Enseigner au sein de la Marine, c’est adhérer aux valeurs de l’Institution et avoir continuellement à l’esprit ses missions et ses enjeux, afin de former au plus juste des marins opérationnels, prêts à être déployés sur des théâtres d’opérations. Le partage d’expériences est fortement valorisé : « Nous devons faire une veille documentaire importante, qui passe notamment par les échanges avec les militaires et nos élèves, explique Frédéric, professeur d’électrotechnique. Certains sont de retour de mission, d’autres vont partir. Par conséquent, une responsabilité nous incombe : leur assurer la meilleure formation possible ».
L’esprit d’équipage et de reconnaissance mutuelle fonctionnent tellement bien que des enseignants affirment sans ambages se sentir au bout de quelques mois pleinement marins : « Je me suis tellement bien intégré que tout le monde croit que je suis un ancien marin ! », conclut Vincent, professeur de Français.
Base navale de Toulon
Le CommLab, une « start- up » dans la Marine
Hébergé dans l’ancienne corderie de la base navale de Toulon, le CommLab réunit une petite équipe d’une dizaine de personnes (dont quatre apprentis d’un niveau Bac +5) spécialisée dans la conception de médias innovants au service de la communication interne et externe de la Marine nationale. L’initiative revient à Marc Sadoux, entré dans la Marine comme ouvrier de l’État, et qui, en avril 2023, a réalisé pour le plan Mercator une visite en 3D d’un bâtiment. Une fois n’est pas coutume, et bien que placée sous l’autorité de la FOSIT Méditerranée, cette structure agile est composée uniquement de civils (graphistes 2D/3D, développeurs intégrateurs multimédia, UX/UI designer, motion design). Le CommLab a carte blanche pour faire rayonner la Marine nationale et capter l’intérêt des jeunes Français grâce à des projets innovants faisant appel à la réalité virtuelle aux hologrammes, aux serious game, aux applications mobiles ainsi que des animations par rotoscopie.
Des profils variés, paroles de marins
À peine sortis des bancs de l’école, ayant effectué une première carrière dans le privé ou encore anciens militaires, les civils de la Marine présentent des profils éclectiques. À Brest, Toulon, Cherbourg ou encore Fort-de-France, ils œuvrent avec enthousiasme vers un seul objectif : permettre à la Marine de mener ses missions à terre, sur, sous et au-dessus de la mer. Cols bleus leur a tendu le micro pour mieux les connaître.

Civil de la Marine en train de souder
Agent sous contrat de catégorie A du pôle cohésion nationale (état- major de la Marine)
• Adrien
« Je suis le seul permanent du pôle cohésion nationale à Balard, tous les autres membres sont réservistes ! Depuis mon arrivée dans la Marine en mars dernier, j’y assure la coordination et le pilotage des quatre bureaux : réserve opérationnelle, jeunesse, relations avec les entreprises et monde maritime. Je dois m’assurer que tous travaillent dans leur périmètre sans empiéter sur celui des autres et éviter les pertes d’information. J’occupe également les fonctions de chef de cabinet du contre-amiral Laurent Berlizot. Comme il n’y a ni directeur de cabinet, ni secrétariat, mes missions sont variées : de la tenue de l’agenda de l’amiral à l’organisation d’événements nationaux en passant par la rédaction de notes et de courriers ou encore l’organisation des déplacements du chef. Auparavant, j’étais mon propre patron puisque j’avais une agence immobilière. Je dois avouer que je ne découvre pas la Marine car depuis 2010 je suis réserviste opérationnel et instructeur PMM. Raison pour laquelle j’ai postulé. Je ne suis pas déçu, j’apprends en permanence et aucune journée n’est identique. Par ailleurs, les marins avec qui je travaille au sein de l’état-major m’ont très bien accueilli et intégré. Bon nombre d’entre eux me surprennent, ils sont loin de chez eux car célibataires géographiques et, malgré cela, restent positifs et oeuvrent avec enthousiasme pour le bien commun. On voit rarement cela dans le privé. »
Sous-directeur affaires générales et ressources humaines (SSF Toulon)
• Jean-Charles
« Quand on grandit à Toulon comme moi, on a tous envie à seize ans d’accéder aux bateaux gris devant nous. Pur produit du ministère des Armées, j’ai toujours été civil de la Défense. Si j’ai commencé comme ouvrier de l’État groupe 5, aujourd’hui je suis sous-directeur affaires générales et ressources humaines du service de soutien de la flotte (SSF). Ma mission est d’assurer le soutien interne au profit des agents du SSF sur la partie ressources humaines grâce aux bureaux personnels civils et personnels militaires. Pour la partie affaires générales, ma mission consiste à manager les bureaux du secrétariat général, de l’informatique et des casernements et infrastructures. La promotion sociale est un élément dimensionnant de la Marine. Tout le monde peut évoluer et accéder à des postes à responsabilités même en commençant au plus bas de l’échelle, à partir du moment où on veut progresser, il y a des vraies opportunités. »
Experte sûreté nucléaire pour la rénovation de l’INBS île Longue (SSF Brest)
• Gwenaëlle
« J’ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu’officier de Marine sous contrat (OSC) de 2003 à 2018. Désormais civile de la défense, je suis affectée au service de soutien de la flotte (SSF) de Brest. Mon rôle est d’analyser les impacts des travaux sur la sûreté de l’installation nucléaire de base secrète (INBS) de l’île Longue, où se réalise le Maintien en condition opérationnelle (MCO) des sous-marins de la Marine nationale. À la suite d’un réexamen de sûreté, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) a conclu que l’INBS devait effectuer des travaux de rénovation. Je dois donc m’assurer de la disponibilité des installations, du respect du code du travail et des exigences réglementaires liées aux activités de l’INBS. Cela implique la relecture de documents techniques sur la sûreté nucléaire, un contact régulier avec d’autres spécialistes du domaine nucléaire (radioprotection, gestion des déchets…) et le personnel militaire de la Direction générale de l’armement (DGA). »
Adjoint au chef du département expertise juridique (SSF Brest)
• Gaëtan
« La Marine n’est pas ma culture d’origine. Avocat en droit public, j’ai exercé au barreau de Brest pendant près de neuf ans. J’ai choisi la Marine car elle est au coeur d’enjeux forts, tant au niveau national qu’au niveau local, où elle exerce une forte influence sur le bassin d’emploi. Cette double perspective est très intéressante et j’avais à coeur de pouvoir apporter ma contribution. L’un des rôles du service de soutien de la flotte (SSF) est de passer et d’exécuter des contrats pour entretenir la flotte. Dans ce cadre, la première mission du département d’expertise juridique est de participer à la sécurisation de la procédure de passation des marchés et de contrôler la qualité des contrats préparés. La deuxième mission est d’apporter tout conseil utile en matière juridique au chef d’organisme, mais également à tous les services du SSF qui nous sollicitent, lorsqu’ils rencontrent des situations conflictuelles ou précontentieuses. Je m’inscris dans un milieu beaucoup plus collectif qu’auparavant, la Marine est un environnement avec des expertises variées ; c’est très nourrissant de travailler avec ces différents professionnels et de leur permettre de porter au bout leur dossier. »
Mécanicien à l’atelier moteur hors-bord (base navale de Fort-de-France)
• Jean-Christophe
« Après avoir suivi une formation de mécanicien diéséliste à La Rochelle et travaillé deux ans dans la marine marchande, je suis revenu en Martinique où j’ai d’abord exercé comme mécanicien indépendant en marine de plaisance. En 2021, j’ai répondu à un appel à candidature et après un examen pratique, j’ai été recruté à la base navale. Avant d’arriver, j’appréhendais un peu de travailler dans le milieu militaire et finalement j’ai été agréablement surpris. Si les statuts entre civils et militaires sont distincts, lorsque nous travaillons ensemble, il n’y a pas de différence et j’ai de très bons rapports avec mes camarades militaires. De surcroît, nous avons les moyens de travailler dans de très bonnes conditions. Ayant aussi travaillé dans le privé, j’apprécie la différence. Nous sommes soutenus tant sur le plan technique que social et bénéficions du soutien de la hiérarchie. Franchement, je conseille aux jeunes de venir travailler dans les armées, que ce soit sous statut civil ou militaire, la formation qu’ils y recevront leur mettra le pied à l’étrier pour bien démarrer dans la vie. »
Agent gestion des stocks (SLM Cherbourg)
• Mathilde
« Encouragée par mes professeurs à faire un stage, je suis entrée un peu par hasard dans la Marine. L’esprit et l’ambiance qui régnaient m’ont plu au point de me faire rester. D’abord stagiaire puis apprentie, je suis aujourd’hui agent de gestion des stocks au service logistique de la Marine (SLM). Contrairement à Brest ou Toulon, Cherbourg est une petite base navale, nous sommes neuf à la division logistique. L’avantage d’être peu nombreux, c’est de toucher à tout. Ma mission est de m’occuper du stock qui est à terre. Sur un logiciel, je passe tous les mouvements d’entrées et de sorties de notre magasin y compris les inventaires et les éliminations. Notre mission principale est la délivrance de matériel pour les unités de Cherbourg et des autres ports. Ce qui me plaît, c’est de voir la finalité de mon travail : pour que les bateaux fonctionnent, il faut les entretenir et les réparer, donc avoir les pièces nécessaires à disposition. »
Responsable technique et qualité au laboratoire d’anthropora-diométrie (base navale de l’île Longue)
• Frédéric
« Je suis entré à l’École des matelots en 1997 en tant qu’électromécanicien de sécurité avant de me réorienter en 2003 en passant le Brevet technique (BT) de radioprotection. La radioprotection correspond à la prévention et à la protection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Devenu civil de la défense en 2014, j’ai été affecté au laboratoire d’anthroporadiométrie de l’île Longue en tant que responsable technique et qualité. Mon travail est de gérer l’aspect référentiel documentaire du laboratoire, l’analyse et la validation des examens, la maintenance de l’installation et assurer le contrôle qualité des mesures et des équipements. J’apprécie le fait d’avoir pu progresser au sein de la Marine nationale à travers plusieurs formations afin de gagner en compétences et en responsabilités. »
Chef par intérim du CommLab (base navale de Toulon, FOSIT)
• Valérie
« Pourquoi la Marine ? À Toulon, impossible d’envisager autre chose ! (rires) Depuis toute petite, je baigne dedans car mon père était cadre au centre d’essais de la Méditerranée. Infographiste de formation, j’ai travaillé dans une maison d’édition avant d’atterrir à la sécurité sociale des militaires. En arrivant au CommLab, j’ai trouvé un formidable esprit d’équipage. Le CommLab fonctionne comme une famille bienveillante et motivante, nous travaillons tous ensemble et sommes très polyvalents, la clef pour faire avancer les projets même en l’absence d’un d’entre nous. Il n’y a aucune mise à l’écart qui serait la conséquence de notre statut car la Marine croit en nous. Je sens une réelle volonté de nos clients (principalement le SRM et la DPM) de nous tirer vers le haut. Cette valorisation s’exprime à travers les moyens qui nous sont octroyés. En parallèle, le fait d’être civil nous offre un regard extérieur qui nous rapproche de notre public. Nous devons attirer et intéresser les jeunes aux activités de la Marine pour aider au recrutement. Chaque projet est un nouveau défi à relever. C’est passionnant. »
Expert essais expérimentations (CEPA/10S)
• Laurent
« Tout jeune, l’aéronautique me faisait rêver. Aujourd’hui, je suis personnel navigant d’essais et expert essais expérimentations au Centre d’expérimentations pratiques et de réception de l’aéronautique navale (CEPA/10S) à Hyères. J’assiste le comité directeur et les officiers rapporteurs (chefs de projet) pour les expérimentations et certaines problématiques liées à la sécurité des vols. Je conduis certaines expérimentations en vol. J’interviens dans la rédaction des dossiers adressés à la DGA pour disposer des autorisations d’expérimentations sur nos installations prototypes devant équiper les aéronefs de la Marine nationale. Je conduis les visites de sécurité pour relever les cas de non-conformité susceptibles d’impacter la sécurité des vols. Je suis également pilote de processus, le CEPA/10S étant certifié ISO 9001. Le poste est intéressant car très varié, que ce soit au niveau des tâches à réaliser ou des interlocuteurs et il y a une vraie proximité avec les opérationnels. D’autre part, il y a un bel esprit d’équipage au CEPA, ce qui fait que je me sens totalement marin. »
Responsable d’opération projection-soutien, (SSF Toulon)
• Marc
« Être civil au sein de la Marine est un rôle à part entière. Le service de soutien de la flotte est le lieu où s’exprime le mieux la complémentarité entre civils et militaires. Chargé de la gestion de la maintenance de flotte de navires (à savoir les porte-hélicoptères amphibies et les bâtiments ravitailleurs), je dois assurer la disponibilité des navires. Mon travail s’articule autour de deux missions essentielles : préparer et gérer des périodes de maintenance et être en mesure de dépanner rapidement tout navire soumis à une avarie où qu’il soit dans le monde. Je dois également penser au temps long en anticipant l’obsolescence des équipements et préparer l’accueil des nouveaux navires, en lien avec le budget prévu par la loi de programmation militaire. Si l’esprit marin consiste à se battre pour une mission, à s’approprier le navire sur lequel on travaille, alors oui, je l’ai, sans l’ombre d’un doute. J’éprouve toujours une immense satisfaction à voir revenir un navire d’une mission longue sans encombre. »
Adjoint au chef de magasin aéronautique (BAN de Hyères)
• Laurent
« J’occupe un poste de logistique dans l’aéronautique navale, dédié à l’approvisionnement et la délivrance des matériels aéronautiques. Destinés à être montés sur les hélicoptères de la base, les matériels sont également délivrés aux forces présentes sur des théâtres d’opérations extérieures. Je veille à la bonne application des ordres de mouvements délivrés par la Direction de maintenance aéronautique. Ma mission consiste aussi à encadrer six civils et militaires, planifier les tâches des opérateurs et les former sur le tas. Enfin, nous devons assurer le stockage et la conservation des matériels dans de bonnes conditions. Il y a un vrai esprit d’équipage dans mon équipe, c’est très agréable. Civil ou militaire, chacun a ses spécificités, mais le quotidien est partagé ensemble. Lorsqu’on réalise une sortie de matériels pour rendre opérationnel un aéronef, on a un sentiment d’appartenance à la Marine. »























